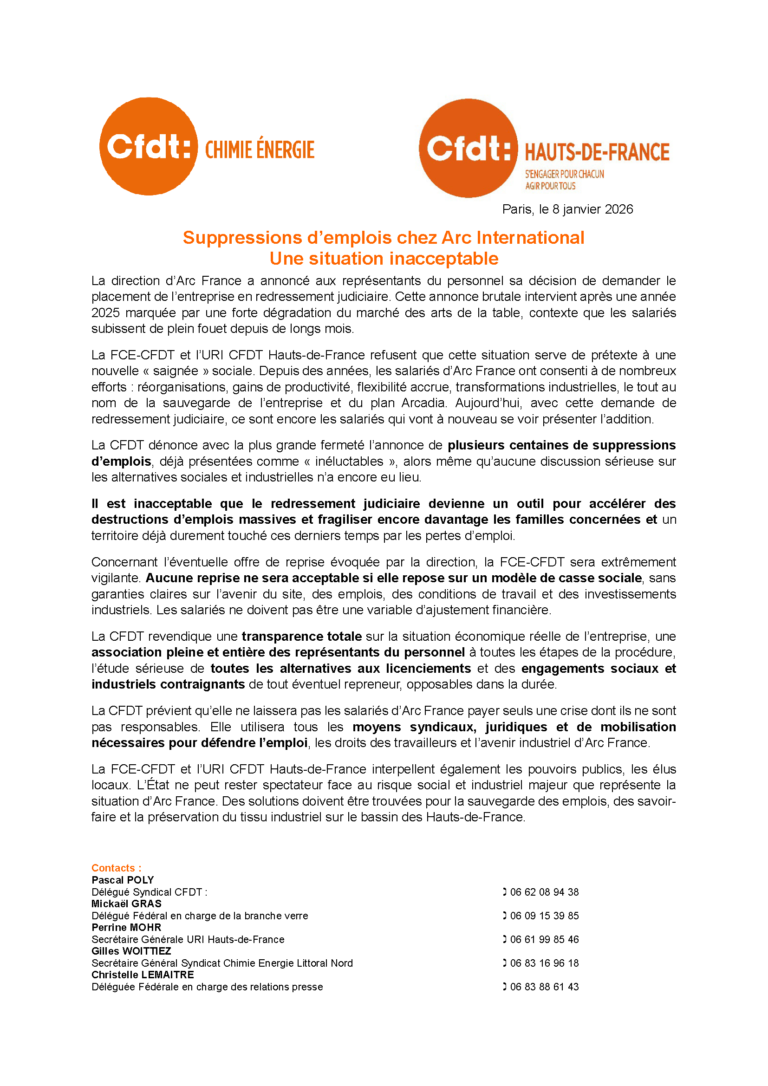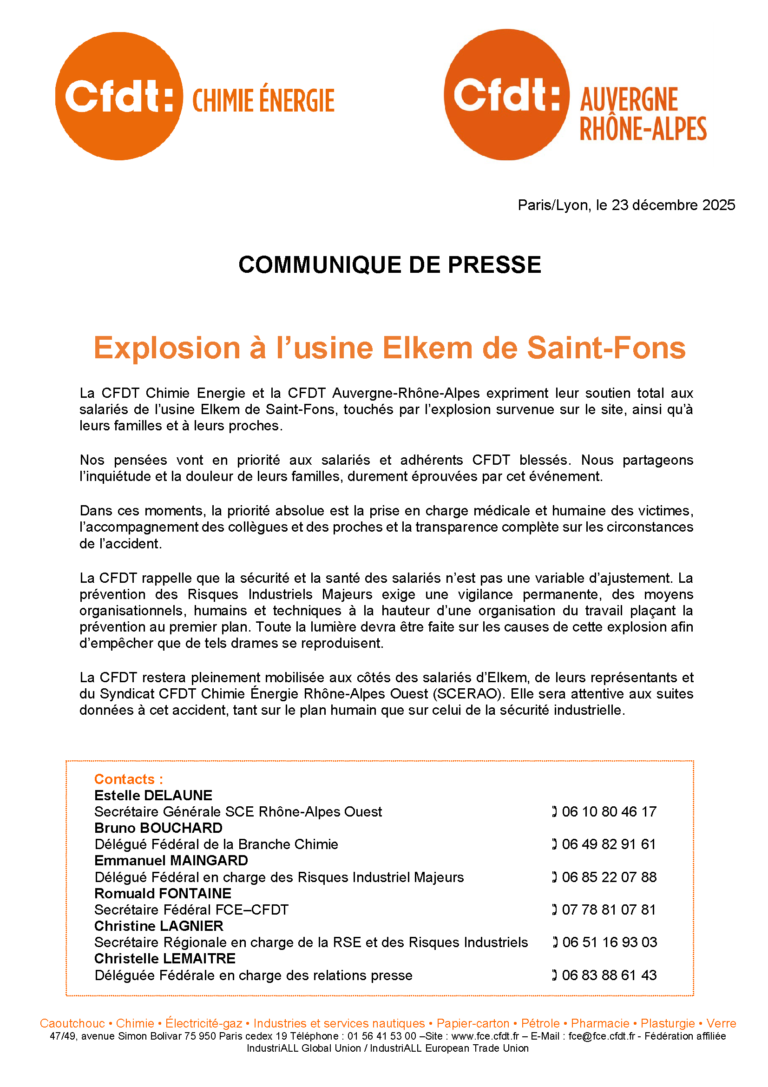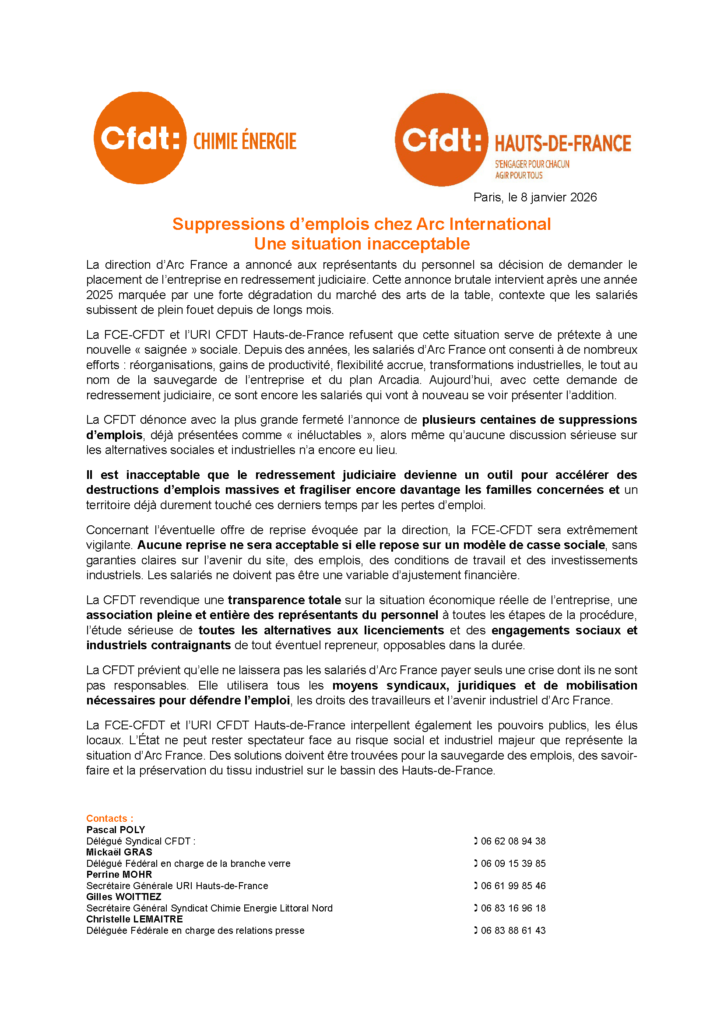A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le gouvernement, afin de garantir un maximum de sécurité dans notre pays, a décrété l’état d’urgence qui depuis a été prolongé jusqu’à fin mai. Ce régime d’exception restreint les libertés, qu’elles soient publiques avec par exemple l’interdiction de manifester, ou individuelles au travers de l’assignation à résidence. Le projet de réforme constitutionnelle vise à intégrer l’état d’urgence dans les textes fondamentaux de notre démocratie aux côtés de la déchéance de la nationalité. Dès lors, de nombreuses voix se font entendre et combattent de telles dispositions. C’est notamment le cas d’Amnesty International ou la Fédération Internationale des Droits de l’Homme.
Elles mettent en avant l’inefficacité de telles mesures pour combattre le terrorisme et prévenir la radicalisation qui pour elles stigmatisent certaines populations. Elles s’élèvent contre les risques de dérive sécuritaire qui instaure la suspicion et sanctionne l’intentionnalité des comportements.
Aux côtés de ceux qui pensent que la liberté doit l’emporter sur la sécurité pour qu’une société démocratique vive, d’autres considèrent que la sécurité doit primer sur la liberté au vu des événements que la France a connu. Dans la période, les controverses vont bon train. Tout est, comme toujours, une question d’équilibre.
En effet, les mesures exceptionnelles de l’état d’urgence ne peuvent être que provisoires et de court terme. Elles ne doivent en aucun cas s’ériger en réponses de droit commun. La sécurité est certes une des conditions de la liberté mais elle ne doit pas prendre le pas sur cette dernière. Force est de constater que la réponse exclusivement sécuritaire n’est pas appropriée aux enjeux de société qui sont les nôtres. A ce titre, la Cour européenne des droits de l’homme veille à ce qu’aucune dérive liberticide ne soit possible, comme celle qui a pu être constatée aux Etats Unis, avec le Patriot Act, suite aux événements du 11 septembre 2001.
Le projet de réforme pénale qui se profile en France, pourrait renforcer une justice qui reconnaitrait la logique prédictive des comportements et sanctionnerait les intentions de tout un chacun. Et les dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence portent en elles les prémisses de ce penchant.
Au-delà des gardes fous juridiques, une réponse républicaine reste à construire sur le long terme, avec l’ensemble des acteurs de la société civile et les contre-pouvoirs qui fondent notre société. La CFDT entend y prendre toute sa place, comme contributrice au débat public et citoyen.