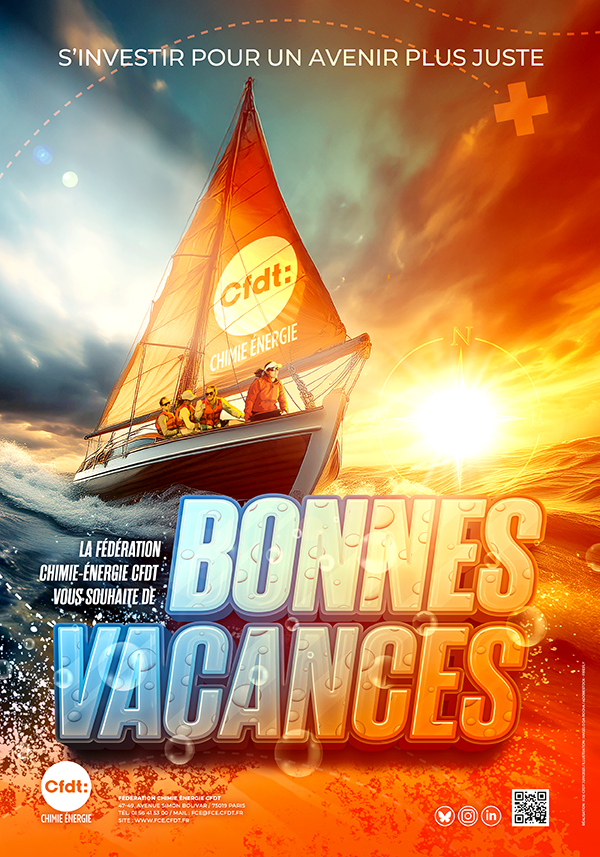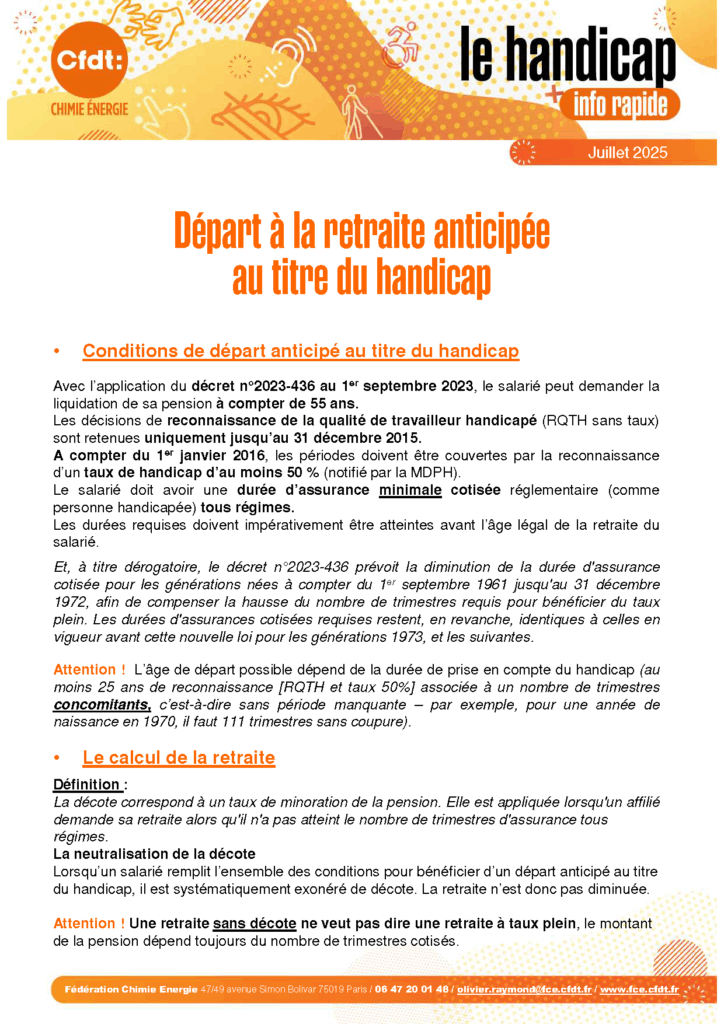Angela Merkel vient d’être désignée à la tête du gouvernement allemand. Pourtant, on ne peut oublier le tintamarre que nous ont infligé les classes politiques allemande comme française autour des candidatures féminines aux élections présidentielles de ces deux démocraties occidentales. N’est-il pas légitime de s’interroger sur une éventuelle régression culturelle qui concernerait la place de la femme dans la société ?
En Allemagne, où la démographie ne cesse de chuter, la campagne outre-Rhin a fait ressurgir un débat latent sur la compatibilité entre famille et travail. En 2003, l’OCDE publiait une étude qui soulignait que la participation des femmes allemandes au marché du travail dépendait directement de leurs responsabilités familiales. D’abord, les systèmes scolaire et fiscal allemands incitent fortement les femmes à rester au foyer. Ensuite, les inégalités salariales, de 20 à 30% dans les entreprises privées allemandes, participent du même processus.
Et bien que la population féminine représente 52% de l’électorat allemand, sa place et son rôle restent largement déterminés par des valeurs conservatrices. Durant la campagne législative allemande, rien n’aura été épargné à la candidate : commentaires sur sa tenue vestimentaire à chaque passage télévisé, attaques pointant le fait qu’elle n’a pas d’enfant, etc.
Le recours à la culpabilisation des femmes allemandes n’aura pas cessé durant ces législatives. Des idées d’un autre temps sont ressorties. Ici, les mauvaises mères qui abandonnent leurs enfants pour aller travailler. Là, les mères-corbeaux qualificatif donné aux femmes qui ont des enfants en bas âges et qui, malgré tout, conjuguent vie familiale et vie professionnelle. Pour les défenseurs de ces thèses archaïques, la femme allemande est tenue de rester dans le triangle des trois K (Kinder, Kirsche, Küche).
En France, les commentaires qui ont fait suite à la possibilité d’une candidature féminine aux élections présidentielles de 2007, sont de la même veine. Les premières réactions ont porté sur les apparences physiques et la vie familiale de la candidate potentielle. Les réflexions médiocres des uns, tout comme le mutisme des autres, dessert la classe politique dans son ensemble.
Cet épisode, en Allemagne comme en France, montre que du chemin reste à parcourir pour une réelle égalité entre les sexes. Pour l’heure, on constate qu’il est plus facile de l’afficher comme une intention que de la promouvoir lorsque le pouvoir est réellement en jeu.