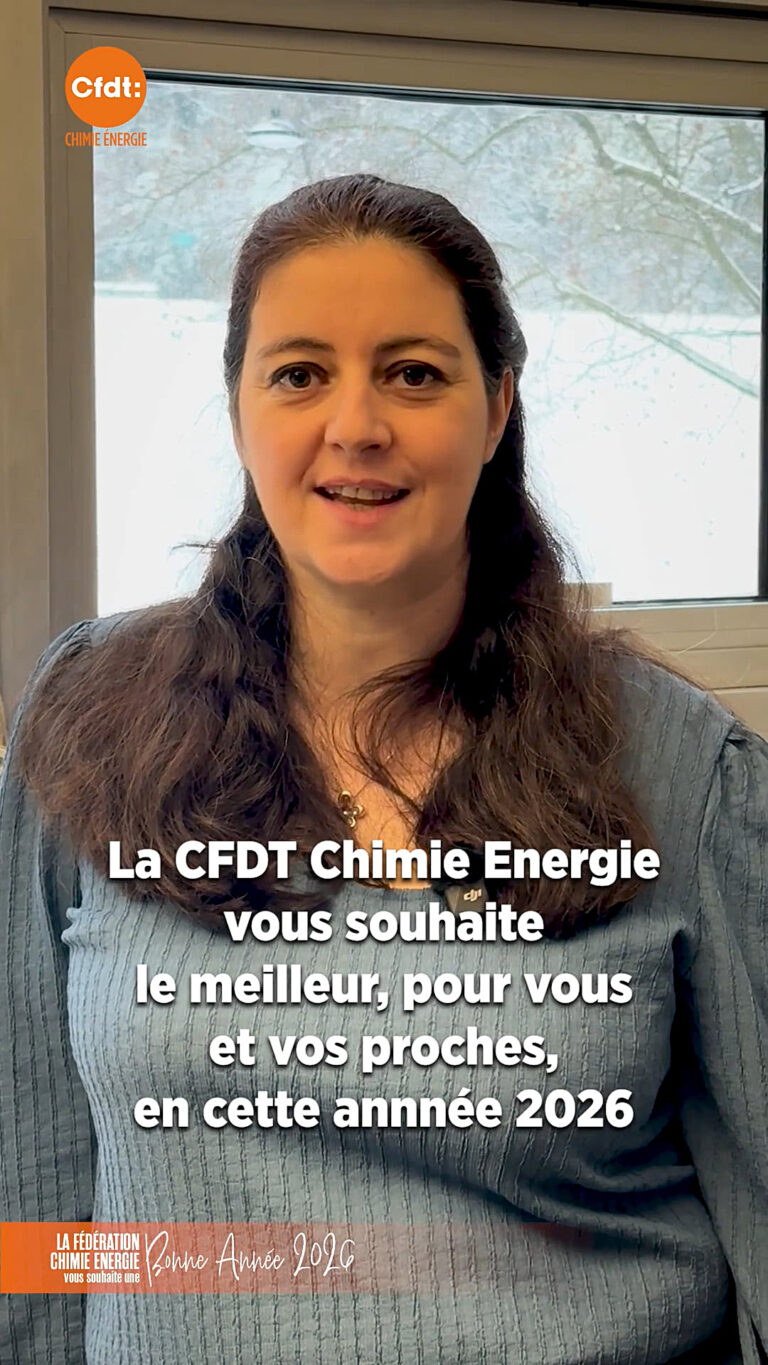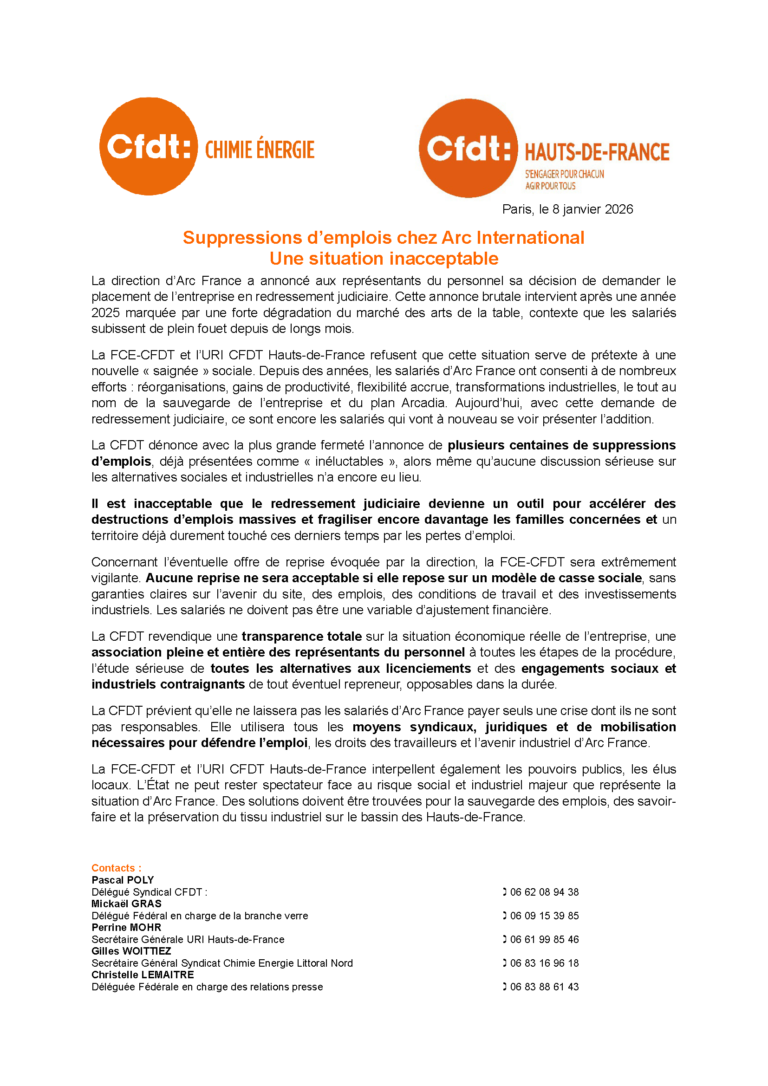Depuis plus d’un an maintenant, le raffinage marketing est entré dans la tourmente tant en France et en Europe qu’en Amérique du Nord. La crise financière et économique a accentué les mutations auxquelles est confronté ce secteur. La FCE-CFDT considère qu’il n’y a pas de fatalité et que des adaptations de l’outil de raffinage sont possibles. Cela passe d’abord par une analyse de l’environnement.
Coup d’œil sur les mutations engagées. La première d’entre elles, se trouve être que les zones de développement se trouvent en Asie et au Moyen-Orient, et non plus en Europe. Souvenons- nous que la dernière raffinerie construite est Leuna en ex-Allemagne de l’Est après la chute du mur de Berlin. Elle correspondait d’ailleurs plus à une modernisation de l’outil qu’à une augmentation de capacité. L’Asie, et en particulier la Chine, est par excellence un marché en développement puisqu’elle génère une grande part de la croissance mondiale. Les raisons sont tout autres pour le Moyen-Orient. Là, il s’agit plus de détourner les quotas de l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), en mettant sur le marché mondial des produits finis. L’an dernier, sept nouvelles raffineries ont commencé à fonctionner en Chine, en Inde, en Irak, au Kurdistan, au Pakistan, au Qatar, et au Vietnam. D’autres projets de construction apparaissent ce qui ne sera pas sans conséquences sur le raffinage européen.
Ensuite, cette industrie est hautement capitalistique. Les investissements, hors ceux liés à la sécurité ou l’entretien courant sont souvent des projets d’adaptation de l’outil à moyen/long terme (optimisation des procédés d’exploitation, unités de retraitement,…). Notamment, le dernier investissement en date, à la raffinerie de Normandie de Total, s’est chiffré à 550 millions d’euros pour augmenter la production de gazole. Cette industrie, qui connaît peu d’évolution technologique de ses procédés, a donc besoin d’une visibilité à moyen/long terme sur les évolutions économiques, mais aussi fiscales et environnementales afin d’évaluer sa rentabilité.
Historiquement, la rentabilité du raffinage marketing comparé à celle de l’exploration-production a toujours été faible. La financiarisation aidant, à l’image des petits champs pétrolifères français cédés dans les années 90, les majors se désengagent progressivement du raffinage marketing.
Ainsi, BP et Shell ont cédé ces dernières années leurs raffineries à Inéos, Pétroplus et LyondellBasell. Aujourd’hui BP, souvent précurseur dans la stratégie des majors, vient d’annoncer son projet de cession de son réseau français à un consortium israélo-libanais. Shell annonce, lui, son intention de supprimer 15 % de ses activités de raffinage dans le monde. Total, après avoir réduit sa capacité de raffinage de 4 millions de tonnes en Normandie l’année dernière, réorganise ses activités en Italie en créant une joint-venture avec la société italienne ERG (Total 49 % et ERG 51 %). Enfin, l’annonce de l’arrêt de la raffinerie de Flandres a été annoncée le 8 mars 2010.
Dernière évolution, et pas la moindre, celle de la consommation des produits pétroliers. Il ne s’agit pas de la diésélisation qui est engagée depuis plusieurs années. Cette situation oblige aujourd’hui d’importer 15 à 18 millions de tonnes par an de gazole et génère des excédents d’essences. Ces derniers exportés hier aux Etats-Unis, le sont de moins en moins compte tenu de l’évolution du parc automobile américain. Il faut aussi rappeler que l’outil de production construit dans les années 70/80 avait été structuré pour fabriquer essentiellement des essences. De plus, dans un baril de pétrole quelles que soit les techniques employées, il y a toujours des gaz, des essences, des gazoles, et du fuel lourd. Les proportions varient en fonction de la qualité du brut et du niveau de conversion de la raffinerie.
Trois nouveaux facteurs viennent fragiliser le raffinage marketing. L’accroissement du coût de l’énergie (en 2007 et 2008), suivi de la crise, a généré un changement de comportement des consommateurs. La consommation a reculé de 2,6 % en 2009 par rapport à 2007 : – 3 % pour le super, – 2,1 % pour le fioul domestique, – 11,6 % pour le fioul lourd et – 5,5 % pour les carburants d’avion, seul le gazole progresse de 1,1 %.
Second facteur, la crise conjoncturelle et structurelle de l’automobile a, elle aussi, des conséquences sur la vente des produits pétroliers. La prime à la casse en 2009 a permis la vente de 600 000 véhicules neufs qui consomment moins que les véhicules de 10 ans. De plus, les consommateurs ont recherché des véhicules « plus propres » et de plus petite taille. Cette évolution de parc automobile va se poursuivre avec l’arrivée en 2011 de véhicules hybrides.
Le troisième facteur est lié au Grenelle de l’Environnement (réduction des consommations d’énergies dans les bâtiments neufs et anciens, réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre dans les transports, augmentation de la part de marché des transports non routiers de 14 % à 25 %, développement des énergies renouvelable,…). Ces objectifs combinés avec le changement de comportement et la sensibilisation des consommateurs contribuent à réduire la dépendance aux énergies fossiles.
Il ne sert à rien de nier ces évolutions. Elles peuvent seulement se décaler plus ou moins dans le temps.
Si l’activité du raffinage marketing n’est plus en expansion en Europe, elle n’est pas morte pour autant. Il se passera encore du temps, avant que le parc automobile français soit modifié en profondeur ou que les avions électriques fassent leur apparition.
Le raffinage marketing n’a pas d’autres perspectives que de s’adapter. Il lui faut intégrer le fait environnemental. L’exploitation du brut dans toute sa chaîne a généré des pollutions. Des normes sont venues réglementer les produits et les rejets, ces vingt dernières années. La volonté des pouvoirs publics français et européen d’aller plus loin se justifie au regard de la santé des salariés, des citoyens et l’avenir de la planète.
Pour le raffinage français, cela signifie, au-delà de respecter ces normes et non contraintes, d’améliorer son efficience énergétique, de disposer des meilleurs procédés pour limiter les rejets de CO2, voire d’envisager, selon, les lieux sa captation.
Adapter l’outil de raffinage pour traiter le fond du baril (fuel lourd) et notamment fabriquer plus de gazole représente des investissements très lourds. Pour surmonter cette difficulté, une des solutions passe par des investissements en coopération entre les différents acteurs sur les trois principaux bassins (Normandie, PACA et Pays de Loire) et d’y rattacher par des contrats, les raffineries « satellites ». Les exigences en termes de retour sur investissement sont telles qu’aujourd’hui des acteurs retardent ces investissements indispensables en maximisant la production de gazole au détriment du fuel domestique et sans réduction de la production d’essence.
Enfin, les liens entre le raffinage et la pétrochimie doivent être renforcés. D’autres sujets comme l’évolution des bassins d’emplois, et les liens avec la sous-traitance devront également être traités.
L’ensemble de ces adaptations aura des conséquences sur les territoires et l’emploi direct et indirect. Seul un dialogue ouvert, tant au niveau de la branche que des entreprises, permettra d’anticiper ces évolutions.
L’enjeu, aujourd’hui, est bien d’approfondir cette réflexion au niveau de la branche pétrole de la FCE et de la poursuivre avec la chambre patronale, mais aussi dans les entreprises. Ne pas mesurer ces mutations, c’est s’interdire de réfléchir et d’anticiper aux évolutions des emplois, notamment dans leur contenu. La situation des salariés de la raffinerie de Flandres démontre qu’il nous faut anticiper pour ne pas subir.