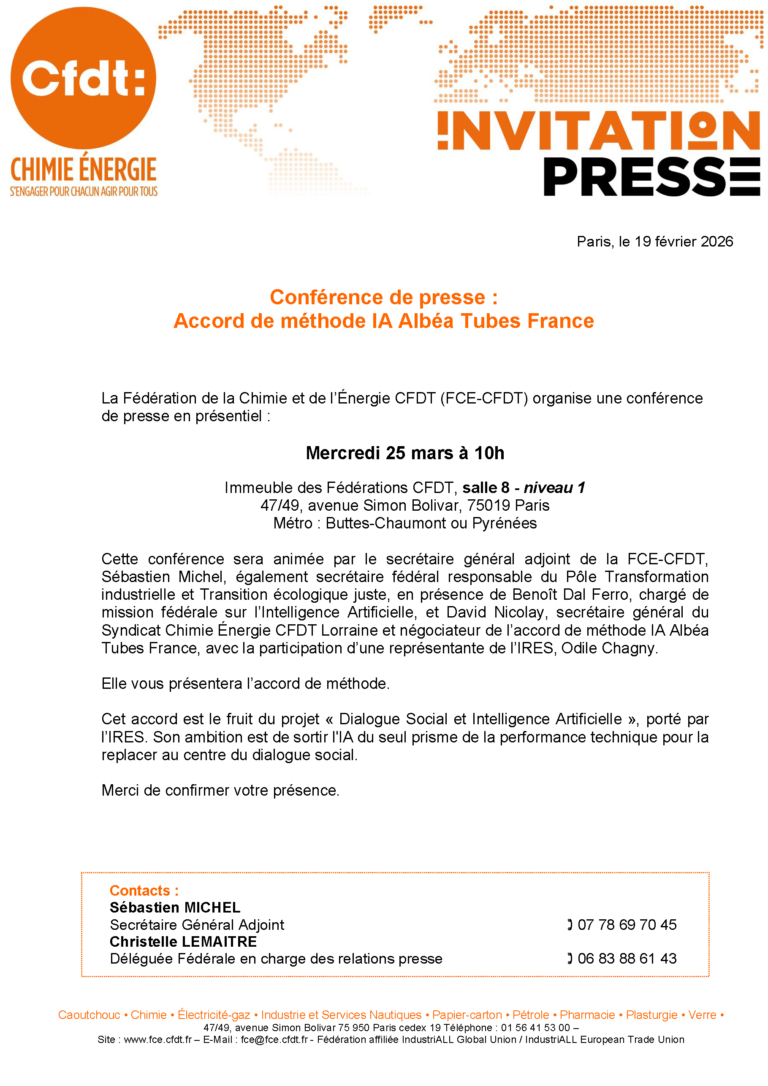Cela fait maintenant plusieurs décennies que le secteur industriel français et européen est confronté à des restructurations successives. Compétitivité, mondialisation, coût du travail sont les arguments récurrents avancés pour justifier, ici ou là, fermeture de sites, réorganisations, voire délocalisations.
Contrairement aux idées véhiculées tous les jours, les cas où les entreprises ferment un site en France pour le transporter dans un pays émergent, sous couvert de gagner sur le coût du travail, sont marginaux au regard de l’ensemble du tissu industriel. Cela s’explique par le bon niveau de productivité que connaît la France. Les dernières statistiques en date, relatives à l’attractivité des pays par rapport aux différentes implantations en 2006, le démontrent d’ailleurs. La France reste parmi les pays qui attirent le plus les investissements étrangers.
Cela dit, les difficultés de l’industrie sont bien réelles. Elles défrayent l’actualité au quotidien. Alcatel, Bayer, Dim, EADS, Renault ou Seb, en sont des exemples criants. Il ne serait pas fondé de faire un amalgame entre ces différents exemples, tant ils sont confrontés, chacun, à leur propre réalité. Cependant, les évolutions qui s’opèrent et leurs conséquences touchent aussi bien les aspects économiques, industriels que sociaux. La question du rapport entre donneur d’ordre, sous-traitant et fournisseur, notamment, y est systématiquement posée.
Le manque de visibilité industrielle à moyen terme est aussi un élément significatif que l’on retrouve souvent. Toutes les décisions, prises dans le cadre de restructurations, ont un impact important sur les territoires. Le changement des compétences existantes au sein d’un bassin d’emplois, ou encore la modification de la nature et de la taille des entreprises en présence, peut amener à la désindustrialisation d’un bassin entier.
Le sentiment d’insécurité sociale est alors renforcé par les pertes de repères que ces situations procurent. La peur du lendemain, celle de se retrouver au chômage, la crise de confiance envers les décideurs et les acteurs de la vie politique et sociale, ne peuvent que se développer dans de tels contextes.
Ce constat est inquiétant, car il rend difficile la capacité à anticiper ces évolutions par une seule gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour notre fédération, il est donc urgent de proposer et d’agir. La définition d’une politique industrielle européenne est ici essentielle. La mise en place de nouveaux lieux de négociation permettrait un dialogue social entre les différents acteurs d’une même filière industrielle. En développant un espace de négociation complémentaire, le territoire y aurait toute sa place. En gagnant en visibilité, tout ceci serait aussi de nature à redonner confiance aux salariés.