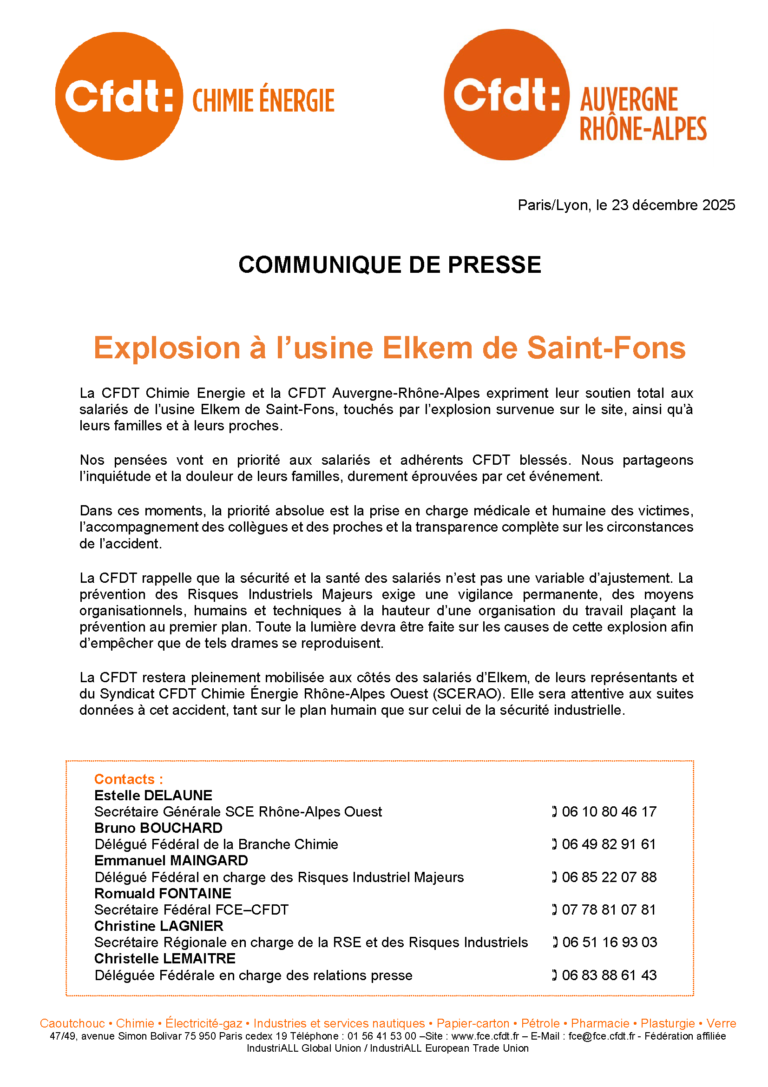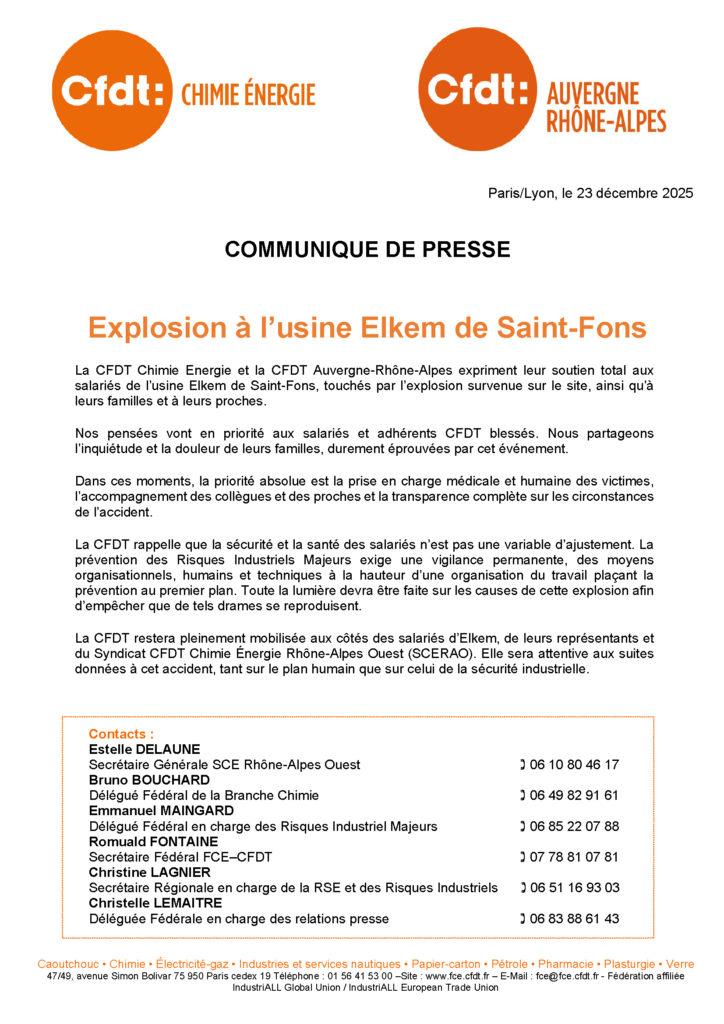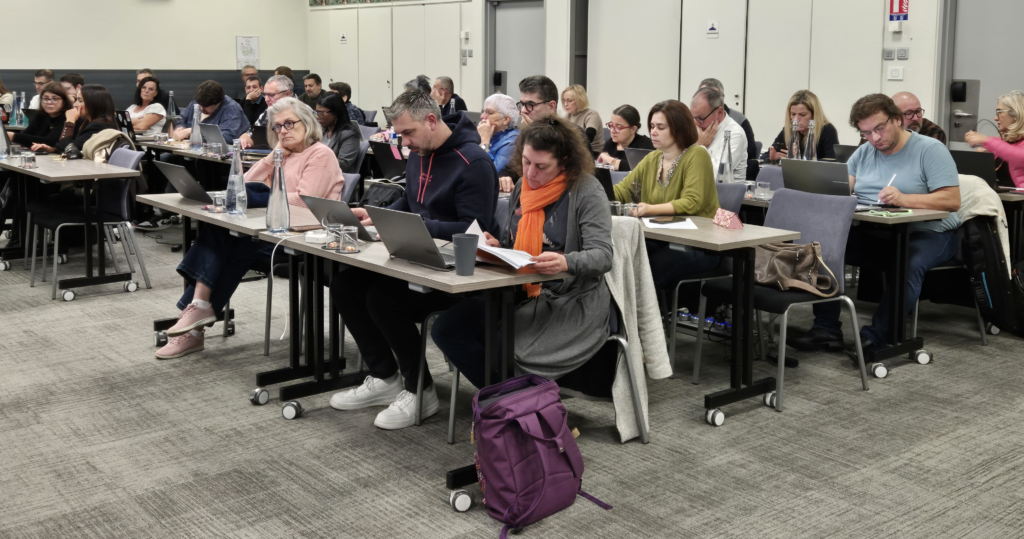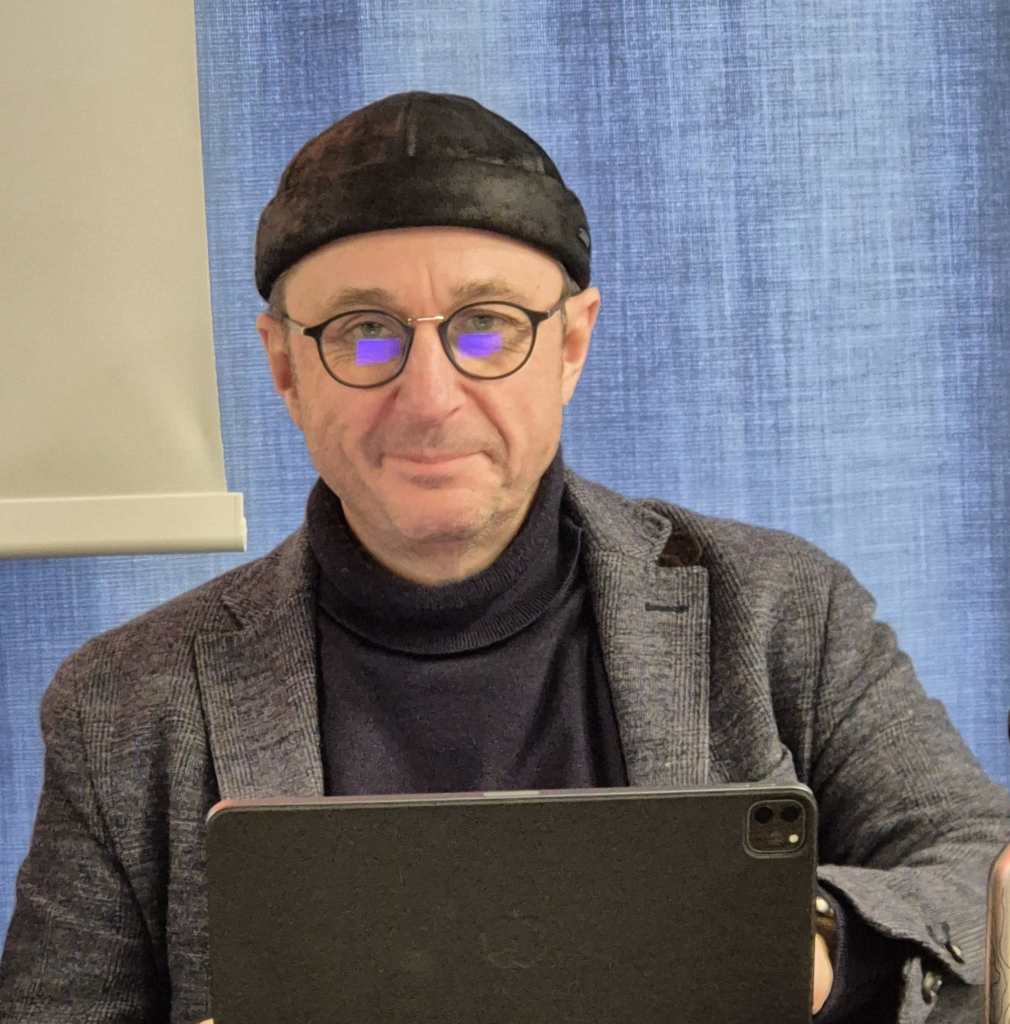Une nouvelle étude menée en 2004 sur l’impact des éthers de glycol fait craindre un caractère non réversible à l’atteinte des cellules de la reproduction.
Les éthers de glycol sont des solvants apparus dans les années 30. Depuis les années 60, ils figurent très souvent dans les produits dits à l’eau, notamment les peintures, les encres, les vernis, les produits d’entretien, les fluides de coupe, mais aussi les cosmétiques et les médicaments. Ces substances se subdivisent en deux grands groupes. La série E comprend les plus toxiques, les dérivés de l’éthylène glycol. La série P comprend, elle, les moins toxiques, les dérivés du propylène glycol.
En 1971, une première étude montrait les effets des éthers de glycol sur la reproduction. Mais le premier avis d’alerte ne date que de mai 1982. C’est l’État de Californie aux Etats-Unis qui le lance. En Europe, la classification des éthers de glycol comme produits toxiques pour la reproduction n’a débuté qu’en 1993 !
En France, dans les années 80, un million de travailleurs étaient exposés aux éthers de glycol les plus toxiques (série E), et un nombre encore plus grand de consommateurs via les produits domestiques et les médicaments. Il faut savoir qu’en milieu professionnel, l’exposition aux éthers de glycol se fait par voie transcutanée et respiratoire.
Aujourd’hui, les éthers de glycol de la série P, les moins toxiques, ont principalement été substitués à ceux de la série E. Mais il en est aussi un autre de la série E (EGBE) qui leur a été substitué. Celui-là est non seulement aussi un toxique du développement de l’embryon, mais encore du sang
Depuis 2002, de nouvelles études, notamment celle de l’Inserm en 2004 sur les salariés de la mairie de Paris et de la RATP, font craindre un caractère non réversible à l’atteinte des cellules de la reproduction chez l’Homme. D’autres études ou constatations confirment le risque d’atteintes sanguines et rénales ou d’interactions avec les hormones féminines par certains éthers de glycol. Enfin, le risque d’atteintes génotoxiques (atteintes des chromosomes) apparaît dans plusieurs études et plaide pour un renforcement des connaissances sur le caractère cancérogène de certains éthers de glycol, y compris certains de ceux de la série P.
À ce jour, la classification européenne répertorie sept éthers de glycol reprotoxiques catégorie 2, c’est-à-dire comme « substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité humaine ». Ils ne sont pas interdits d’usage en milieu professionnel, mais doivent faire l’objet des mesures préventives fixées par le décret du 1er février 2001 relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques :
– obligation de substitution par un produit non dangereux sauf impossibilité technique,
– suivi médical renforcé et traçabilité des expositions individuelles,
– interdiction d’exposer les femmes enceintes ou allaitant.
Pour le public, six de ces éthers de glycol font l’objet d’une limitation d’utilisation à une concentration maximale de 0,5 % dans les produits domestiques, et non pas d’une interdiction.
– La FCE-CFDT, membre du collectif Ethers de glycol, fondé en 1998, revendique :
• la mise en œuvre des recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France de 2002, préconisant le retrait total des sept éthers de glycol reprotoxiques de la série E ;
• une évaluation de l’impact sanitaire des expositions passées et le lancement de recherches sur les effets encore mal évalués chez l’Homme : cancers, atteintes de la reproduction et de la descendance, effets rénaux, hématologiques et immunitaires ;
• l’interdiction des éthers de glycol reprotoxiques en milieu professionnel et leur substitution par des produits avérés moins dangereux.
Seule l’interdiction de ces solvants constitue une modalité de prévention efficace. Ne répétons pas la pratique de l’usage contrôlé, prônée par l’industrie, qui a montré toutes ses limites pour l’amiante.