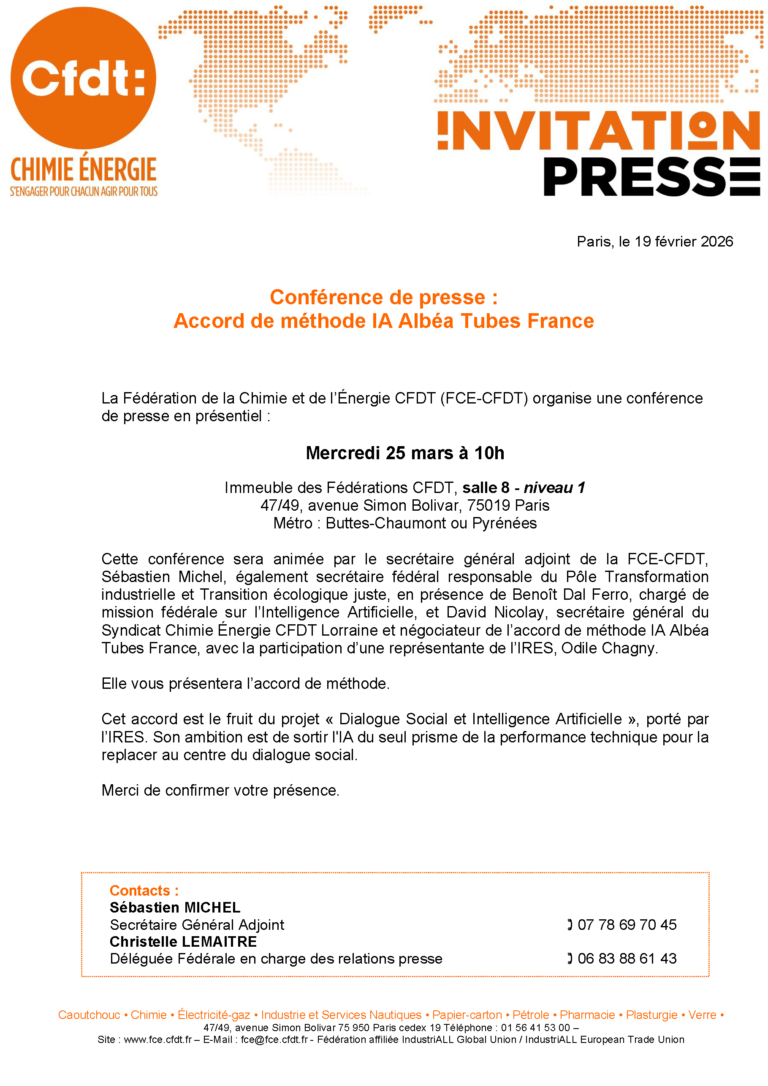La crise gazière qui s’est déroulée entre la Russie et l’Ukraine pourrait bien être salutaire et entraîner une prise de conscience européenne sur la nécessité de décider rapidement des contours d’une politique énergétique européenne. La question de l’indépendance énergétique est en effet revenue dans le débat communautaire de façon brutale, suite au bras de fer que se sont livrées Moscou et Kiev. La communauté a ainsi pris conscience de sa fragilité : 25 % du gaz importé par l’Union européenne sont aujourd’hui fournis par Gazprom.
Au delà de la problématique du gaz, la question de l’indépendance énergétique du continent n’est pourtant pas nouvelle. En 2002 déjà, un Livre vert sur la question avait été présenté et débattu au Parlement européen. Il soulignait que l’Union européenne était aujourd’hui dépendante des pays producteurs à hauteur de 50 %. Il précisait aussi que si aucune décision n’était prise, ce constat s’aggraverait. Il allait même jusqu’à envisager une dépendance à hauteur de 70 % pour les décennies à venir. Il est vrai que depuis, peu de décisions, peu d’initiatives avaient été prises pour remédier à cette situation.
On ne peut alors que se féliciter du sursaut européen de ces derniers jours, qui fixe la définition d’une politique énergétique européenne comme objectif principal de la présidence autrichienne. Ce dossier devrait même être débattu lors du prochain Sommet des 25, en mars 2006. Côté français, le président de la République a profité de la présentation de ses vœux pour annoncer le lancement d’un prototype de réacteur nucléaire de 4e génération qui devrait être mis en service en 2020. Drôle de façon de rentrer dans le futur débat communautaire que d’affirmer la suprématie de la France dans ce domaine… Côtés allemand et finlandais, la question du nucléaire est également relancée.
Pour la CFDT, le regain d’intérêt pour une politique énergétique européenne va dans le bon sens. Cependant, il ne faudrait pas réduire le débat à la seule question du nucléaire qui n’est qu’un élément d’une réponse plus large encore à trouver. La capacité des Etats à impulser des politiques qui diminuent le poids de l’énergie dans notre vie quotidienne est aussi un élément à considérer. Le développement des énergies renouvelables à partir de ressources naturelles de proximité, la diversification des approvisionnements, le taux des investissements dans les infrastructures existantes comme dans les nouvelles technologies, sont autant de pistes à envisager pour pouvoir répondre à la question de notre autonomie énergétique, mais aussi aux exigences environnementales.
Dès maintenant, l’Union européenne doit se doter d’instruments politiques intégrant la société civile qui soient en charge d’examiner plusieurs scénarios à proposer pour demain. C’est d’autant plus important que ce sont les choix d’aujourd’hui qui structureront l’offre et nos modes de vie pour plusieurs décennies.