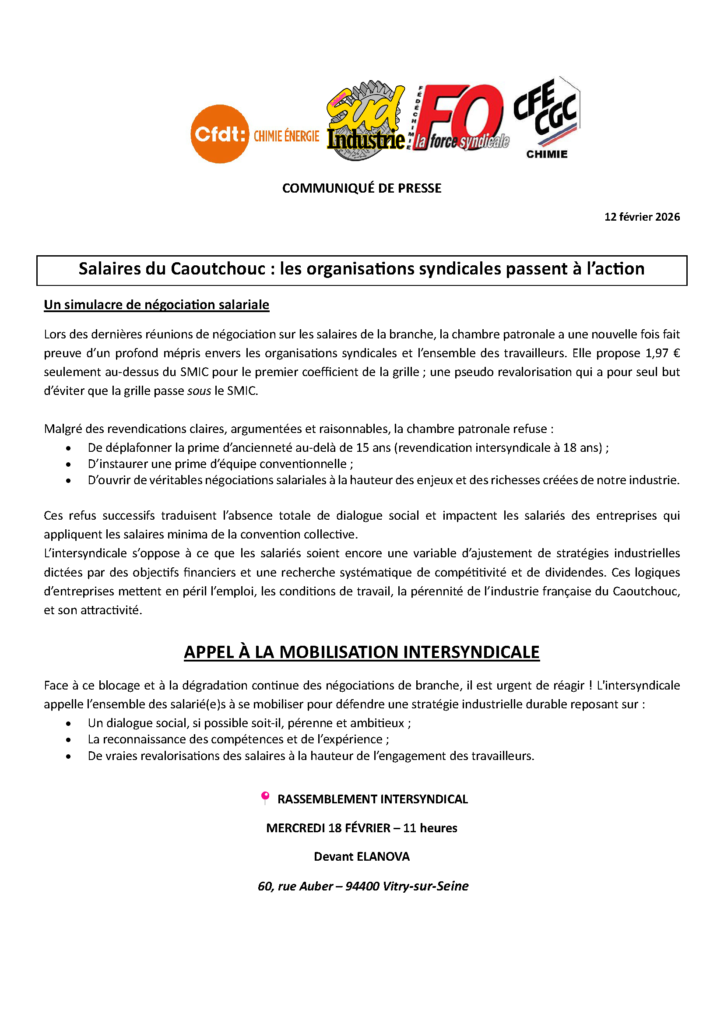Péjudice d’anxiété : quelle est la nature de ce nouveau préjudice ?
Il a été reconnu, pour la première fois, par la haute juridiction en 2010. Il permet de réparer l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d’existence qui résulte du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 avril 2019, étend son champ d’application. Ainsi, tout salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut en demander l’indemnisation.
Cet arrêt est d’une très haute importance puisque, désormais, tous les salariés exposés à l’amiante peuvent prétendre à l’indemnisation de ce préjudice, quand bien même ils n’auraient pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
De plus, la réparation de ce préjudice, qui peut être accordée en cas d’exposition à l’amiante, peut depuis l’être aussi en cas d’exposition à toute autre substance nocive ou toxique (Cass. Soc., 11 septembre 2019, n°17-24.888).
Préjudice d’anxiété : quel délai pour agir ?
Si le salarié travaille dans une entreprise qui figure sur la liste établie par arrêté des ministres du Travail, du Budget, et de la Sécurité sociale (l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée) comme exposant ses salariés à l’amiante, ce délai est de cinq ans à compter du jour où ce dernier a connaissance, ou aurait dû connaître, cette exposition. Généralement, cela correspond à l’inscription de l’entreprise sur la liste des métiers liés à l’amiante.
Si le salarié travaille dans une entreprise ne figurant pas sur cette liste, c’est-à-dire en cas d’inobservation par l’employeur de son obligation de sécurité, ce délai est de deux ans à compter du jour où il a connaissance de cette exposition.
Donc, dès que le salarié a connaissance de sa situation, il a cinq ans ou deux ans, selon le cas, pour monter son dossier en vue d’obtenir une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété.
Réévaluation du délai
Dans l’arrêt du 8 juillet 2020, 70 salariés se sont vu débouter de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété au motif que celle-ci était trop tardive. En effet, pour la cour d’appel, comme l’entreprise où travaillaient ces salariés avait installé une cabine de décontamination en 2004, le point de départ du délai commençait à cette date.
Or, le 8 juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté cette argumentation. Elle considère que le point de départ du délai de deux ans est la date à laquelle ces salariés ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à l’amiante. Elle précise que ce point de départ peut être postérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. Ainsi, la cour d’appel aurait dû rechercher à quelle date les salariés avaient cessé d’être exposés à l’amiante.
Cette décision est très favorable aux salariés qui disposent, désormais, d’un délai de deux ans, à compter du jour où ils ont cessé d’y être exposés, pour agir en reconnaissance de ce préjudice, et non plus à compter du jour où ils ont connaissance du risque.
Chaque travailleur exposé à ce risque doit, avec le concours de son employeur et de la médecine du travail, compléter le formulaire du FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) à partir duquel le processus s’enclenche.