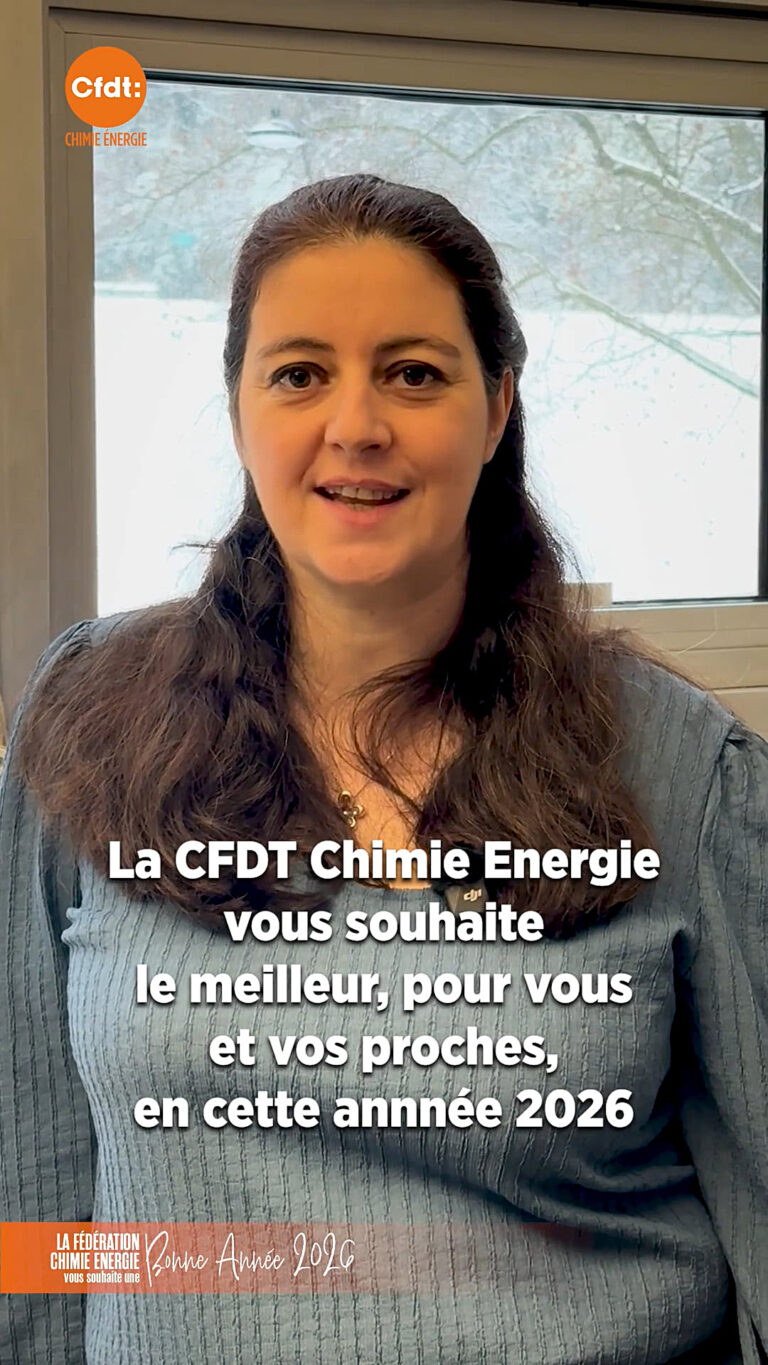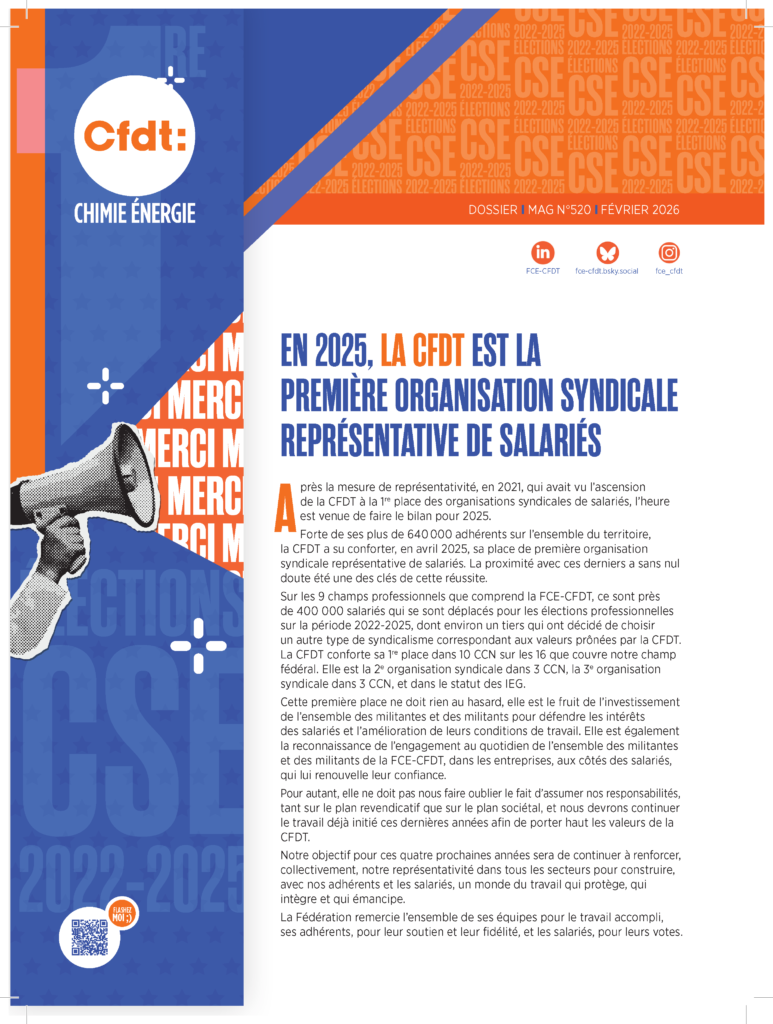En janvier dernier, la CFDT présentait à la presse le dossier
de la dépendance. La FCE en souligne ici quelques éléments.
La prise en charge de la perte d’autonomie comporte de nombreux enjeux. Celui de l’évolution de la cellule familiale, du maintien à domicile, de la place des femmes dans la société et le monde du travail, ainsi que la professionnalisation des métiers de ce secteur. Les enjeux sont aussi économiques (coût du risque, coût et qualité du travail) et liés à l’organisation du système de soin. Les métiers du grand âge devraient créer près de 200 000 emplois d’ici 2015.
Une définition. La perte d’autonomie peut être définie comme l’impossibilité ou la difficulté durable d’accomplir seul et sans aide les gestes de la vie quotidienne et de participation à la vie sociale. Les situations qui portent atteinte à l’autonomie sont susceptibles de concerner chacun, à tous les âges de sa vie.
Créer une protection sociale pour l’autonomie consiste à promouvoir des prestations au delà des soins et des dépenses de la vie courante. Il s’agit de couvrir les surcoûts liés à la dépendance dans la vie quotidienne et sociale.
Quelles perspectives ? Avec 1,1 million de bénéficiaires, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est attribuée à 6,7 % des 16,4 millions de personnes de plus de 60 ans. Au grand âge, la perte d’autonomie est un phénomène en relative diminution. A l’avenir, les personnes âgées dépendantes devraient tout de même être plus nombreuses à cause de l’augmentation des classes d’âge de plus de soixante-dix ans et d’une espérance de vie plus importante des personnes handicapées.
Des incertitudes demeurent sur le moyen-long terme. Les innovations médicales peuvent faire varier sensiblement le nombre de personnes en perte d’autonomie et les coûts. Les technologies liées à la perte d’autonomie peuvent prendre un élan très important. L’attitude des pouvoirs publics pour encourager ou non la recherche et le développement, mais aussi inciter les industriels à investir sera déterminante.
Un enjeu financier soutenable. Le défi financier est à relativiser. L’intervention publique en direction des personnes âgées en perte d’autonomie représente environ 22 milliards d’euros, à comparer aux 261 milliards de pensions de retraites versés en 2009 ! L’enjeu du vieillissement porte plus sur le financement les retraites que sur celui de la perte d’autonomie. Les chiffres « catastrophistes » annoncés par le gouvernement peuvent servir à préparer des réponses individuelles (assurances privés et recours sur succession). En matière de financement, les deux principaux sujets concernent le financement de l’allocation personnalisée autonomie et le coût de l’hébergement en établissement.
Ce que veut la CFDT. Elle souhaite la création d’un droit universel d’aide à l’autonomie, concrétisé par une allocation et l’amélioration des services. Le financement doit être mutualisé, majoritairement public et reposer sur des exigences de solidarité et de justice. La CFDT revendique un financement pérennisé sur la base d’une solidarité large assurée par tous les revenus, y compris les pensions de retraite.
– Successions et donations. La fiscalité des successions et donations est trop faible. Depuis la loi Tepa, 95 % des successions sont exonérées. Une taxe de 1 % sur les transmissions pourrait rapporter plus d’un milliard d’euros. Ce serait plus solidaire que le recours sur succession et éviterait que des personnes refusent des solutions d’hébergement pour préserver l’héritage.
– Rapprocher la fiscalité des actifs et des retraités. Cette option peut être envisagée de plusieurs manières : il existe divers taux de CSG chez les retraités. La contribution solidarité pour l’autonomie (ex journée Pentecôte) n’est payée que par les salariés. Retraités et professions libérales doivent aussi l’acquitter.
– L’assurance complémentaire. La question de l’intervention d’assurances complémentaires ne peut s’envisager qu’après la consolidation du socle public et dans le cadre d’un partenariat avec le régime public en vue de réguler ce nouveau champ de protection sociale.
– Renforcer l’attractivité des métiers. Il s’agit d’un enjeu essentiel. Il faut prendre en compte les enjeux de qualification des salariés de ces secteurs.
– Une autre organisation du système de soins. Pour les personnes âgées, il faut développer une meilleure coordination entre le domaine sanitaire (établissements de soins, hospitalisation à domicile…) et le domaine social (établissements médicosociaux et services d’aide à domicile).