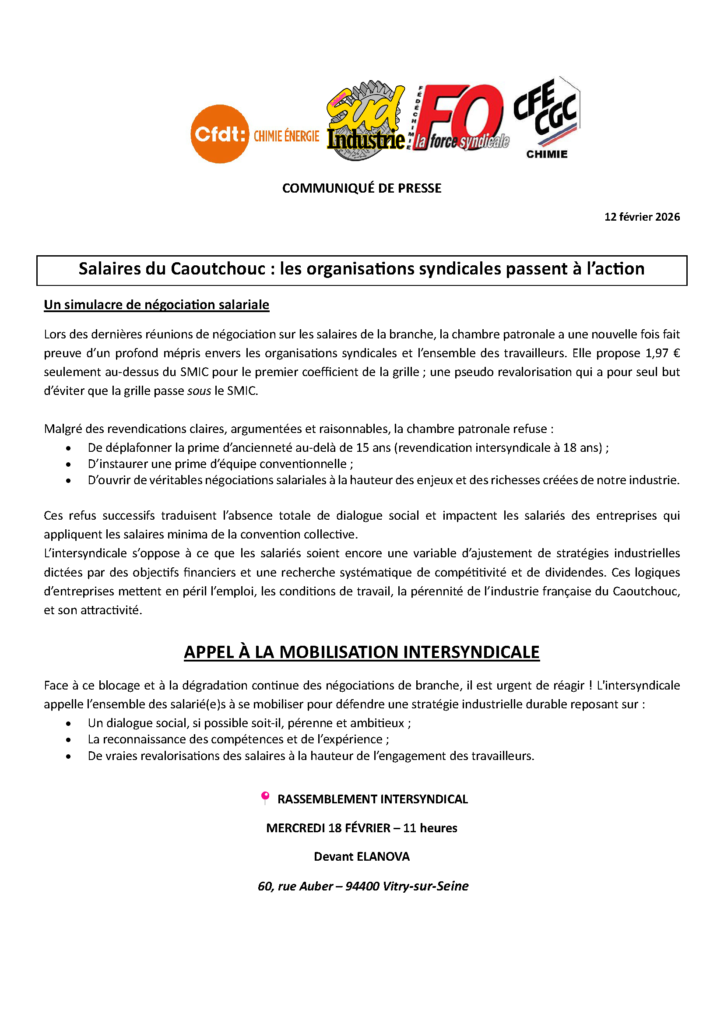Les origines du Comité d’Entreprise à la française (CE), transformé en Comité Social et Economique d’entreprise (CSE) entre 2018 et 2020, sont à rechercher dans une période controversée de notre Histoire. Si le CE et désormais CSE a deux rôles bien distincts, social d’un côté, économique de l’autre, il a en fait deux dates de naissance : l’une en 1941 et l’autre en 1945. Le 4 octobre 1941, la charte du travail de Pétain créée et cantonne les comités sociaux d’entreprise à la gestion des œuvres sociales « généreusement » créées par les employeurs. C’est en fait un instrument de contrôle du monde du travail. Cela dénote fortement avec nos voisins européens pour lesquels, encore aujourd’hui, en Allemagne ou en Belgique par exemple, les CE ont un rôle économique excluant toute notion de gestion des œuvres sociales.
C’est le 22 février 1945 que le Général De Gaulle, avec le Conseil national de la Résistance créé les Comités d’Entreprises (CE) ajoutant au socle social précédent un rôle économique et professionnel. L’implication des salariés dans les décisions quotidiennes de leur entreprise, bien qu’encore insuffisante est en marche. Si 1946 apporte son lot d’avancées significatives, il faudra attendre 1982 et les lois « Auroux » pour permettre aux CE d’entrer dans une nouvelle dimension sociale, en introduisant l’obligation pour l’employeur de financer le fonctionnement du CE à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute. En fusionnant le CE, les DP et les CHSCT, les ordonnances de 2017 marquent un nouveau tournant, plus négatif celui-là, en diminuant les moyens des représentants du personnel et certaines prérogatives du CE. Le CSE ne dispose toujours pas de règles clairement définies quant au calcul de son budget pour les activités sociales.
La majorité des entreprises du champ de la FCE-CFDT, en particulier les plus importantes, disposent pourtant de budgets conséquents pour leurs activités sociales. Pour la FCE-CFDT, dans cette période de crise, de montée des inégalités et de la pauvreté, il est important que les représentants du personnel et les organisations syndicales s’interrogent sur l’utilisation de leurs moyens. En priorisant, par exemple, les actions envers les salariés les moins rémunérés, les plus précaires dans leur entreprise, en améliorant leur quotidien, leur pouvoir d’achat. La mise en place d’activités culturelles et services divers, pour tous est aussi importante. Pour la FCE-CFDT, cette forme de solidarité ne doit pas s’arrêter aux portes de l’entreprise. Les moyens doivent aussi être offerts aux plus démunis y compris à l’extérieur de celle-ci. C’est ce que porte la CFDT dans le cadre du Pacte du pouvoir de vivre.