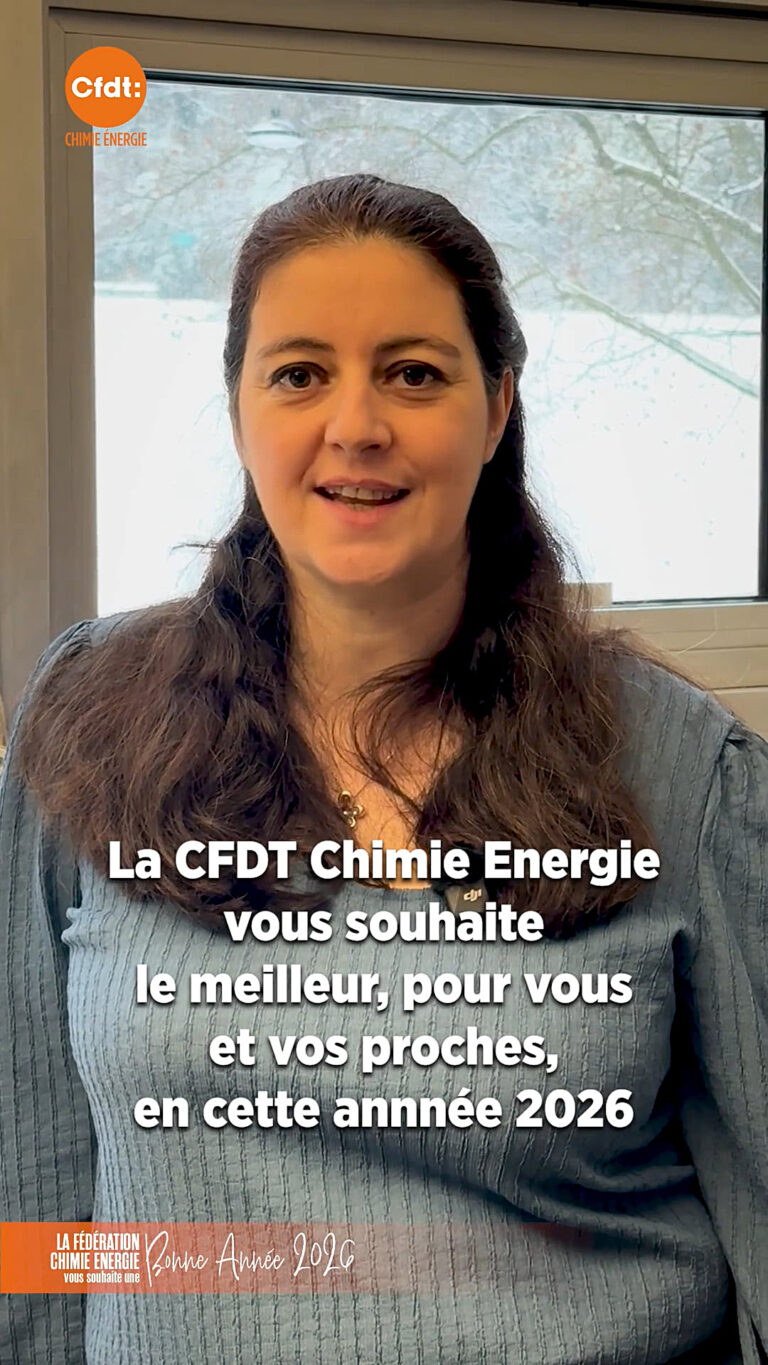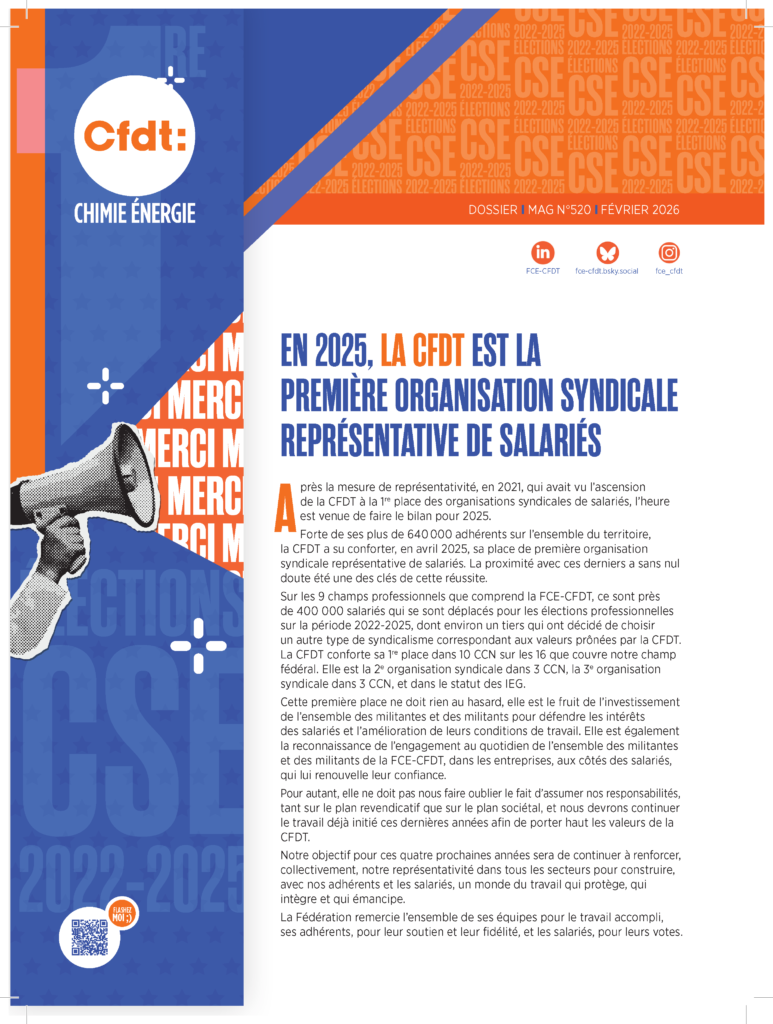Une délégation confédérale a été auditionnée par la Commission Roussely. Une bonne occasion de dire le point de vue de la CFDT sur la question du nucléaire civil et de son avenir.
Pour la CFDT, l’avenir de l’industrie nucléaire se place dans le cadre d’une intégration européenne renforcée : il n’y a pas d’espace pour une politique industrielle, encore moins pour une politique énergétique hors du cadre européen. Celle-ci doit également prendre en compte les enjeux du développement durable.
Acceptation par le public. La CFDT est très préoccupée de la tournure que prend le débat public sur les problèmes de société comportant une forte composante technico-scientifique. La question de l’acceptabilité par le public est aussi étroitement conditionnée à la responsabilité de l’Etat en tant que garant de l’intérêt général, notamment de la sûreté des installations et de la protection de l’environnement. Elle pose aussi la question de la sous-traitance. La CFDT demande le renforcement de la capacité de contrôle et de veille de l’Autorité de Sûreté nucléaire (ASN), la transparence de ses décisions et le respect absolu par les opérateurs de ses décisions. C’est notre responsabilité tant vis-à-vis des travailleurs concernés que du public.
En outre, de plus en plus d’opérateurs privés risquent d’intervenir, y compris au niveau de la production d’électricité. Il faut donc que le contrôle de la sûreté soit indépendant et sans faille et s’applique également à tous les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés.
Pour une meilleure acceptabilité du nucléaire par le public, et pour une meilleure sécurité des salariés, la CFDT demande la mise en place d’une autorité de sûreté européenne, ou au moins dans un premier temps de règles de sûreté communes et un agrément des autorités de sûreté nationales.
On rejoint ici le problème de la politique française et internationale et de la non-prolifération.
L’organisation industrielle en France et la place de l’Etat. Pour la CFDT, la répartition actuelle des tâches entre EDF et Areva semble satisfaisante : EDF maître d’œuvre et ensemblier pour la construction des centrales, puis exploitant et producteur d’électricité, Areva constructeur et maîtrisant l’ensemble du cycle du combustible de la mine au retraitement (la garantie de l’accès au combustible est essentielle).
Toute tentative de démantèlement du groupe Areva, aussi bien que sa prise de contrôle par EDF serait une mauvaise chose pour l’industrie nucléaire française et porterait atteinte à un des atouts principaux d’Areva qui est de répondre à des demandes multiples et complémentaires de ses clients.
La politique énergétique et la place du nucléaire. Pour la CFDT, il est nécessaire d’infléchir notre comportement de façon générale vers un mode de vie plus sobre en consommation d’énergie. C’est pourquoi la CFDT s’est prononcée en faveur d’une Contribution Climat Energie (CCE) s’appliquant à toute forme de consommation d’énergie, y compris électrique.
Aujourd’hui la France est pourvue de 58 réacteurs qui représentent une puissance installée de 63000 millions de watts (MW). Un réacteur nucléaire de type EPR (1 600 MW) est en construction à Flamanville. La demande française d’électricité augmente, parallèlement à la croissance industrielle, avec un taux légèrement plus faible, du moins tant que l’efficacité énergétique continue à s’améliorer. Le parc électronucléaire français produit aujourd’hui 75 % de notre électricité. Cette proportion d’électricité d’origine nucléaire dans le bilan français est encore trop importante par rapport à ce qui serait, selon la CFDT, souhaitable.
Quelle part pour l’électronucléaire en France ? Pour la CFDT, la part du nucléaire, tout en restant importante, doit passer à un niveau plus raisonnable que le taux atteint actuellement car une telle situation nous rend trop dépendant d’une technologie unique de production et, du fait des caractéristiques techniques des réacteurs nucléaires, ne permet pas d’utiliser le parc fra nçais dans les conditions économiques optimales. En effet, les centrales nucléaires ne sont pas bien adaptées aux variations rapides de la demande.
La France est plus sensible que d’autres aux pointes de consommation du fait notamment de la trop grande part du chauffage électrique, conséquence d’une politique à courte vue d’incitation à ce type de chauffage, qui a pour conséquence une augmentation de nos importations d’électricité (non nucléaire, donc émettrice de CO2) en périodes de basses températures.
A quand le renouvellement du parc ? Concernant le renouvellement du parc électro-nucléaire, plusieurs raisons plaident pour ne pas se précipiter. Le parc fra nçais de réacteurs est jeune, la question du renouvellement du parc électronucléaire français ne se pose pas donc avec urgence : 25 ans d’âge en moyenne. Le plus ancien réacteur (Fessenheim) date de 1977 et le plus récent n’a que 15 ans. Leur durée de vie prévue initialement pour 30 ans est en train d’être portée à 40 ans minimum. Le chiffre de 60 ans devrait se confirmer pour un nombre croissant d’unités. Même si la demande française d’électricité ira en augmentant dans les vingts prochaines années, il est possible sans altérer nos capacités de production d’utiliser le nucléaire, dans un marché ouvert et concurrentiel, de manière plus rentable et plus compétitive.
A terme, une utilisation progressive en base du nucléaire nous permettrait de retarder la construction de nouveaux réacteurs. Il faut y ajouter le fait que le remplacement de l’usine d’enrichissement d’uranium Eurodif, plus gros consommateur d’électricité en France, par l’usine Georges Besse II utilisant le procédé de l’ultra-centrifugation, beaucoup plus économe en énergie, rendra disponible l’équivalent de la production de deux ou trois tranches nucléaires. En outre, l’amélioration du taux de disponibilité des centrales (tout en priorisant un niveau de sûreté optimum) doit permettre de gagner encore l’équivalent de plusieurs tranches nucléaires. En tout état de cause le nucléaire doit continuer à jouer un rôle important (de l’ordre de 60 à 70%) dans l’approvisionnement français en électricité pour des raisons notamment de compétitivité, de sécurité d’approvisionnement et d’indépendance énergétique. Il faut engager une réflexion sur l’ensemble de la filière nucléaire, en particulier dans le domaine de la recherche technologique. La France a les équipes et les compétences pour engager les études nécessaires à la quatrième génération dans le cadre d’une coopération internationale. Par ailleurs, la CFDT s’oppose à un suréquipement délibéré relativement aux besoins français dans l’objectif de poursuivre une politique d’exportation massive d’électricité nucléaire. Or environ 10 à 15 % de notre production électro-nucléaire sont exportés, soit l’équivalent de la production de 6 à 8 réacteurs. Si l’Europe ne peut se passer du nucléaire, pour autant ce n’est pas à la France de pallier aux besoins des autres pays européens, et de cumuler sur son territoire l’ensemble des problèmes éthiques, politiques, sociétaux, environnementaux que pose la gestion du nucléaire et de ses déchets.
Un schéma analogue à la loi Bataille sur les déchets définissant des axes de recherche et une évaluation permanente par une commission indépendante du type de la Commission Nationale d’Evaluation (CNE) pourrait contribuer à préparer des décisions raisonnées et démocratiques.
Les directives européennes. Enfin la mise en application de la directive européenne qui impose à la France de porter à au moins 12 % la proportion d’énergie renouvelable dans le bilan énergétique total et à au moins 21 % dans le bilan électrique, oblige à développer l’éolien, le solaire photo-voltaïque, la biomasse, etc. La CFDT partage les mesures prises par l’Europe et approuve les dispositifs de soutien économique et réglementaire mis en place pour encourager les énergies renouvelables. Les nouveaux besoins en électricité devront donc être assurés notamment par des énergies renouvelables.