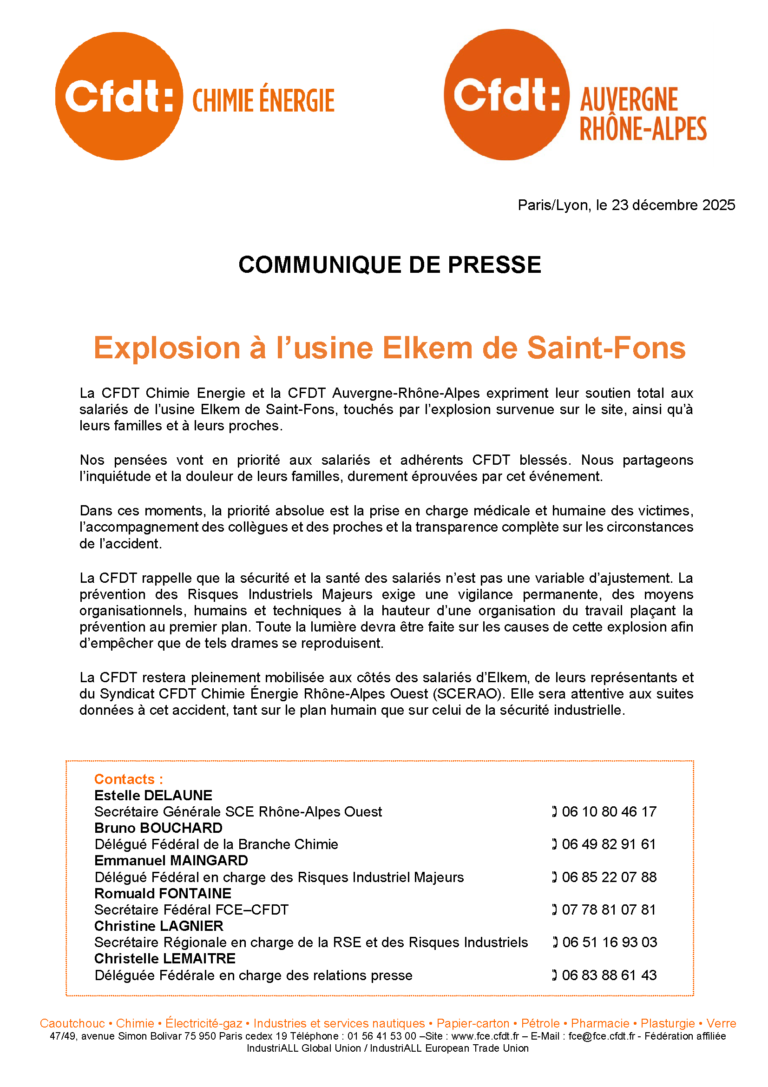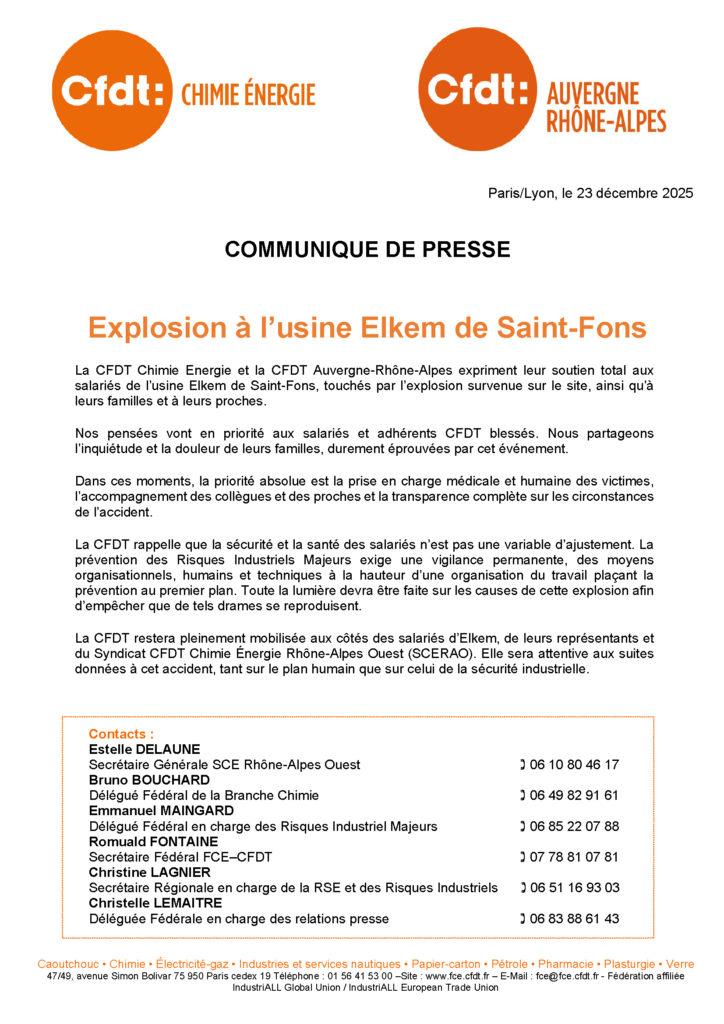Le Tribunal des prud’hommes est une instance de justice paritaire de premier degré des litiges qui découlent de l’exécution ou la rupture du contrat de travail entre employeurs et salariés, dépendant du droit privé.
Ce conseil judiciaire a une longue histoire derrière lui, les prémices remontent au Moyen Age où le prud’homme, qui voulait dire en vieux français « homme prudent », désignait des professionnels de bons conseils chargés de régler les conflits entre artisans. C’est Napoléon Bonaparte qui légifère pour la première fois afin de créer le premier Tribunal des prud’hommes à Lyon en 1806. C’est seulement en 1848, sous la deuxième République, que ces tribunaux prennent vraiment forme, avec l’apparition du paritarisme.
Les Conseils de prud’hommes s’ancrent dans le paysage social et judiciaire et vont connaître un certain nombre d’évolutions. En 1908, les femmes deviennent enfin éligibles au tribunal avec la loi des prud’femmes, et il faudra attendre la loi Boulin de 1979 pour que l’institution se généralise sur les territoires et les branches d’activités avec des mandats électoraux fixés à 5 ans.
Le Conseil est renouvelé par le biais d’élections qui malheureusement connaissent un taux d’abstention record. Ces élections servent aussi à évaluer la représentativité des différentes organisations jusqu’en 2008. La loi d’août 2008 va marquer une rupture, les élections sont supprimées et le Parlement légifère pour proroger les mandats jusqu’en 2017. La CFDT attend maintenant de l’Etat qu’il inscrive dans le marbre le fait de s’appuyer sur les élections de représentativité dans les entreprises pour fixer le nombre de conseillers par organisations syndicales et patronales.
La loi activité et croissance dite « loi Macron » s’est aussi penchée sur l’évolution de l’instance avec deux objectifs partagés par la CFDT : rendre la justice prud’homale plus qualitative et réduire le délai de traitement des affaires. Il en ressort une réforme où les règlements à l’amiable des litiges sont encouragés et les missions du bureau de conciliation sont confortées. Un autre point positif est la création d’un statut protecteur du défenseur syndical, une vieille revendication CFDT, avec l’octroi d’heures de délégations rémunérées, et d’un droit à la formation.
Convaincue qu’il reste des progrès à faire pour rendre cette institution plus efficiente notamment en lui donnant plus de moyens, la CFDT continuera à œuvrer pour garder cette spécificité unique en Europe.