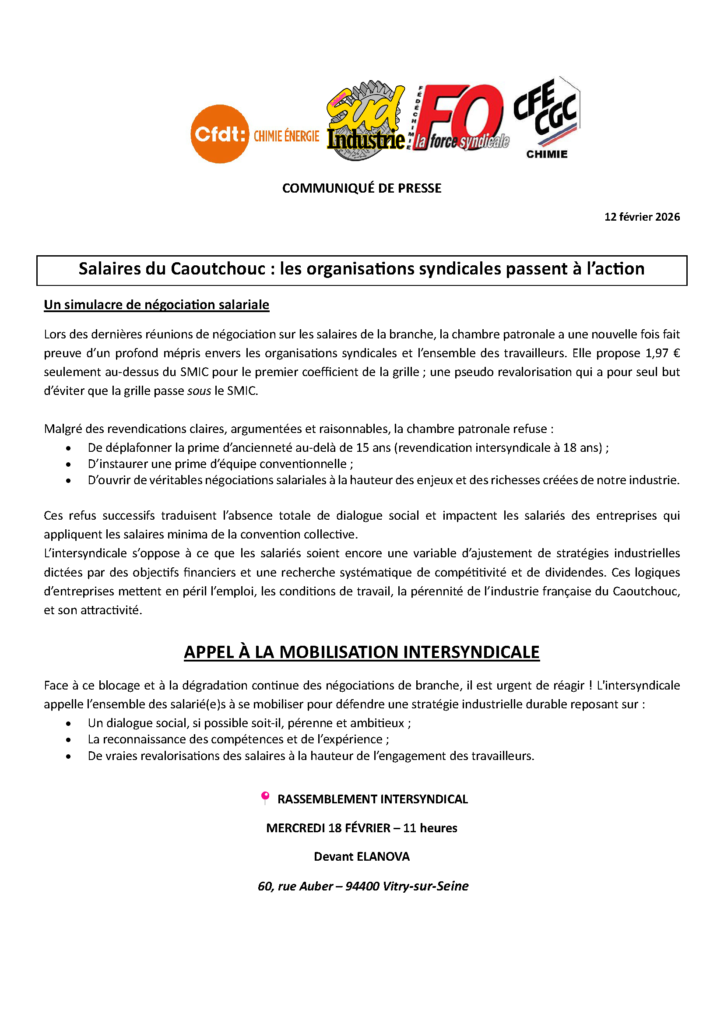On a beaucoup parlé d’énergie en France, cet été. En effet, le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a présenté les grandes orientations de son Plan Climat, le
6 juillet. Parmi les 23 axes de ce plan, on retiendra l’annonce que la France vise la neutralité carbone en 2050, c’est-à-dire l’équilibre entre les émissions et les absorptions de CO2, par exemple par les forêts. Cette démarche fait suite à l’Accord de Paris sur le climat visant à limiter la hausse des températures terrestres en dessous de 2 °C. La fin de la vente des véhicules à essence et au diesel à l’horizon 2040, ou encore la fermeture des centrales thermiques au charbon, d’ici à fin 2022, s’inscrivent dans la même logique. Les modalités précises de ces mesures n’ont pas été détaillées, le ministre ayant toutefois évoqué la mise en œuvre de contrats de transition écologique pour favoriser le reclassement optimal des salariés. La FCE demandera à négocier rapidement ces contrats dans tous les secteurs impactés par la transition énergétique, afin d’anticiper les reconversions professionnelles et territoriales. Plus largement, le ministre a inscrit son action dans la continuité de son prédécesseur, en reprenant à son compte la loi de transition énergétique, adoptée en 2015. La prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie, prévue avant la fin 2018, sera déterminante pour confirmer la feuille de route et l’atteinte des objectifs de la loi. La FCE, en lien avec la Confédération, fera entendre ses revendications dans le débat, notamment sur l’avenir de la filière nucléaire. Dans l’immédiat, il est à noter que Nicolas Hulot place l’action de la France résolument dans le cadre européen, en souhaitant mobiliser nos partenaires dans son ambition climatique et écologique. La FCE suit cette approche avec intérêt, car la dimension européenne de l’énergie a souvent été absente dans les discussions récentes en France.
C’est dans ce contexte favorable que la FCE a rencontré, en juillet, Thomas Pellerin-Carlin, chercheur à l’Institut Jacques Delors, pour un échange très riche sur l’Europe de l’énergie et ses perspectives. Un premier constat : malgré des processus parfois lourds et compliqués, l’Europe de l’énergie, ça fonctionne ! Par exemple, l’Union européenne a d’ores et déjà atteint, et même dépassé, les objectifs du paquet Energie-Climat 2020, en matière d’efficacité énergétique ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle est en bonne voie pour tenir la cible de 20% d’EnR dans la consommation finale d’énergie. Autre réussite de l’Europe, la sécurité d’approvisionnement a progressé. L’Union est moins dépendante qu’on ne le dit de la Russie pour la fourniture de gaz, ou de l’Arabie saoudite pour le pétrole. Mais des avancées considérables pourraient être obtenues si des mécanismes réellement communs à tous les Etats membres étaient mis en œuvre, par exemple, modalités identiques de soutien aux EnR ou de réglementation sur la consommation des appareils électriques. Malheureusement, les Etats sont souvent trop frileux à abandonner des pans de souveraineté dans ces domaines. Autre note encourageante, l’énergie est l’un des rares sujets pouvant réunir l’ensemble des 27 pays de l’Union. Dans ces conditions, un accord global sur l’Union de l’énergie pourrait être un objectif atteignable en 2018, incluant un important volet social pour accompagner les salariés dans la transition et favoriser la création d’emplois de qualité. Last but not least, selon Thomas Pellerin-Carlin, la politique industrielle, fondée sur l’innovation, n’est plus un gros mot à la Commission européenne. C’est un changement radical et bienvenu sur lequel la CFDT, en lien avec la Confédération européenne des syndicats (CES) doit s’appuyer pour donner des perspectives positives aux salariés européens.