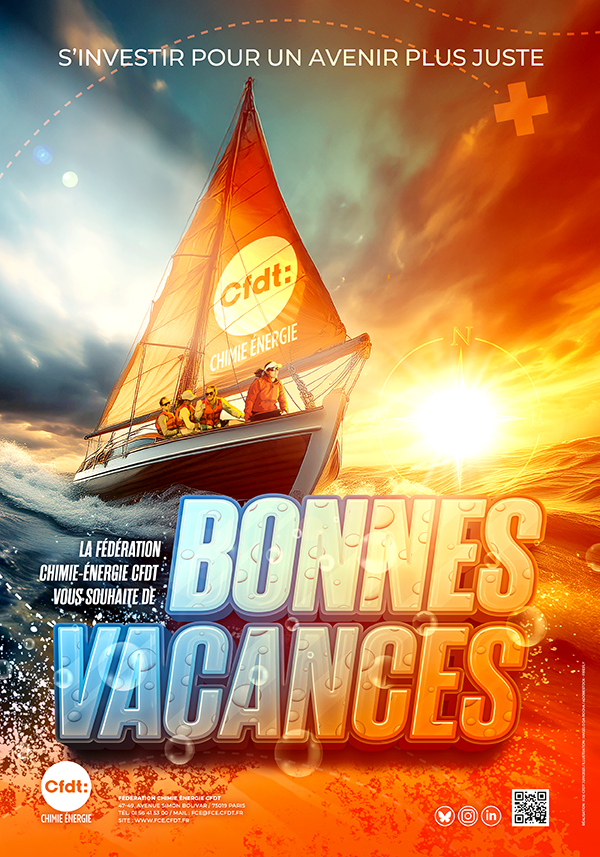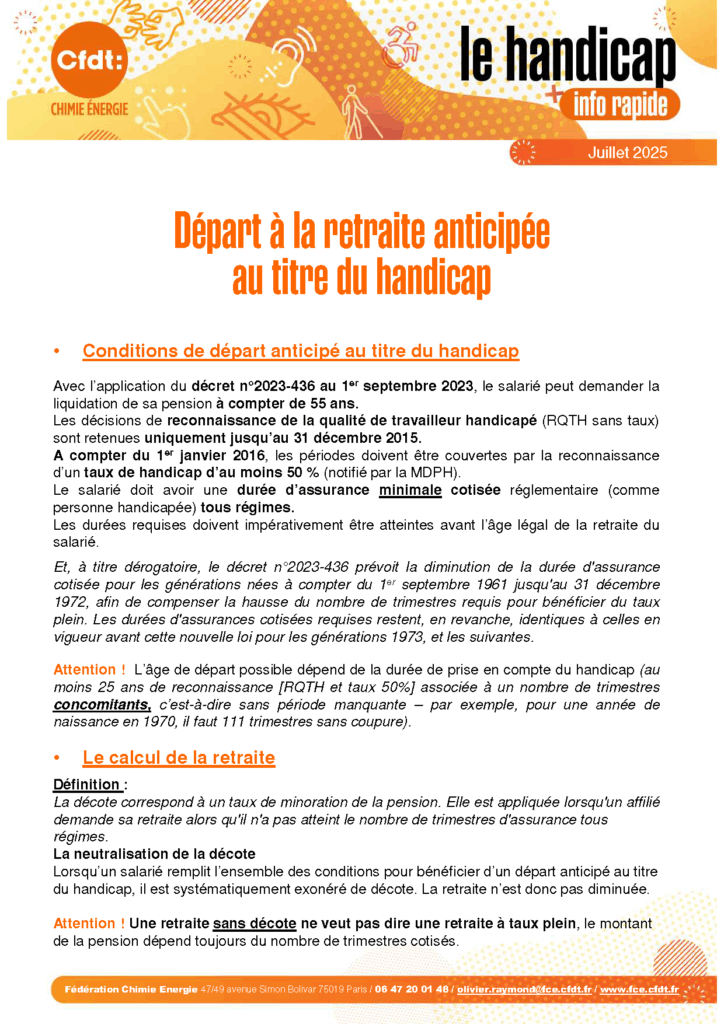L’amiante est un minéral exceptionnel dont les fibres conjuguent plusieurs qualités rares : la résistance au feu, aux agressions chimiques, à la traction mécanique, et la capacité à être tissées. Une autre de leurs particularités est de constituer une poussière microscopique, d’une dureté de roche. Des millions de fibres d’amiante tiendraient dans une tête d’épingle. Elles sont en effet si minuscules que les poils des narines ne peuvent les arrêter. Chez les personnes qui se trouvent à leur contact, les fibres viennent se loger directement dans la plèvre et les poumons. Elles s’y entassent alors et les sclérosent.
Il existe plusieurs façons de mourir de l’amiante. En tombant malade d’asbestose (invasion des poumons par les fibres d’amiante), maladie évolutive qui ressemble à d’autres maladies causées par les poussières. En contractant un cancer broncho-pulmonaire, dont l’amiante n’est pas le seul facteur de risque. En contractant enfin un mésothéliome, cancer spécifique de l’amiante où la tumeur maligne des surfaces mésothéliales touche principalement la plèvre. Tous les experts s’entendent aussi
pour dire que l’agonie des malades s’accompagne d’horribles souffrances. Douleurs extrêmes, quasi-paralysie, étouffement. Même la morphine ne peut alors rien y faire.
Avec 71 procédures venant de toute la France, l’amiante est, de loin, en 2006 le dossier le plus important du Pôle de Santé publique du Tribunal de Paris.
Ceux qui aujourd’hui meurent de l’amiante ont pourtant longtemps vécu dans l’insouciance. Il peut en effet se passer plus de trente ans avant que les symptômes de la maladie ne se déclarent. Combien de salariés ont alors côtoyé cette matière, sans même savoir que les poussières d’amiante, dans lesquelles ils exécutaient leur travail du matin jusqu’au soir, les mèneraient vers une mort certaine ? Qui plus est, c’est à chaque fois tous les membres de la famille qui sont touchés, puisque l’amiante entre dans le foyer. Il est alors difficile de mesurer avec précision encore aujourd’hui le nombre réel de victimes que cause ce drame.
Avec 71 procédures venant de toute la France (35 à l’instruction, 23 en enquête préliminaire et 13 en attente d’examen par le parquet), l’amiante est, de loin, en 2006 le dossier le plus important du Pôle de Santé publique du Tribunal de Paris. La mise en cause des industriels de l’ancien Comité permanent Amiante (CPA) qui s’était employé à retarder au maximum l’interdiction de la fibre, pourrait être envisagée. Comme celle d’ailleurs de responsables sanitaires et administratifs.
Contrairement à l’affaire du sang contaminé, le danger de l’amiante est connu de longue date. En 1906, un document de l’Inspection du Travail (Rapport Auribault) mettait déjà en demeure les industriels et les sommait de mettre en place des dispositifs de protection, reprenant ainsi un décret de 1894. On comptait alors par milliers les entreprises concernées car l’amiante, par sa vertu isolante, était quasiment irremplaçable. Peu à peu, des précautions étaient prises. Les ouvriers étaient censés s’équiper de masques, les ateliers d’aspirateurs et de filtres. La corrélation entre exposition à l’amiante et risque de cancer du poumon est évoquée dès 1935, et établie pour le mésothéliome en 1960. En 1977, un premier décret légifère spécifiquement sur l’amiante, puis une décision gouvernementale en interdit l’usage en 1996. Des usines se reconvertissent, d’autres ferment ou licencient.
Des associations fédérées par l’Association nationale de Défense des Victimes de l’Amiante se mettent en place pour aider les personnes concernées à se constituer parties civiles. Trois cercles de responsabilité sont mis en cause. D’un côté, les industriels de l’amiante-ciment, comme Eternit et Everite, ainsi que les entreprises transformatrices spécialisées dans le tissage d’amiante ou dans les garnitures de freins et d’embrayages, comme Ferodo. D’un autre côté, les organismes consommateurs d’amiante, comme les chantiers navals et les arsenaux. A travers eux, c’est ici l’Etat qui est concerné. Enfin, les entreprises qui ont été amenées à utiliser l’amiante parfois à leur insu, en particulier dans le bâtiment.
En 1982, l’Association française de l’Amiante, qui regroupe les industriels de l’amiante, crée le Comité permanent Amiante. Ce comité, groupe informel sans pouvoir et sans statut, officiellement créé par Dominique Moyen, directeur général de l’Institut national de Recherche et de Sécurité, va de fait diriger la politique sanitaire française pour l’amiante. Ce comité comprendra le Pr. Jean Bignon et son successeur, le Pr. Patrick Brochard, qui dira par la suite s’être fait piéger : « On ne sait pas faire sans amiante… tout le monde croyait les industriels… ». Ce comité, dont le financement sera entièrement dépendant des industries qui paieront entre autres tous les frais de déplacements, comprendra aussi des délégués des principales organisations syndicales qui défendront longtemps l’usage de l’amiante au nom de la préservation de l’emploi. Très tôt, la Fédération unifiée de la Chimie (Fuc) déposera une plainte organique contre ce scandale. Mais il faudra attendre 2004 pour que le Conseil constitutionnel reconnaisse la responsabilité de l’Etat en la matière.
A l’analyse, il reste évident que les besoins de la recherche, de la prévention, de la médecine du travail – structure fondamentale et particulière à la France – ne sont pas à la hauteur du scandale. Il nous faut donc tout faire pour replacer la santé au travail au cœur de la santé publique et de notre action syndicale.