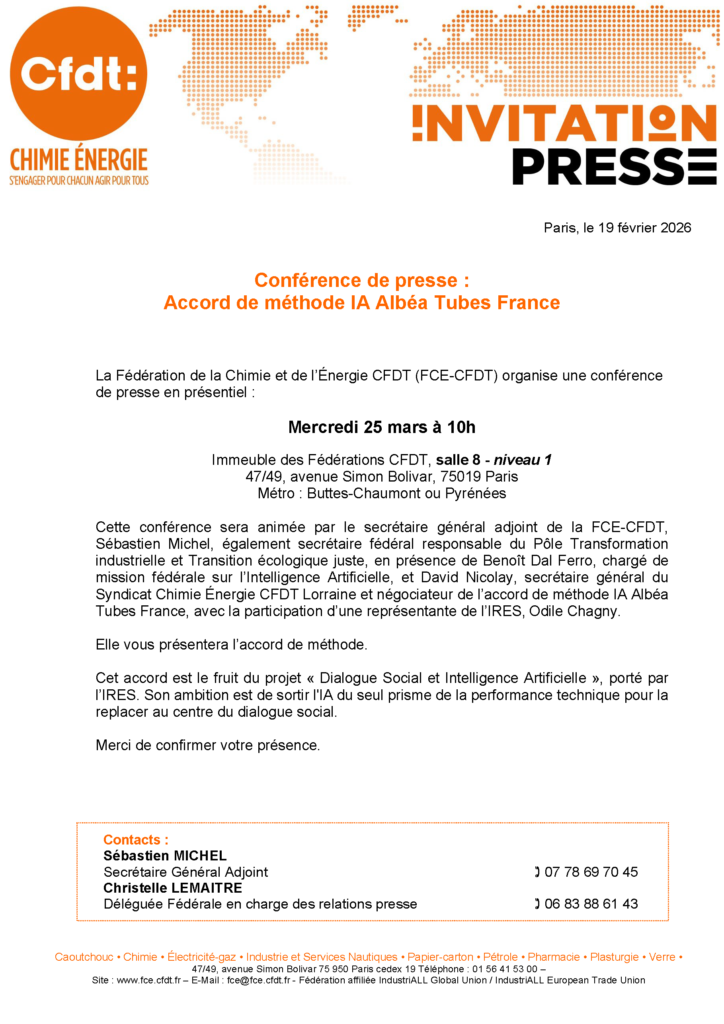L’image de l’industrie pharmaceutique est mauvaise actuellement. Les événements récents y ont contribué, comme le procès intenté par 39 multinationales pharmaceutiques à l’Afrique du Sud sur les génériques antisida. En conciliant protection de brevets et priorité à la santé publique en cas d’urgence, Doha a amené une nouvelle donne, mais appelle une nouvelle étape selon la FCE-CFDT.
L’industrie pharmaceutique connaît une croissance régulière dont les facteurs sont connus : vieillissement des populations, demande grandissante de meilleure santé dans les pays industrialisés, innovations fréquentes (avec de plus en plus de molécules issues des biotechnologies), etc.
Les profits sont importants, et le contexte ne se prête vraiment pas à l’action menée en avril dernier, à l’encontre de l’Afrique du Sud. Rappelez-vous : trente-neuf des principales multinationales pharmaceutiques faisaient un procès au gouvernement sud-africain désireux de soigner les victimes du Sida par des génériques à coût nettement moins élevé. Comment auraient-ils pu être compris ?
L’action internationale a fini par payer
Avec actuellement vingt millions de séropositifs avérés en Afrique subsaharienne, la pandémie atteint un niveau qu’il est crucial de combattre ! Menée par « Médecins sans frontière » principalement, l’action internationale a fini par payer : le tollé général a débouché sur un retrait de la plainte et une baisse drastique des prix.
La grande peur des industriels est évidemment la perte de la protection sur les brevets, qui risquerait d’avoir un impact négatif sur les investissements en recherche.
Une nouvelle molécule, innovante, coûte aujourd’hui, en moyenne, 300 à 400 millions de dollars ! Les accords de l’Organisation mondiale du commerce conclus à Doha (Qatar) préservent la durée de protection des brevets, mais permettent des exceptions spécifiques si on est face à un problème majeur de santé publique. Même les Etats-Unis ont œuvré pour cette avancée réelle. Il faut dire qu’ils venaient d’exiger des prix d’ami sur le Cipro de Bayer, pour lutter contre une éventuelle guerre bactériologique (à l’anthrax). La clause d’exception vise non seulement le Sida, mais aussi le paludisme et la tuberculose. Elle prévoit le cas du bioterrorisme.
La FCE-CFDT a communiqué sur les événements de Pretoria et Doha. Elle regrette que les décisions n’aillent pas assez loin. Ainsi, le recours aux génériques ne sera pas possible avant 2003 pour les pays n’ayant pas d’implantation pharmaceutique. Au Botswana, où l’espérance de vie a été quasiment divisée par deux depuis une décennie, la population doit-elle être laissée à l’abandon encore près de deux ans ?
Demande d’une conférence européenne
La branche pharmacie a abordé ce sujet le 5 décembre 2001 à la demande de la CFDT. Le Syndicat national de l’industrie pharmaceutique a élargi le rapport annuel (sur l’emploi et les salaires) aux problèmes éthiques et à la politique du médicament.
De même, nous demandons au niveau de notre fédération européenne (Emcef) la tenue d’une conférence européenne permettant de préciser nos positionnements sur ces sujets. Nos camarades allemands devraient nous soutenir. Ils viennent de constater qu’ils ne seraient plus couverts en vaccins antivarioliques en cas de bioterrorisme !
Au-delà des prix bas, les fonds de l’Onu et la contribution des pays développés s’imposent : il manque aujourd’hui environ 7 milliards de dollars pour couvrir les besoins essentiels de traitement en Afrique. Avec l’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef, l’industrie a, selon la CFDT, sa contribution à apporter dans le combat pour le développement durable en matière de santé publique.









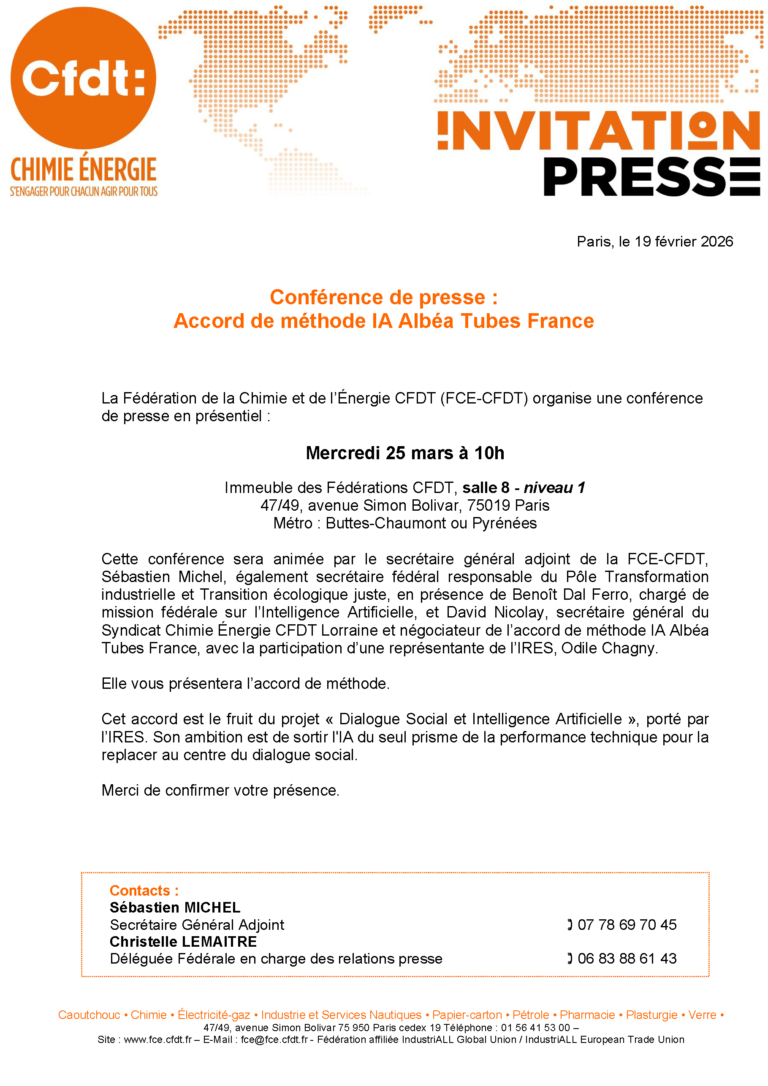



 L'image de l'industrie pharmaceutique est mauvaise actuellement. Les événements récents y ont contribué, comme le procès intenté par 39 multinationales pharmaceutiques à l'Afrique du Sud sur les génériques antisida. En conciliant protection de brevets et priorité à la santé publique en cas d'urgence, Doha a amené une nouvelle donne, mais appelle une nouvelle étape selon la FCE-CFDT.
L'image de l'industrie pharmaceutique est mauvaise actuellement. Les événements récents y ont contribué, comme le procès intenté par 39 multinationales pharmaceutiques à l'Afrique du Sud sur les génériques antisida. En conciliant protection de brevets et priorité à la santé publique en cas d'urgence, Doha a amené une nouvelle donne, mais appelle une nouvelle étape selon la FCE-CFDT.