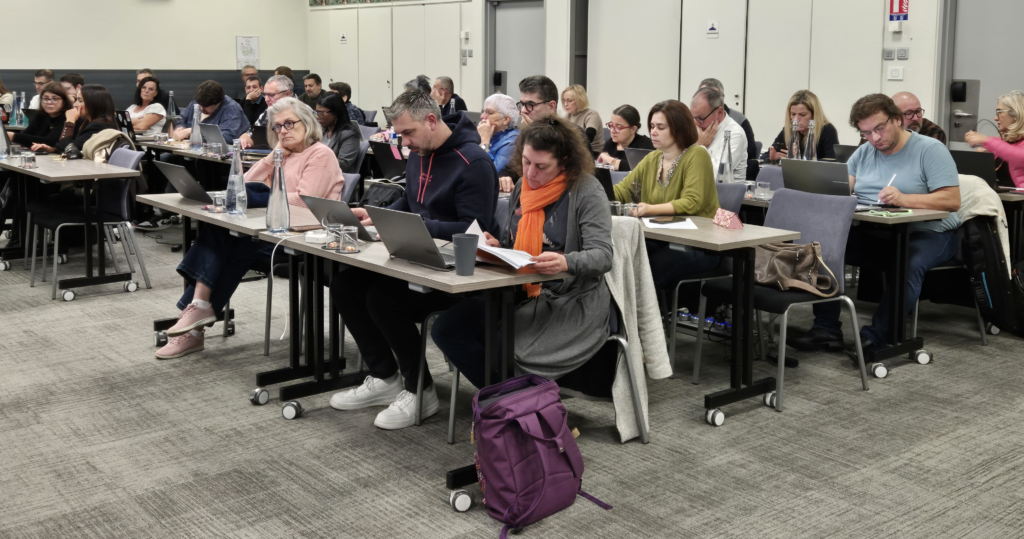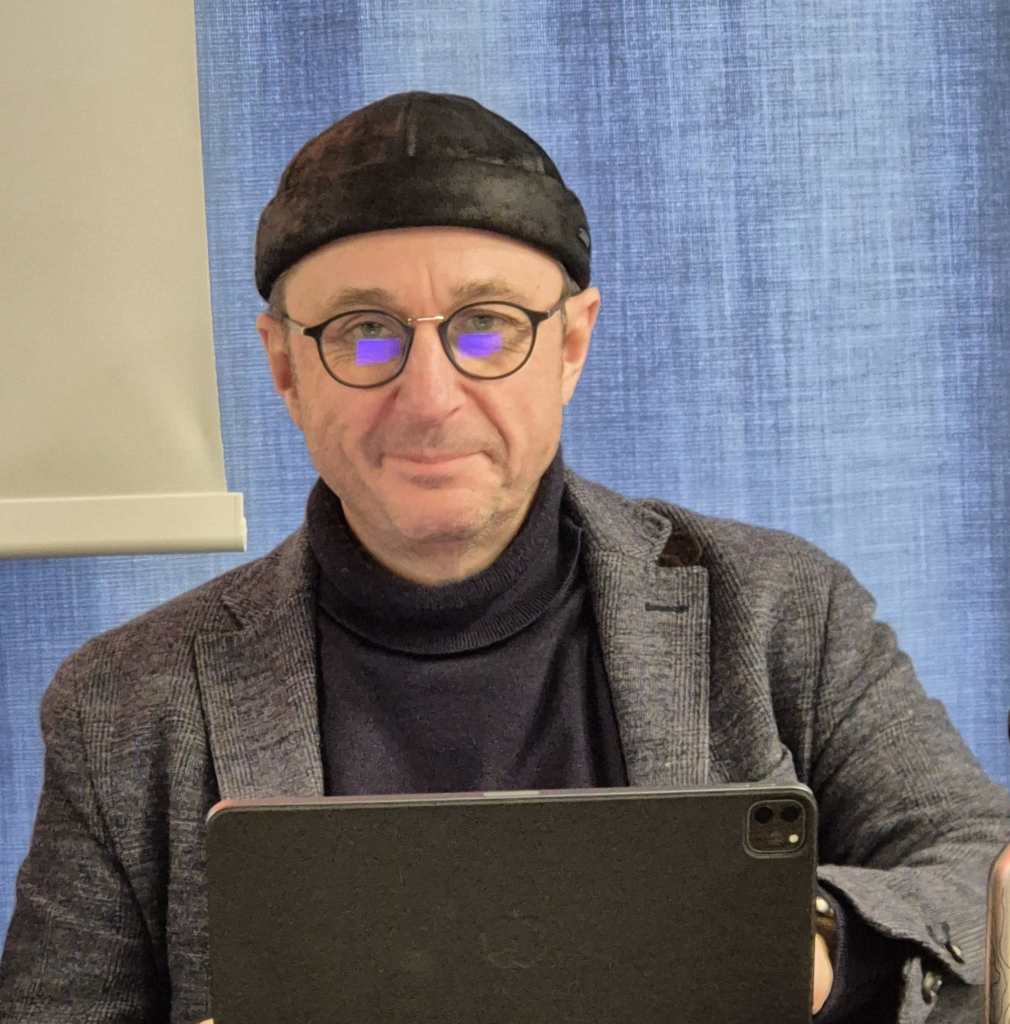L’année 2007 résoudra-t-elle la question du logement ? Loin des discours et des vœux pieux, CFDT Magazine Chimie Energie revient sur deux rencontres auxquelles la fédération a participé en décembre dernier.
Hiver 1954. Une femme venait de mourir à Paris. En ce milieu de 20e siècle, on pouvait mourir dans la rue, faute de logement. L’appel de l’Abbé Pierre alors lancé aux Français créait un large mouvement de générosité et de solidarité. Il fallait aussi construire des logements sociaux… Cinquante années plus tard, on meurt encore dans la rue. Les Enfants de Don Quichotte, qui en décembre dernier ont planté près de trois cents tentes le long du Canal Saint-Martin à Paris, sont là pour nous rappeler que la fracture sociale perdure malheureusement. Et que le modèle social français reste à parfaire. Les Restos du Cœur existent encore vingt ans après leur création. Si le tiers monde est peut-être à l’autre bout de la planète, le quart monde est bien au coin de notre rue. Trop de lâcheté que le mois de décembre caricature dans une consommation effrénée. D’un côté, ceux qui achètent sans compter. De l’autre, ceux qui comptent le peu dont ils disposent. La société n’est décidément pas équitable.
Le taux de chômage, qui reste élevé quoiqu’on en dise, ne peut servir d’alibi à ceux qui ne veulent rien changer, ni rassurer ceux qui sont dans la galère aux portes des entreprises et de l’emploi. Ne perdons pas non plus de vue qu’on peut aujourd’hui travailler, être salarié, et pour autant ne pas pouvoir se loger. Selon une étude de l’Insee, 28 % des personnes sans-domicile ont effectivement un travail !
Faut-il alors lire les vœux de Jacques Chirac comme la traduction d’un engagement sincère, ou plutôt la préoccupation d’une fin de règne, voire un engagement provocateur qu’il n’aura pas à tenir lui-même ? Sans attendre les réponses des responsables politiques et de l’Etat, essayons avec la CFDT d’en apporter d’autres par les entreprises.
?La démocratie, ce n’est pas qu’un bulletin dans l’urne. C’est aussi l’égalité des conditions, où chacun est utile. Car de l’utilité naît
la dignité. A ce titre, les entreprises d’insertion servent d’exemple en termes de prise de parole et de gouvernance.
Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France
Extrême pauvreté et emploi décent. Le 11 décembre dernier, une rencontre sur ce thème s’est tenue à Paris au siège du Conseil économique et social (CES). La fédération y était. Une journée pour mesurer l’action de la France dans la lutte contre l’extrême pauvreté. Une occasion aussi pour le Président du CES de rappeler la Déclaration du Millénaire, adoptée le 8 septembre 2000 par l’Assemblée générale des Nations Unies. 191 pays y affirmaient leur détermination « à assurer, dans tous les pays, la promotion et la protection intégrale des droits civils, économiques, sociaux et culturels de chacun et à ne ménager aucun effort pour délivrer hommes, femmes et enfants de la misère, phénomène abject et déshumanisant qui touche plus d’un milliard de personnes ». Et pour cela, huit objectifs essentiels sont à atteindre d’ici 2015. Ce 11 décembre, un bilan d’étape au tiers du parcours a été dressé quant à l’atteinte du premier objectif : réduire de moitié la pauvreté et la faim dans le monde. Mais force est de constater qu’au regard des avancées, aucun des huit objectifs ne sera atteint en 2015…
Le débat, qui a réuni organisations non gouvernementales, syndicalistes et représentants du gouvernement, a aussi donné l’occasion aux délégués venus d’Inde et du Sénégal de témoigner de leurs actions locales respectives. Beaucoup ont insisté sur le rôle que doivent tenir les organisations syndicales au plus près des salariés pour faire de la revendication d’un emploi décent une réalité.
L’économie solidaire, c’est possible ! Quelques jours plus tôt, le 7 décembre, à l’initiative de l’association France Active, un millier de personnes s’est retrouvé à Paris, dans les locaux de la Mutualité. Objectif, soutenir le lancement d’une campagne de sensibilisation dans le cadre d’un Manifeste de l’Economie solidaire. La fédération y était déjà.
Une rencontre qui a commencé par le témoignage de l’association Au fil de l’Eau, entreprise solidaire qui emploie des personnes en difficulté et qui propose de réels services (tourisme fluvial ou transbordement entre les rives de la Marne). Pour les nouveaux salariés, anciens chômeurs et trop longtemps exclus, c’est une révélation. « On nous fait confiance… J’ai réappris à dire bonjour… J’ai maintenant des projets. » Et il existe des milliers d’initiatives comme celle-là. A chaque fois, il s’agit de produire, consommer, employer, épargner et décider autrement. Une façon de produire à la fois de la valeur ajoutée marchande et de la valeur sociale. Car comme le souligne le Manifeste, « le profit ne peut être la finalité unique de l’activité économique ».
Si certaines activités de l’économie solidaire sont maintenant bien connues (entreprises adaptées aux personnes handicapées, aide aux personnes, recyclage, ou encore protection de l’environnement), des domaines nouveaux sont aujourd’hui explorés. L’insertion par l’activité économique, qui remet au travail des chômeurs de longue durée, emploie entre 250 000 et 300 000 personnes. C’est une économie de proximité dont les emplois ne peuvent être délocalisés. Une économie qui s’inscrit dans la tradition du mouvement ouvrier et celle des mutuelles, coopératives et associations, et qui aspire à une société d’hommes libres et égaux en droits.
Quant au Manifeste, il invite les organisations syndicales, comme les salariés, à développer l’épargne solidaire : une garantie d’orienter une partie de son épargne pour le financement d’entreprises solidaires.
La pauvreté des travailleurs en Europe
En 1995, lors d’une enquête menée par la fédération sur le temps de travail, les salariés interrogés sur les aspects salariaux répondaient que le niveau des bas salaires se confondait au montant de leur propre salaire. Une façon de dire que l’on se sent tous pauvres, ou presque. Mais que devient ce
ressenti une fois passé au filtre des mesures européennes ?
Depuis 2003, la réduction du nombre de travailleurs pauvres est une priorité européenne. A cette fin, une série d’indicateurs a été créée afin de mesurer et de comparer les différentes réalités à travers toute l’Europe. On a ainsi pu observer que l’Europe des Quinze comptait en 2001 un peu plus de onze millions de travailleurs vivant dans un foyer pauvre, soit un taux de 7 %. Avec un taux de 8 %, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne. Triste performance… Les indicateurs comportent cependant certaines limites inhérentes aux difficultés de la comparaison internationale. En particulier le seuil de pauvreté, calculé à partir du niveau de vie national, est très variable selon les pays. En 2001, on est pauvre avec 4970 euros par an au Portugal, 8770 euros en France, et 14380 ? au Luxembourg.
La notion de « travailleur pauvre » a, elle aussi, été définie. Elle a donné lieu à la création d’un indicateur de pauvreté, afin de réaliser un étalonnage des Etats membres et d’effectuer un suivi de l’impact des politiques nationales sur l’inclusion sociale. Ainsi, le travailleur pauvre est une personne vivant dans un ménage pauvre au sens monétaire du terme (revenu par personne inférieur à 60 % du revenu médian national). Il doit aussi avoir été « en emploi » plus de sept mois au cours de l’année précédente.
Selon le Centre d’Etudes de l’Emploi, la pauvreté des travailleurs est transitoire dans les Etats où le niveau de pauvreté est faible. Elle est persistante dans les pays du Sud et dans une moindre mesure en France. La pauvreté dépend d’abord de la rémunération (durée du travail et taux horaire). Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les bas salaires résultent principalement de l’emploi à temps partiel, très répandu chez les femmes. En Espagne et en Grèce, ils résultent davantage du faible taux horaire. Quant au revenu des ménages, il dépend de la part apportée par chacun.
La bi-activité des ménages semble constituer une protection importante contre la pauvreté.