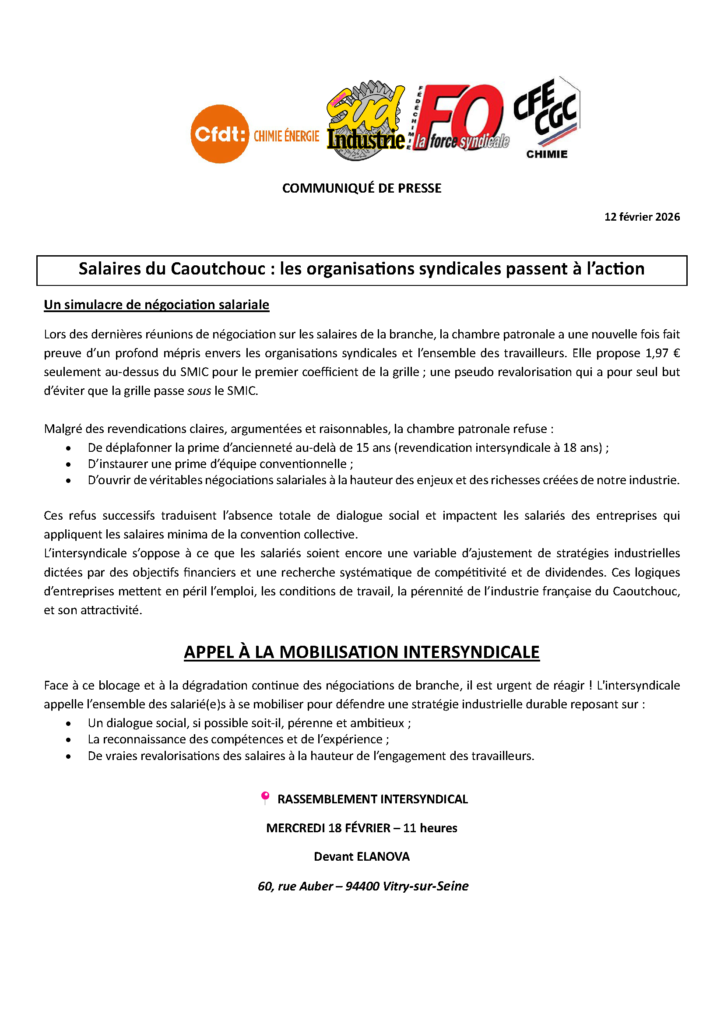Le droit de grève est une cessation concertée du travail par des salariés dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle.
En France, c’est un droit fondamental inscrit dans la Constitution depuis 1946, fruit d’une longue conquête depuis le XIXème siècle. En effet, la grève, durant une bonne partie du siècle de la révolution industrielle, était interdite et un délit pénalement sanctionnable. La loi du 25 mai 1864 dite loi Ollivier mit fin à ce délit de coalition sans pour autant protéger le salarié d’un licenciement ou d’une intervention de la force armée qui bien souvent pouvait être sanglante et faire des victimes. Cet état de fait a duré jusqu’à la libération en 1945, mais il n’a pas empêché les salariés de faire grève tout au long de la IIIème république et de gagner de nouveaux droits sociaux malgré les risques encourus. La plus emblématique des grèves étant l’occupation des usines après la victoire du Front Populaire en 1936, ce qui a abouti aux congés payés et à la semaine de 40 heures.
Depuis 1946, le droit de grève est inscrit dans le préambule de la Constitution, mais certaines catégories de personnel ne peuvent pas l’exercer, les Compagnies Républicaines de Sécurité, les personnels de police et les magistrats. Ce droit fondamental a aussi fait l’objet depuis 1950 d’aménagements par le législateur, au nom de la libre circulation des biens et des personnes ou de la sécurité des citoyens. Ainsi, un service minimum a été institué dans certains secteurs, le contrôle aérien, l’audiovisuel public, les hôpitaux, le nucléaire et plus récemment les transports. Il a aussi fait l’objet de restrictions à sa mise en œuvre, par exemple les grèves tournantes ou perlées sont strictement encadrées voire interdites.
En Europe, ce droit est attaqué et souvent mis à mal, notamment en Hongrie, ou en Pologne sous l’effet de régimes populistes, ou en Grèce sous la pression de la Troïka et des forces financières. La période que nous vivons actuellement se prête malheureusement à la tentation de régression sociale, au nom de la liberté de travailler ou d’entreprendre, sous la pression de lobbying financier et/ou extrémiste. Il faut donc être vigilant à ce que cette liberté
fondamentale ne soit pas remise en cause. En France, face à ceux qui veulent remettre en débat les conditions de mise en œuvre de la grève, la CFDT réaffirme son attachement à ce droit, un droit démocratique gagné de haute lutte, qui reste indispensable quand les voies du dialogue ont échoué.