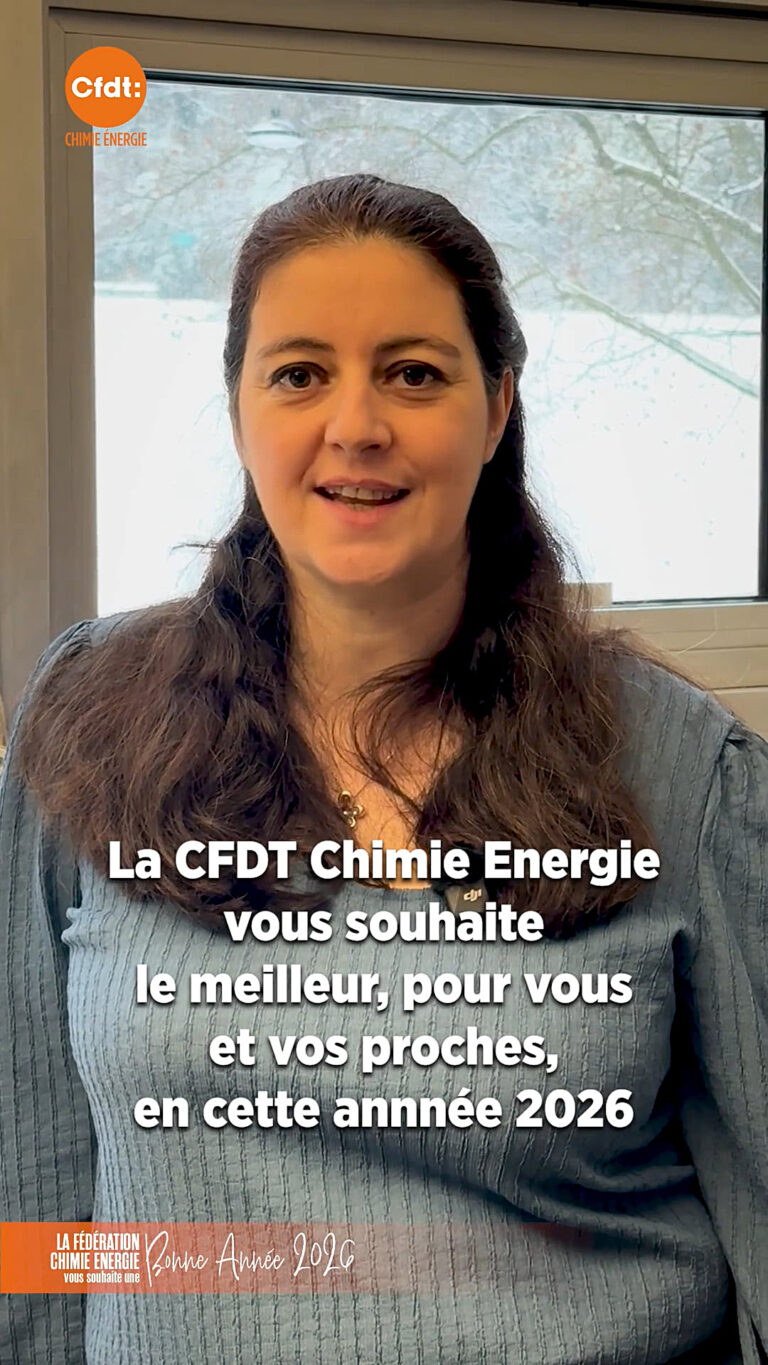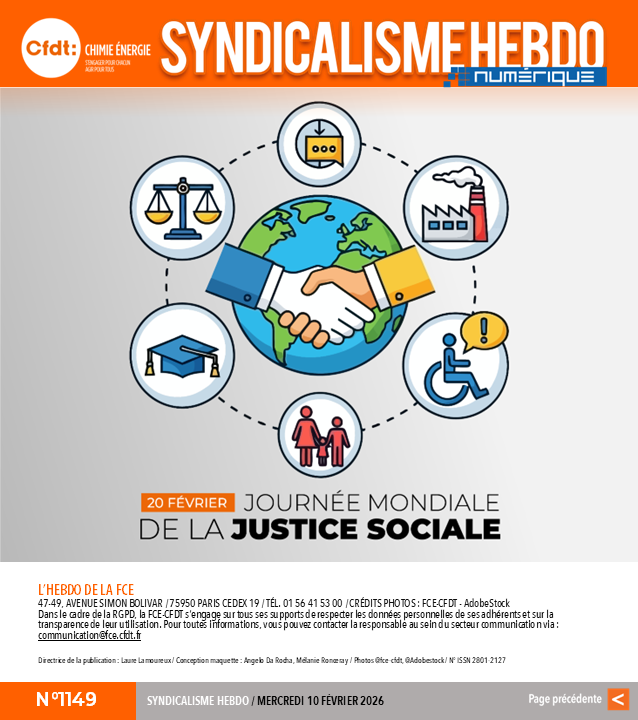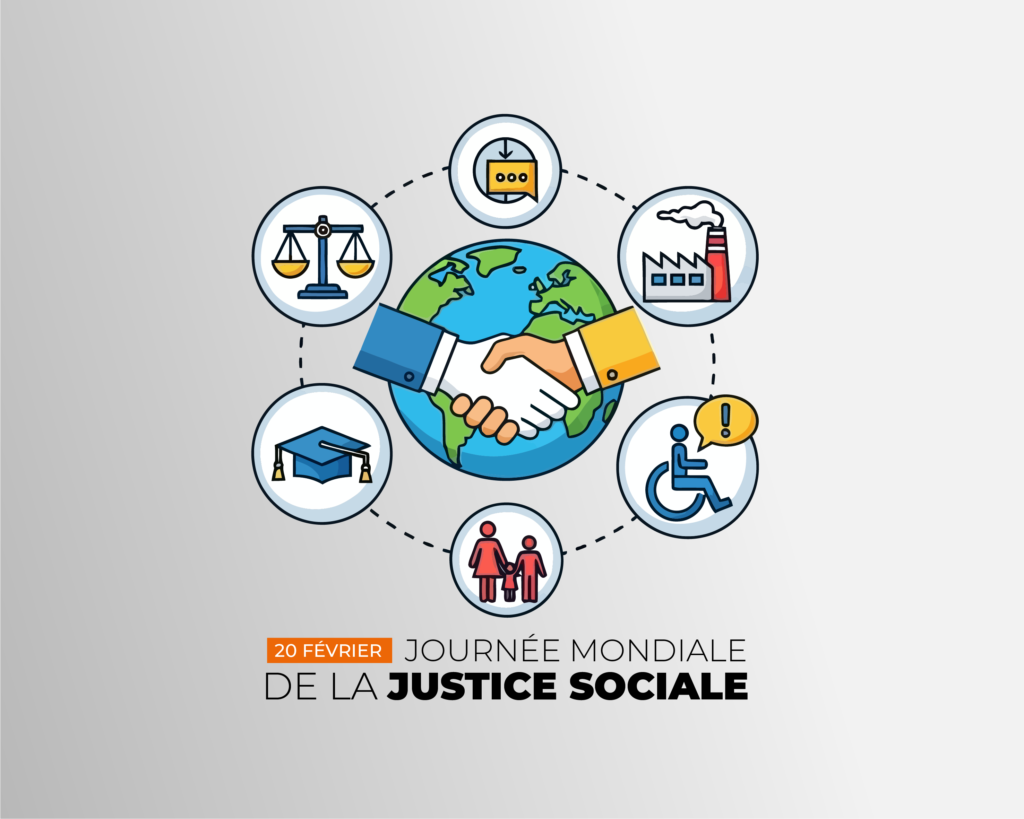Le droit de grève, tel que nous l’entendons aujourd’hui, est issu du préambule de la Constitution de la IVe République du 27 octobre 1946 : « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». L’Union européenne le consacrera également à l’article 28 de la Charte des Droits fondamentaux en 2000.
Le droit de grève est présent à l’article L2511-1 du code du Travail : « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. »
LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA GRèVE
La grève suppose une cessation complète du travail
Ainsi, les mouvements suivants, qui n’entraînent pas un arrêt total du travail, sont illégaux et ne peuvent pas être qualifiés de grève :
• La grève perlée, consistant à ralentir de manière anormale la cadence de production, ne constitue pas l’exercice du droit de grève.
• Un ralentissement d’activité ou une exécution de l’activité dans des conditions différentes des conditions habituelles ne constituent pas une grève, mais peuvent être considérés comme une exécution fautive du contrat de travail pouvant être sanctionnée par l’employeur.
• L’arrêt de travail doit être total et ne peut concerner qu’une période de travail effectif.
La grève est un droit individuel qui doit s’exercer collectivement
Un salarié ne peut pas faire grève tout seul : une telle action sera sanctionnée. L’ensemble des salariés n’est pas obligé de faire grève, mais ils doivent au moins être deux ou trois pour que le mouvement soit considéré comme collectif. En revanche, « un seul salarié gréviste dans une entreprise, mais qui accompagne un mouvement national, va être considéré comme un gréviste ». (Cass. Soc. 29 mars 1995 N°93-41.863).
DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES
Un mouvement de grève doit se fonder sur des revendications professionnelles, et porter sur des droits concernant directement les grévistes. à défaut de revendications professionnelles, le mouvement sera considéré illégal.
L’exercice normal du droit nécessite l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu importe les modalités de cette information. L’employeur peut donc licencier un salarié pour motif disciplinaire si ce dernier, bien que se prétendant en grève, refuse ou tarde à faire connaître ses revendications.
Les grèves de solidarité interne (soutien de salariés de la même entreprise) ou externe (soutien de salariés appartenant à d’autres entreprises) sont légales, dès lors que la mobilisation répond à un intérêt collectif et professionnel.
Il en est de même lorsque la grève porte sur des revendications sociales et professionnelles comme une grève
nationale pour la défense des retraites, ou une grève
européenne pour la défense du pouvoir d’achat.
Les revendications peuvent porter sur le salaire, les périphériques de rémunérations, les conditions de travail, l’aménagement du temps de travail, le système de
retraite, le droit syndical, les faits de harcèlement…
REVENDICATIONS ET MOUVEMENTS INTERDITS
Les grèves de contestations politiques sont interdites
Les actions de blocage de l’accès à l’entreprise, de dégradation de locaux, de détournement de matériel visant à désorganiser l’entreprise et n’ayant pas cessé malgré les ordonnances de référé constituent, elles aussi, un mouvement illégal et peuvent être très lourdement sanctionnées.
DéCLENCHEMENT DE LA GRèVE
Les salariés du secteur privé n’ont pas à respecter un préavis de grève : elle peut être déclenchée à tout moment, et sans formalités préalables.
Les salariés grévistes ne sont pas tenus d’informer l’employeur de leur intention de se mettre en grève.
L’employeur doit avoir connaissance des revendications formulées au moment de l’arrêt de travail, à défaut de quoi le mouvement sera illicite.
Dans les entreprises chargées de la gestion d’un service public, la grève est précédée d’un préavis précisant son début et sa durée envisagée.
DURéE
La grève n’est soumise à aucune durée minimale ou maximale. L’arrêt de travail peut être de très courte durée, ou se poursuivre sur une longue période.
FORME
Il n’existe pas de forme particulière requise de l’arrêt de travail.
Dans le secteur privé, sauf abus, la grève tournante, qui se caractérise par un échelonnement de la cessation du travail ou un roulement concerté par catégorie professionnelle, ou par secteur d’activité, dont l’objectif est de ralentir le travail et de désorganiser le ou les services, est admise.
Elle est en revanche interdite dans le secteur public.
Sous réserve qu’elle ne se traduise pas par une complète désorganisation de l’entreprise en lui infligeant un préjudice excessif, la grève-bouchon, qui consiste en l’arrêt de travail des salariés occupant une place stratégique dans l’entreprise, est légale.
L’occupation des lieux de travail est légale – sous réserve de l’abus.
A savoir :
L’employeur peut formuler une demande d’expulsion des salariés grévistes devant le juge des référés en rapportant la preuve d’un trouble manifestement illicite (atteinte à la sécurité des personnes et des biens…).
Conséquences DE LA Grève POUR LES Salariés Grévistes
Suspension du contrat de travail
Les salariés grévistes conservent leur emploi. Pour assurer la continuité de son activité, l’employeur peut remplacer les salariés grévistes – sous certaines conditions. Il ne peut pas remplacer
les salariés grévistes en ayant recours à l’intérim.
Sauf exception, l’employeur est dispensé de verser le salaire et ses accessoires. La retenue doit être strictement proportionnelle aux arrêts de travail effectifs.
Sanction du salarié gréviste
L’article L. 1132-2 du code du Travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Attention ! Lorsque la grève est illégale, les salariés ne sont pas considérés comme grévistes et ne bénéficient donc pas de la protection propre au droit de grève. C’est le cas, par exemple, d’un blocage de l’entreprise. à l’inverse, un barrage filtrant ne constitue pas un blocage susceptible de sanctions.
Réquisition de salariés grévistes
Sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes.
Cependant, le préfet peut réquisitionner des salariés grévistes en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l’exige, et que les moyens dont il dispose ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police.