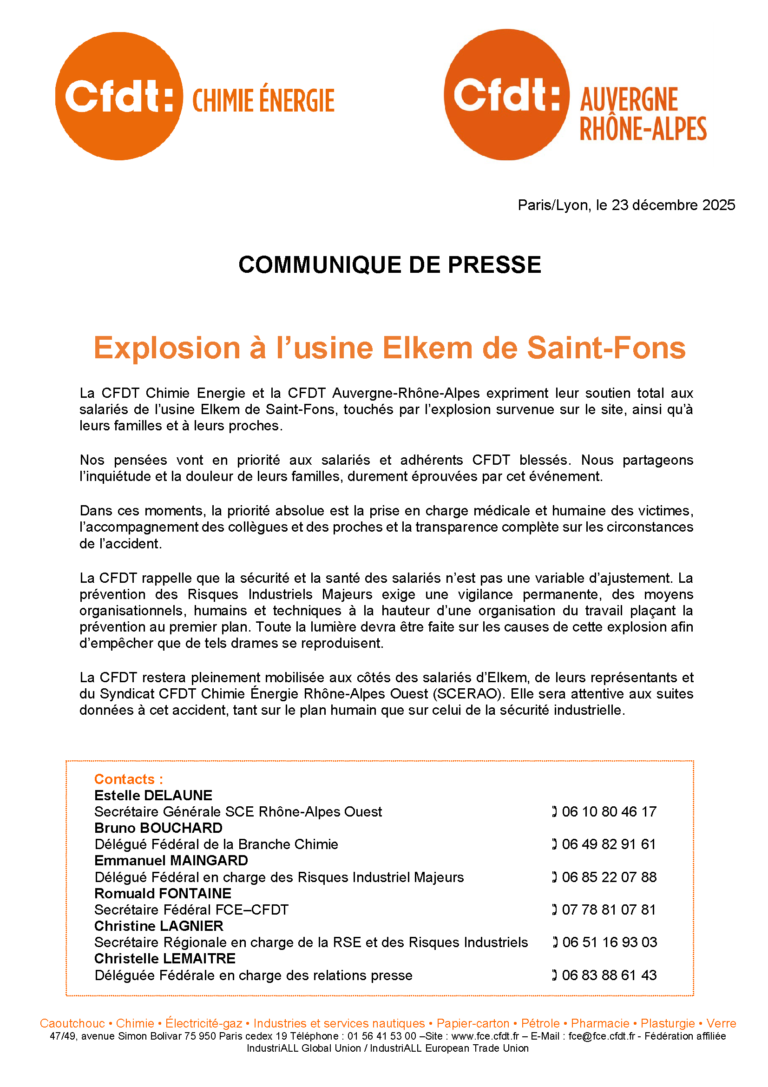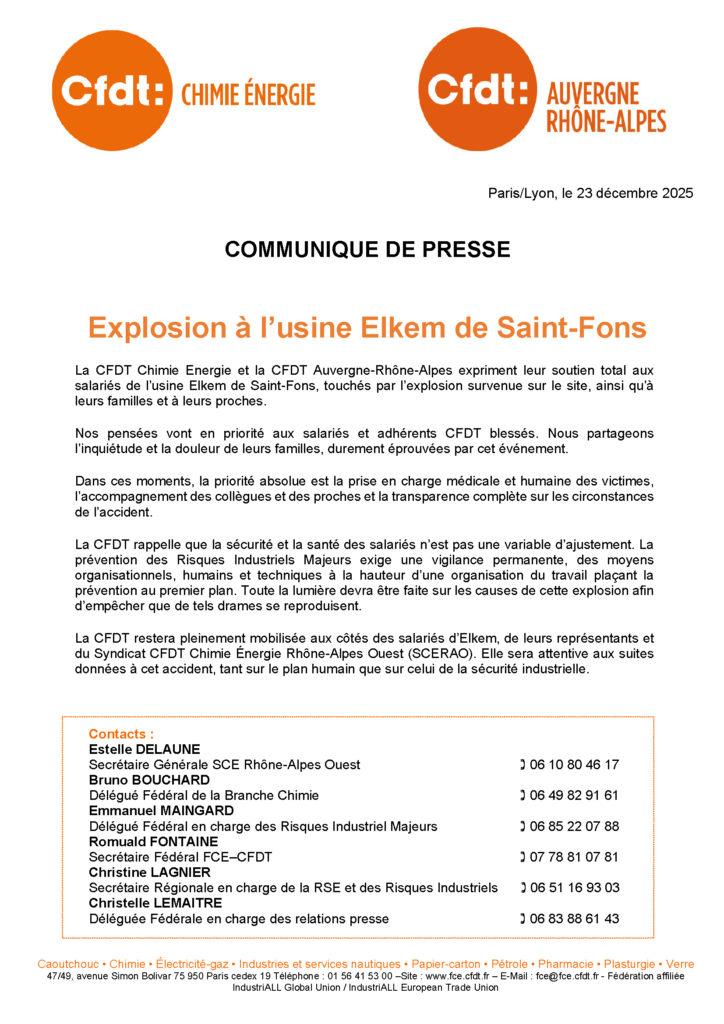Pour la CFDT, la protection sociale est un acquis majeur à préserver. Son pilier central est le régime général de la Sécurité sociale. Face aux remises en cause de notre système de Sécurité sociale, la CFDT réaffirme qu’il doit assurer la couverture des besoins vitaux.
La Sécurité sociale, avant d’être un problème financier, est d’abord un acquis social obtenu par les luttes des travailleurs. C’est un outil formidable de progrès social qui a peu à peu permis à une large majorité de la population de bénéficier de l’accès aux soins, d’un revenu de remplacement en cas de maladie, d’invalidité, d’accident du travail, de vieillesse et d’une aide à la famille.
Ces acquis ne sauraient pourtant masquer les insuffisances qui existent encore et les difficultés qu’a la Sécurité sociale à agir de manière efficace auprès des populations les plus marginalisées du fait de la permanence de la crise économique.
Pour une véritable institution de la solidarité
Face à cette situation, la CFDT renouvelle son attachement à une Sécurité sociale qui doit rester une véritable institution de la solidarité. Cela ne nécessite nullement un quelconque consensus mou dans la société, mais au contraire confrontation et compromis clairs assurant la pérennité et l’adaptation du système de Sécurité sociale. La couverture complémentaire vient alors comme une démarche volontaire et conventionnelle pour assurer un supplément de garantie.
L’importance de cet acquis est attestée par l’ampleur du budget de la protection sociale. Avec 2 772 milliards de francs, il est supérieur à celui de l’Etat (1 466 milliards). En témoigne aussi la part sans cesse croissante des prestations sociales dans le revenu disponible brut des ménages : elle représentait 41,5 % en 1992, contre 35,5 % en 1981 en moyenne (pour certains, c’est la totalité de leurs moyens d’existence qui dépend des prestations sociales). Les dépenses de santé ne cessent de croître plus vite que le PIB compte tenu des avancées technologiques. La question de fond qui se pose : est-on prêt au niveau de la nation à consacrer un pourcentage plus important du PIB à la protection sociale ?
Deux logiques sociales s’affrontent :
• celle d’une protection sociale minimum, complétée par des systèmes de capitalisation individuelle qui affirment que la protection sociale est un obstacle à l’emploi dans le contexte économique international et qu’il faut donc la réduire ;
• celle d’une protection sociale de haut niveau fondée sur la solidarité et appelant donc la mise en œuvre de financements supplémentaires.
Une protection sociale
de haut niveau
Jusqu’à présent, les politiques gouvernementales ont cherché à augmenter les recettes (cotisations, CSG) – mais cette logique se heurte aux exigences patronales de baisse des charges patronales et au credo libéral de baisse des prélèvements obligatoires – et à réduire les dépenses (modifications des règles d’attribution des retraites, moindres remboursements d’actes médicaux, modification des conditions d’indemnisation des chômeurs ). Sans apporter de solutions réellement durables, ces dispositions sont souvent condamnables sur le plan social.
Pour la CFDT, un niveau de prestation décent est une condition essentielle à l’acceptation par l’ensemble de la population d’un niveau de financement correspondant.
La protection sociale marque le niveau de solidarité atteint par la société. Cette exigence de solidarité se concentre dans le financement.
Pour atteindre notre objectif d’une protection sociale de haut niveau fondée sur la solidarité (d’où notre condamnation des logiques de capitalisation), on ne pourra plus longtemps se contenter d’un semi statu quo. La CFDT maintient une continuité de pensée dans le domaine du financement. En fonction de ce que sont devenues les prestations (universalité), le financement sur la seule masse salariale et autres revenus du travail (non salarié) n’est plus justifié. L’élargissement à plusieurs sources de financement est légitime au-delà même de la nécessité de sécuriser les rentrées financières en les diversifiant.
Deux idées centrales :
• les prestations qui sont versées à toute la population doivent être financées par l’ensemble des revenus,
• les prestations qui ont un lien avec le contrat de travail doivent être financées sur la base des cotisations sociales.
Il apparaît évident que, dans un pays moderne, les dépenses liées à la protection sociale ne peuvent que croître. Aucun acteur sérieux du système n’imagine un seul instant les faire baisser. En revanche, il faut se demander si les injections régulières de milliards supplémentaires servent à améliorer la situation sanitaire.
Le dysfonctionnement
du système
Notre système, tel qu’il fonctionne, peine à remplir sa mission avec efficacité. Est-il fatal, par exemple, que nos dépenses pharmaceutiques doublent tous les 10 ans pendant que s’accroît le nombre d’hospitalisations provoquées par des surconsommations médicamenteuses ? Le faible remboursement des soins dentaires est-il une donnée immuable sur laquelle il est impossible de revenir ? Les suites de la canicule illustrent parfaitement le dysfonctionnement de notre système. Nous devons en tirer les enseignements pour l’améliorer, le rendre efficace et lui permettre de remplir pleinement son rôle.
La protection sociale
Enjeu majeur de société, la protection sociale renvoie à un vaste champ d’interrogations.
• Problèmes démographiques : vieillissement des populations
lié à la faible fécondité
et à l’allongement de la durée moyenne de vie.
• Problèmes économiques :
chômage, prélèvements obligatoires, coût du travail, compétitivité des entreprises.
• Problèmes sociaux : importance de la pauvreté dans les pays riches, augmentation des familles monoparentales, des cas d’isolement liés à l’urbanisation et aux modes de vie, place des personnes âgées, développement du Sida.
• Problèmes politiques : organisation et financement, inégalités de revenus, justice sociale, rôle de l’Etat.
Ne pas masquer les insuffisances de la Sécu
L’ambition des créateurs de la Sécurité sociale était de mettre en place un grand régime unifié et généralisé. De la réalité bien différente, il résulte des inégalités.
En matière de prestations, la couverture sociale n’est pas la même entre le régime général et les régimes particuliers, la prévoyance complémentaire y rajoutant ses effets.
L’accès au soin reste inégalitaire en fonction du revenu, face à la baisse continue du niveau de remboursement et en fonction de l’offre de soin sur tout le territoire.
L’effort contributif est loin d’être identique pour toutes les catégories socioprofessionnelles du fait des différences d’assiettes et de taux de cotisations (salaire brut pour les salariés, revenu fiscal imposable pour les professions indépendantes qui pour certains, vu la fraude fiscale, ne correspond pas au revenu réel…).
Il n’est pas cohérent de financer, par des cotisations principalement assises sur la masse salariale, des prestations qui bénéficient à quasiment toute la population (soins médicaux, prestations familiales).
Le système de cotisation assise sur les salaires est sensible à la conjoncture économique et pénalise les entreprises de main-d’œuvre par rapport aux plus capitalistiques.
A l’intérieur des charges sociales, la part salariés a augmenté, la part employeur diminué. Le plafonnement des cotisations retraites peut interroger, même s’il a sa contrepartie en matière de pension.
Déséquilibres de l’assurance maladie :
les causes sont connues
Chaque année, les parlementaires votent, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, un objectif national de dépenses d’assurance maladie qui comprend les dépenses de santé stricto sensu (secteur hospitalier public, cliniques privées, secteur médico-social et les soins de ville).
Le volume des recettes de la protection sociale dépend des variations de l’activité économique. Elles déterminent la masse salariale qui constitue l’assiette des cotisations sociales (bien que la CSG module ce phénomène).
Du côté des dépenses, l’influence de la conjoncture joue pour l’assurance chômage (pertes de recettes et surcroît de dépenses).
Pour les autres branches, ce sont surtout des variables socio-démographiques
qui influent :
• vieillissement de la population, facteur d’accroissement des dépenses de l’assurance vieillesse et de l’assurance maladie ;
• accroissement des consultations médicales diverses avec la montée des classes moyennes, l’urbanisation, l’élévation des niveaux de vie et d’instruction ;
• progrès des techniques médicales et sophistication des appareillages ;
• augmentation du nombre de médecins, plus particulièrement des spécialistes la plupart rémunérés à l’acte, développement des nouvelles pauvretés, importance des accidents, augmentation des familles monoparentales et des personnes seules et isolées ;
• rôle de l’industrie pharmaceutique.