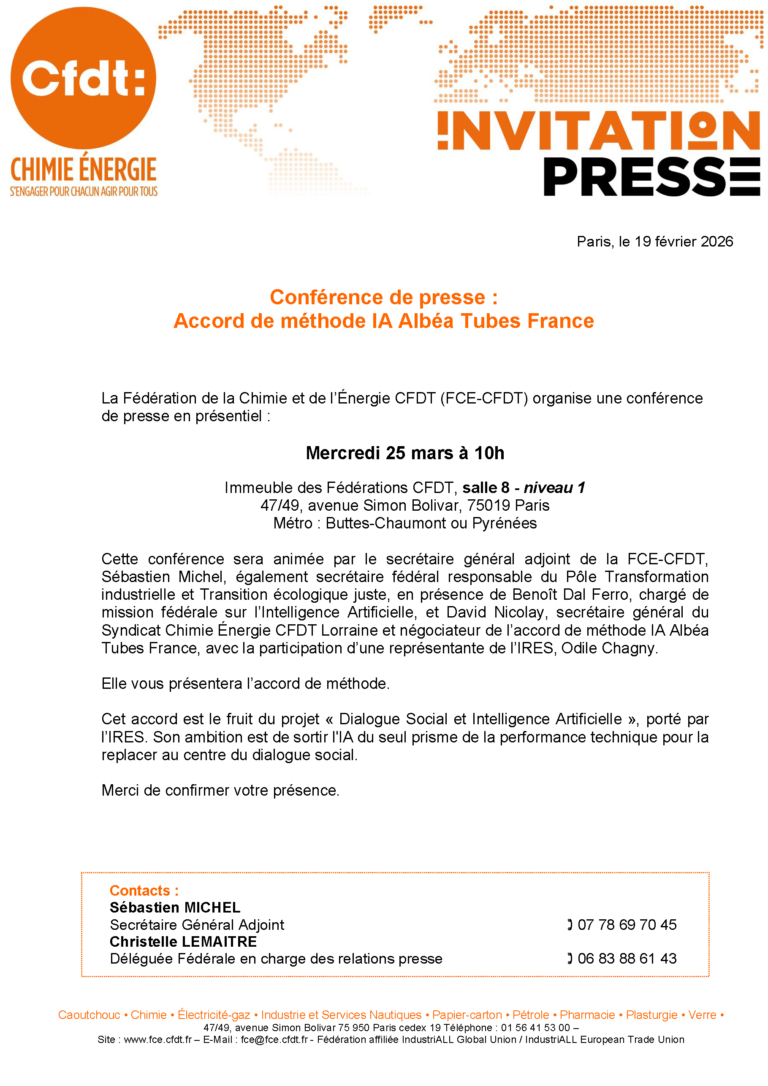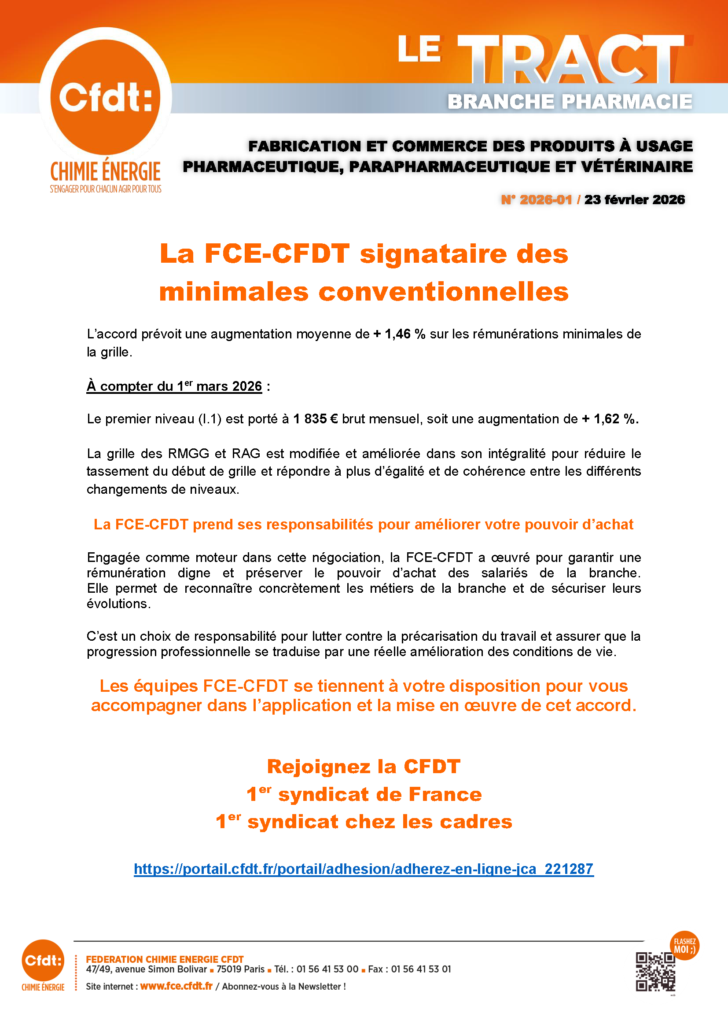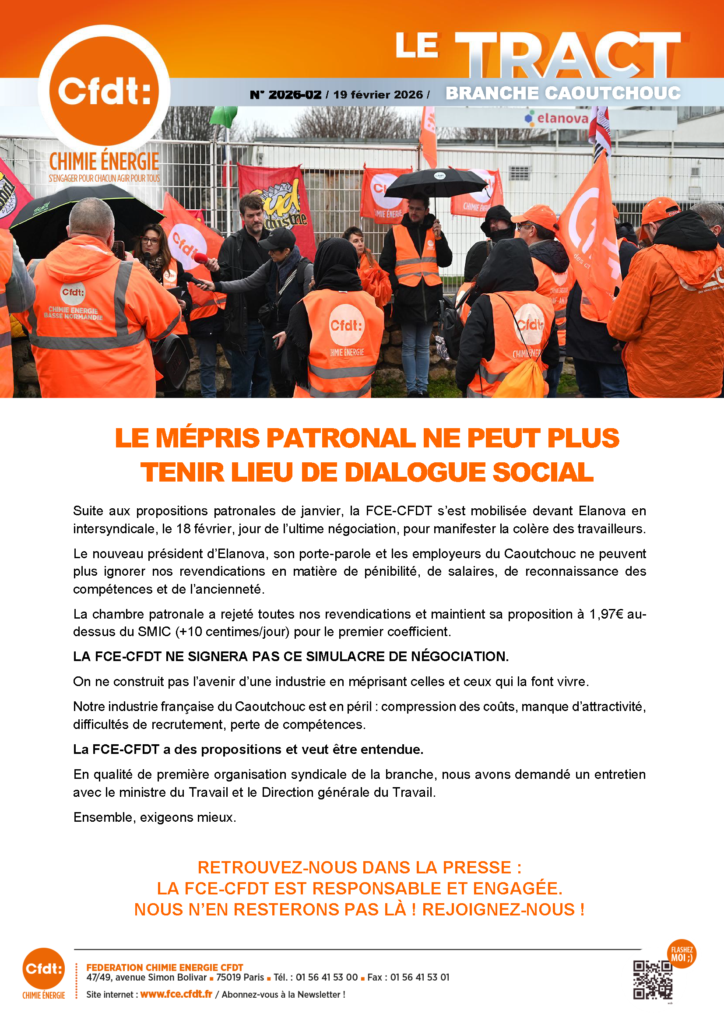La réforme de la représentativité initiée et voulue par la CFDT, signataire avec la CGT de la position commune du 9 avril 2008, et reprise, pour l’essentiel par la loi du 20 août 2008, produit peu à peu ses effets sur le paysage syndical français. Toutes les tentatives juridiques nationales (Cour de cassation, Conseil constitutionnel) et internationales (Organisation Internationale du Travail) lancées par les syndicats opposés au principe même de la représentativité, ont échoué dans leur tentative d’invalider juridiquement cette réforme.
Malgré la consécration dans son principe de conventionalité et de constitutionnalité, cette loi reste aujourd’hui au cœur de nombreux recours auprès des tribunaux d’instance, puis de la Cour de cassation pour faire préciser ou interpréter le texte entraînant de fait, une jurisprudence prolifique.
Dans les entreprises, la nécessité d’atteindre le seuil d’audience de 10% entraîne souvent une réduction du nombre d’acteurs syndicaux. Dans celles constituées de plusieurs établissements, la tendance est plutôt à l’émergence d’une représentativité à géométrie variable. Des différences internes liées à la spécialisation des sites d’activités (production, recherche ou administration…) et aux catégories socioprofessionnelles conduisent à un pluralisme syndical, pas nécessairement le même d’un établissement à l’autre. De plus, lorsque le cycle électoral n’est pas harmonisé au niveau de l’entreprise ou du groupe, cela peut évoluer en permanence. La simplification du paysage syndical qui est recherché dans cette réforme n’en est donc qu’à son amorce.
La perte de la représentativité d’un syndicat entraîne tantôt des départs vers d’autres syndicats, tantôt un découragement des militants. La réduction des heures de délégation avec le passage du mandat de DS à celui de RSS, la perte de l’accès à l’information et de la possibilité de négocier ne facilitent pas la reconquête de la représentativité. C’est pourquoi, anticiper la compréhension des nouvelles règles et revisiter ses propres pratiques syndicales sont indispensables pour maintenir et renforcer sa légitimité.
L’élection en décembre dans les entreprises de moins de 10 salariés est l’étape suivante qui permettra de calculer en 2013 la représentativité au niveau des branches professionnelles et de l’interprofessionnel. Nos liens avec les salariés, notre capacité à les organiser et à négocier avec eux de nouvelles conquêtes sociales doivent nous permettre d’obtenir partout le seuil d’audience minimum nous donnant le droit de les représenter.