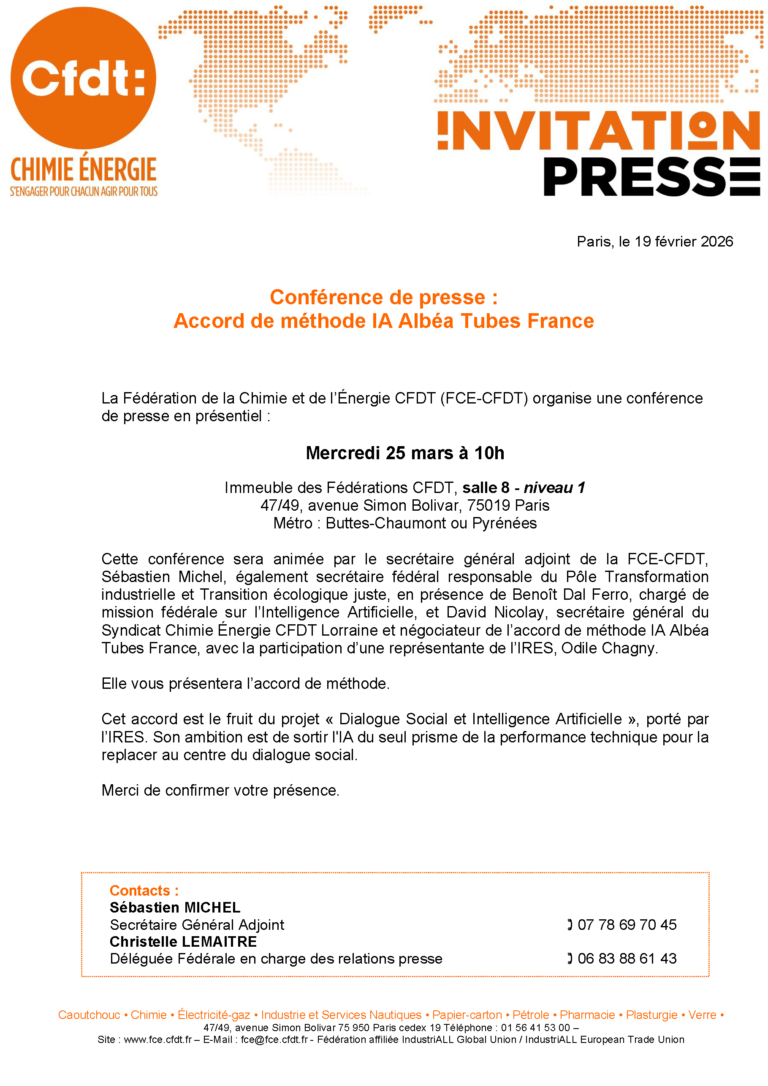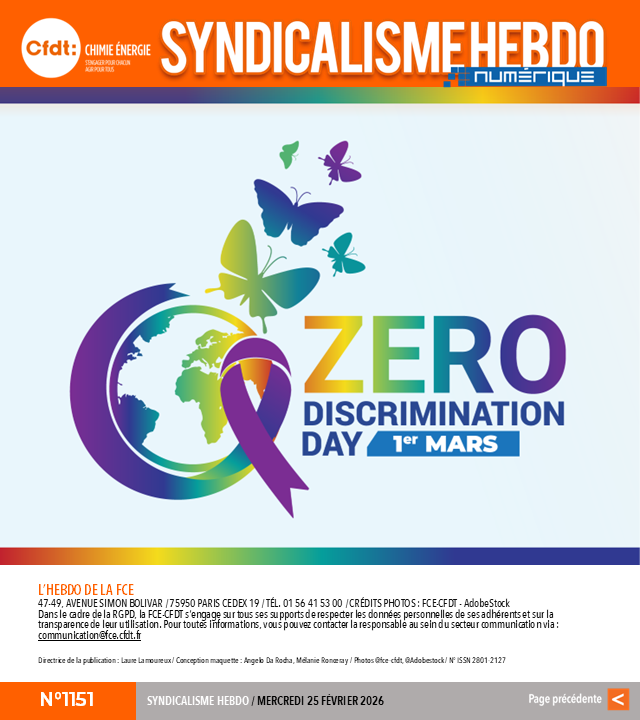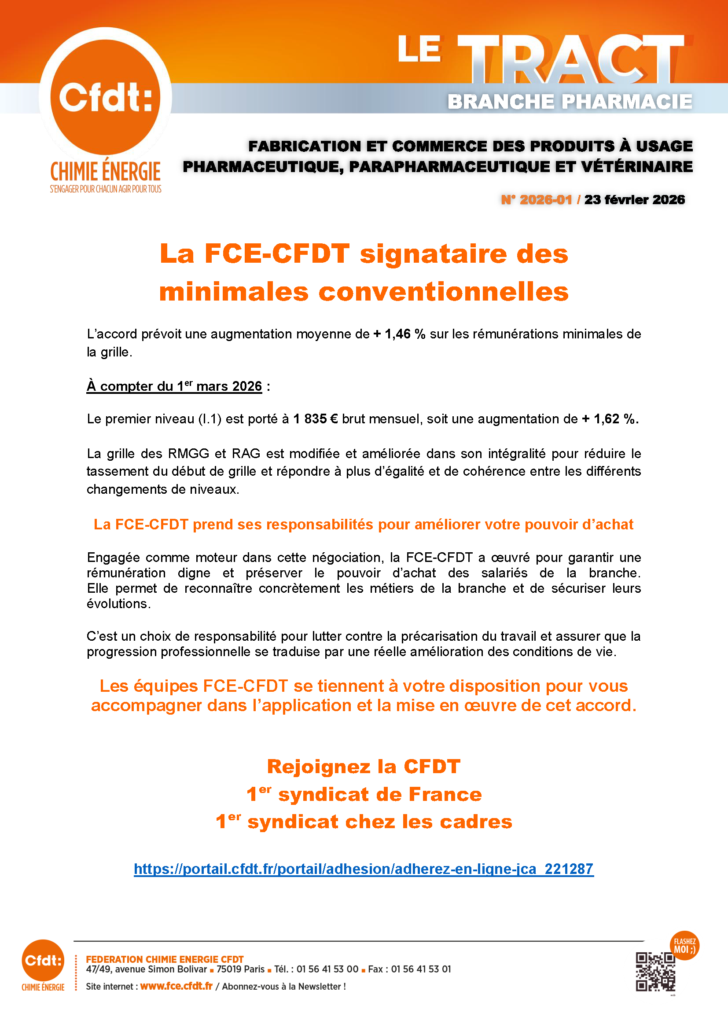S’il nous semble à tous naturel de passer à la pharmacie pour obtenir sur le champ les médicaments que nous a prescrits notre médecin, c’est grâce à un système de distribution des médicaments original, mis en place depuis plusieurs décennies. Système que mettent en œuvre les grossistes-répartiteurs. Même si historiquement, ce mode de distribution s’est mis en place à l’initiative des pharmaciens d’officine.
Cette distribution s’organise dans le respect des missions de service public, réglementées par le Code de la Santé publique. Les grossistes-répartiteurs, propriétaires de leurs stocks, doivent disposer d’une réserve de deux semaines de consommation, et être en mesure de livrer tout médicament sous 24 heures à toute officine de son secteur. Quand on sait qu’il existe 36 000 médicaments inscrits dans le répertoire et que 75 % d’entre eux sont vendus à moins d’une unité par mois par pharmacie, on mesure l‘ampleur de la tâche…
Pour réaliser cette mission, les opérateurs du secteur organisent leur activité autour de trois grands métiers : l’accueil téléphonique pour le conseil et la prise de commande, le magasinage pour l’approvisionnement et la préparation des commandes, et la livraison par une flottille de camionnettes qui approvisionne deux ou trois fois par jour les officines. Ces entreprises, organisées nationalement, ont maillé le territoire d’agences ou d’établissements dont la taille et le rôle peuvent différer. Certaines agences régionales concentrent l’approvisionnement à partir des livraisons des fabricants que sont les laboratoires pharmaceutiques, et alimentent des agences satellites dont le rôle est d’alimenter les officines dans un territoire restreint. La logistique mise en œuvre doit être à la hauteur des plusieurs millions de boites de médicament qui, chaque jour, sont distribués en France à près de 23 000 officines. Cette logistique se doit de respecter les bonnes pratiques de distribution, la réglementation qui s’attache à certaines classes thérapeutiques comme la morphine et ses dérivés, mais aussi la chaîne du froid.
Avant d’arriver sur le comptoir de la pharmacie, la boite d’aspirine, le vaccin du petit dernier, les gouttes de Papy auront suivi tout un cheminement dès leur réception par le grossiste-répartiteur. Dès que la commande aura été enregistrée par l’accueil téléphonique, les préparateurs de commande identifieront l’origine de la commande, et déclencheront la livraison en orientant la boite dans le bac qui sera livré dans la journée ou le lendemain matin, parfois même au milieu de la nuit, par le chauffeur-livreur qui livre votre pharmacie. Parfois, c’est l’agence régionale qui prépare la commande qui sera livrée à l’agence locale par semi-remorque, avant d’être ventilée dans la tournée de votre pharmacien. Pour préparer ces commandes à destination des pharmacies, d’énormes robots pilotés par informatique mécanisent aujourd’hui une activité autrefois réalisée à la main. La répartition, c’est en quelque sorte le service postal du médicament.
Ce modèle traditionnel de répartition, dit full-liner, est confronté à l’arrivée de nouveaux entrants dans la distribution des médicaments. Il s’agit des short-liners, plateformes logistiques au statut de répartiteurs, mais concentrées sur les plus fortes rotations. Mais aussi les plateformes logistiques de groupement de pharmaciens, de dépositaires, de vente directe, et peut-être demain d’e-commerce. Les génériques, privilégiés par le droit de substitution accordé désormais au pharmacien d’officine, favorisent la vente directe.
La distribution, dont la répartition reste malgré tout l’acteur principal, est aujourd’hui confrontée à la baisse des volumes distribués, comme à une baisse historique de ses marges. Comme l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du médicament, elle reste soumise à la volonté des autorités de régulation du secteur qui veulent maîtriser les coûts du médicament pour l’Assurance Maladie. Toutes ces mutations ont déjà des conséquences sur l’organisation des opérateurs. Et nous pouvons imaginer que ces transformations vont se poursuivre. C’est pourquoi la FCE-CFDT, première organisation syndicale du secteur, œuvre pour s’approprier ces enjeux, être en capacité d’en anticiper les conséquences sur l’emploi, et proposer des solutions alternatives.