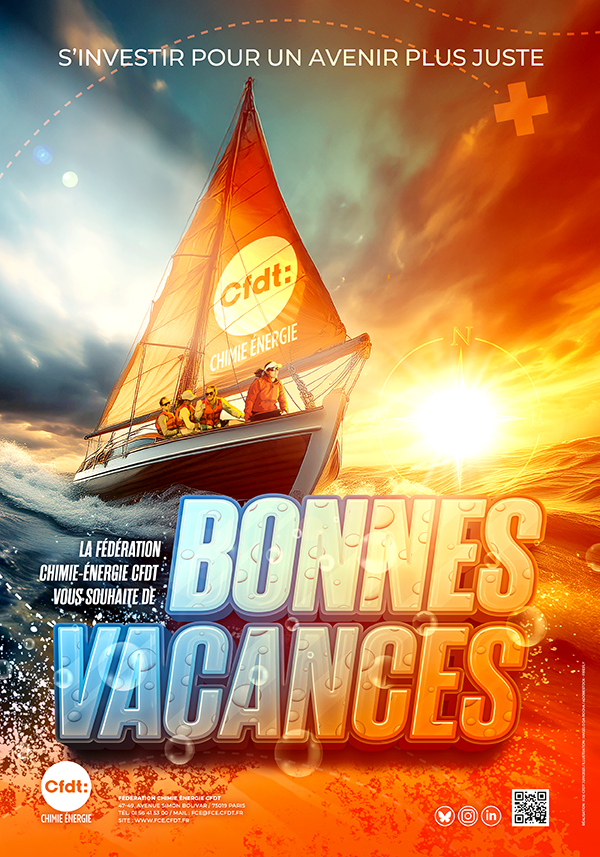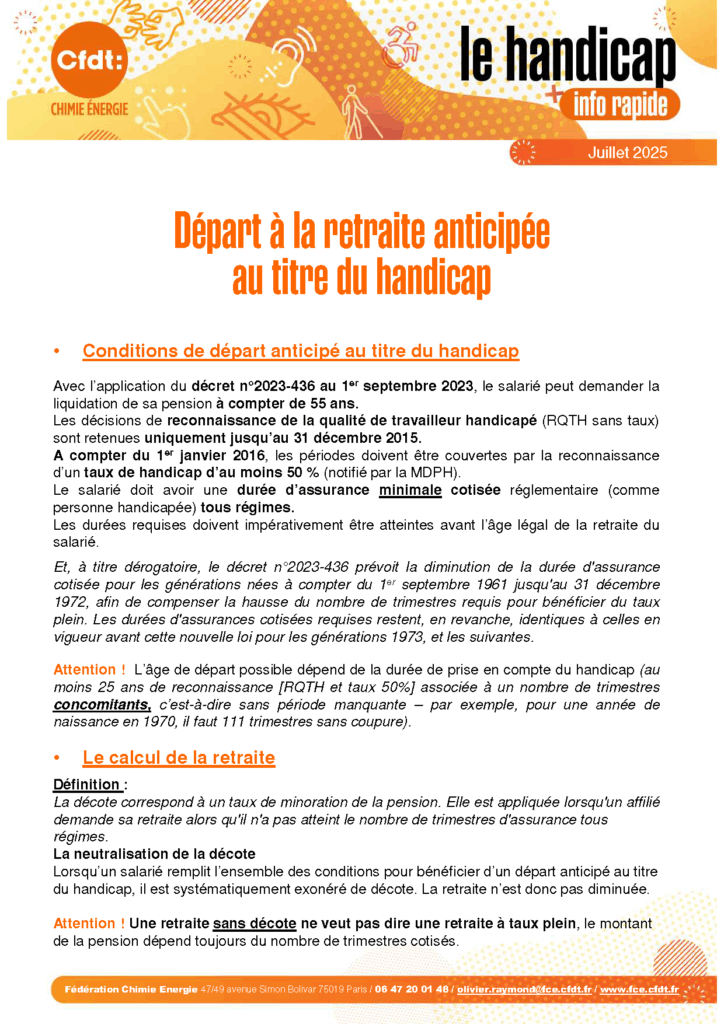A partir d’un projet initial de paix, l’Union européenne (UE) s’est construite par étape, de Monnet à Barroso en passant par Delors, sous l’impulsion du couple franco-allemand. Dans un marché unique, axé sur la libre circulation des biens et des personnes, l’euro reste un des axes majeurs de cette décennie. Alors que la crise financière s’amplifie au regard de l’évolution des matières premières, l’euro fort, pourtant décrié par beaucoup, protège aujourd’hui les intérêts des citoyens européens. Mais cette Europe économique répond de moins en moins aux attentes de démocratie sociale, et les écarts entre élites et citoyens se creusent, les amenant à se défier de l’UE et à des comportements de repli national. Cela met en cause les fondements de l’UE. Remise en cause d’ailleurs traduite par les Non français et néerlandais, et plus récemment irlandais.
Dans ce contexte, la présidence française de l’UE peut-elle être une opportunité pour redonner du sens au projet européen ? La présidence française se fixe quatre priorités dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne : l’articulation entre politique énergétique et réchauffement climatique, la mini-réforme de la politique agricole commune, l’immigration, et la défense. Suite au refus irlandais, la présidence française s’est engagée ces derniers jours à donner une touche sociale à la construction européenne, qui pourrait se traduire par le renforcement du pouvoir des comités d’entreprise européens et la relance de la lutte contre les discriminations.
De plus, une nouvelle stratégie initiée par la France est en cours d’élaboration pour l’après-Lisbonne. Dénommée « Lisbonne plus », elle précise la nécessité de développer une diplomatie énergétique et environnementale. Elle propose une démarche normative du travail. Elle développe l’idée d’une politique européenne d’immigration. Enfin, elle propose la création d’un outil de surveillance des investissements dans les secteurs stratégiques pour raisons de sûreté. Cette stratégie met l’accent sur la recherche et l’innovation. Elle replace l’industrie dans la construction européenne. Elle insiste sur le développement d’innovations sociales en matière d’éducation et d’enseignement supérieur, sur les mobilités professionnelles et géographiques, et sur la nécessité d’ajuster les fonds européens. La problématique d’une gouvernance renforcée est aussi posée, ainsi que l’évaluation publique des résultats obtenus.
Pour la FCE-CFDT, si les bases de cette initiative participent à la reconstruction d’un projet européen, celui-ci doit associer pleinement les citoyens à son élaboration. En tout état de cause, l’UE doit avancer sur la base de projets au service des citoyens. Peut-être faudra-t-il accroître dans ce cadre les coopérations entre pays ? Peut-être faudra-t-il en passer par une Europe à deux vitesses ?