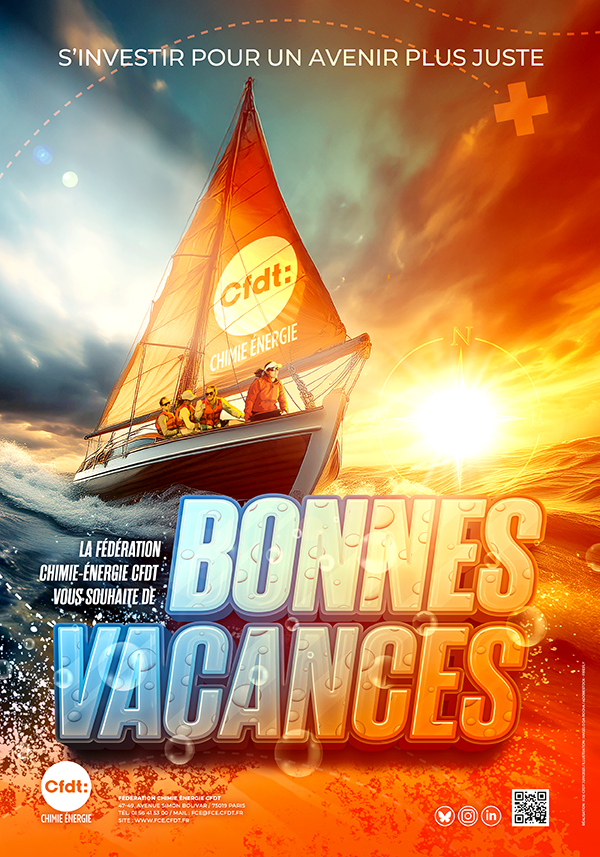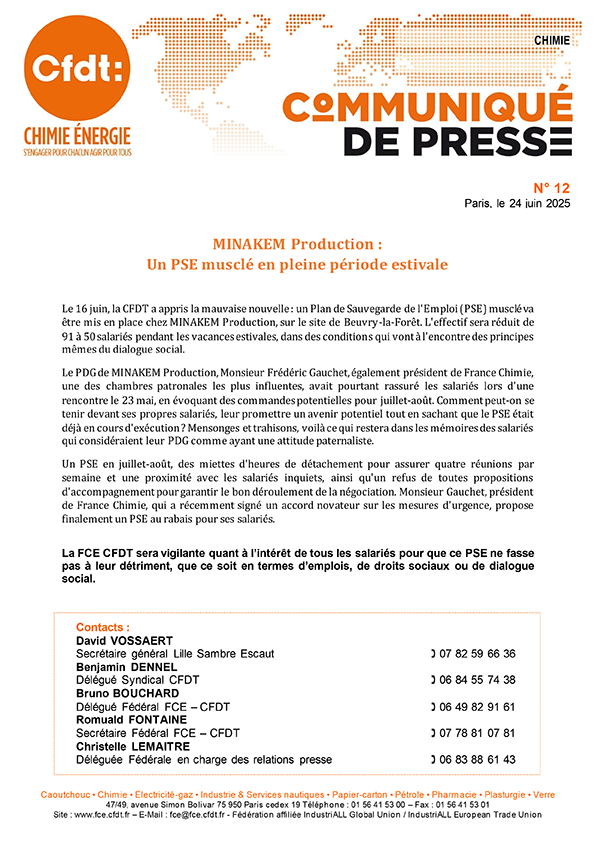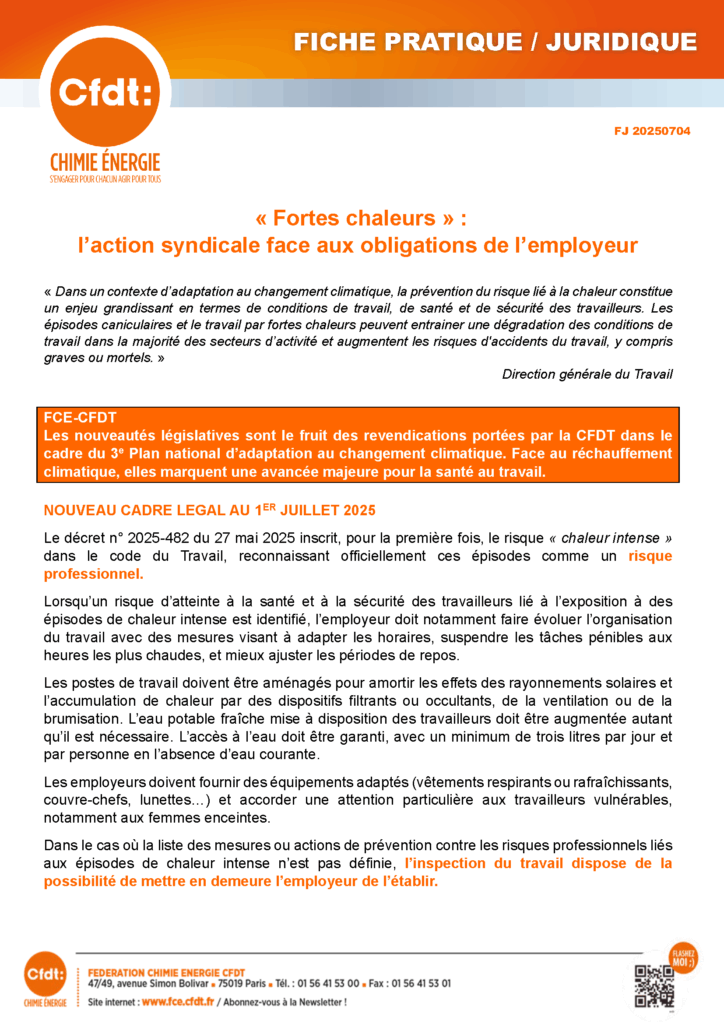La question du temps de travail paraît facile à aborder : « la durée hebdomadaire légale est de 35 heures, l’amplitude journalière ne peut dépasser 10 h 00. Je suis cadre au forfait annuel en jours, donc je dois travailler 218 jours sans compter mes heures… ». Autant de réponses que de situations.
La question des heures supplémentaires a rarement fait l’objet de discussions salariés/encadrement, souvent par crainte de faire naître des difficultés relationnelles ou des mises en cause « vous n’êtes pas organisé » ; mais aussi parce que cette question en soulève bien d’autres : comment les comptabiliser au plus juste ? Comment en apporter la preuve ? Qu’elle en est la prescription : puis-je les comptabiliser sur les cinq dernières années ou plus ? En tant que cadre ai-je le droit à reconnaissance d’heures supplémentaires ?
Pourtant, c’est souvent au moment du départ de l’entreprise, par suite de licenciement ou autre, que se dessine l’heure des comptes. Ce qui était en latence ressurgit, et le contentieux lié au paiement des heures supplémentaires se projette sur le devant de la scène.
Tout contentieux obéit à une règle fondamentale : la constitution d’un dossier. Le ressenti de l’injustice doit se confronter à la réalité des faits.
Il est des étapes incontournables : déterminer le temps de travail auquel le salarié est soumis. Le cadre légal fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures soit 1 607 heures par an. Le salarié de statut cadre, par la signature de son contrat de travail ou d’un avenant peut être au forfait annuel auquel cas, son temps de travail se déroule sur 218 jours par an. Attention, il est impératif à ce stade de se référer à tout ce qui a été négocié au sein de l’entreprise en termes de temps de travail, car les accords fixent le cadre conventionnel. Si rien n’a été négocié, le code du travail fixe les règles. Les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale.
Lorsque l’employeur demande l’accomplissement d’heures supplémentaires, le salarié ne peut refuser de les effectuer, sans courir le risque de commettre une faute, pouvant aller jusqu’au licenciement. Par contre, si les heures ne sont pas demandées mais induites par l’organisation du travail, Il faudra alors démontrer la réalité des heures travaillées ou démontrer que l’employeur ne pouvait en ignorer l’existence.
La preuve n’incombe spécialement à aucune des parties. S’il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. S’agissant d’un fait juridique, la preuve est libre. Il est également possible de demander au juge toute mesure permettant de mettre en évidence l’existence du litige : ordonnance de production de documents, enquête, audition de témoins.
Les heures supplémentaires ne sont pas forcément payées. En effet, elles peuvent faire l’objet d’un repos compensateur, si un accord collectif de branche ou d’entreprise prévoit que les heures supplémentaires seront payées en repos – intégralement ou partiellement – A noter qu’un repos compensatoire est obligatoire pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel, conventionnel ou réglementaire.
Le salarié doit établir un décompte précis des heures dont il réclame le paiement. Le délai de prescription est de cinq ans. L’article L 2224 du Code du travail énonce que le délai court « à partir du jour ou le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est nécessaire de réclamer le paiement de ces sommes par lettre recommandée avec AR et d’introduire dans ce courrier un délai « butoir » de réponse, avant de déposer une requête au conseil de prud’hommes. Attention, le référé n’est pas possible pour cette action. En effet, le contentieux de l’existence ou non d’heures supplémentaires nécessite un procès sur le fond. Les heures supplémentaires ne relève pas du juge de l’évidence…
ON CROIT QUE…. MAIS …
Le temps d’habillage/déshabillage n’est pas du temps de travail, sauf si la tenue de travail est imposée par des dispositions législatives ou par le règlement intérieur.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail lorsque le salarié peut « vaquer librement à ses occupation personnelles ».