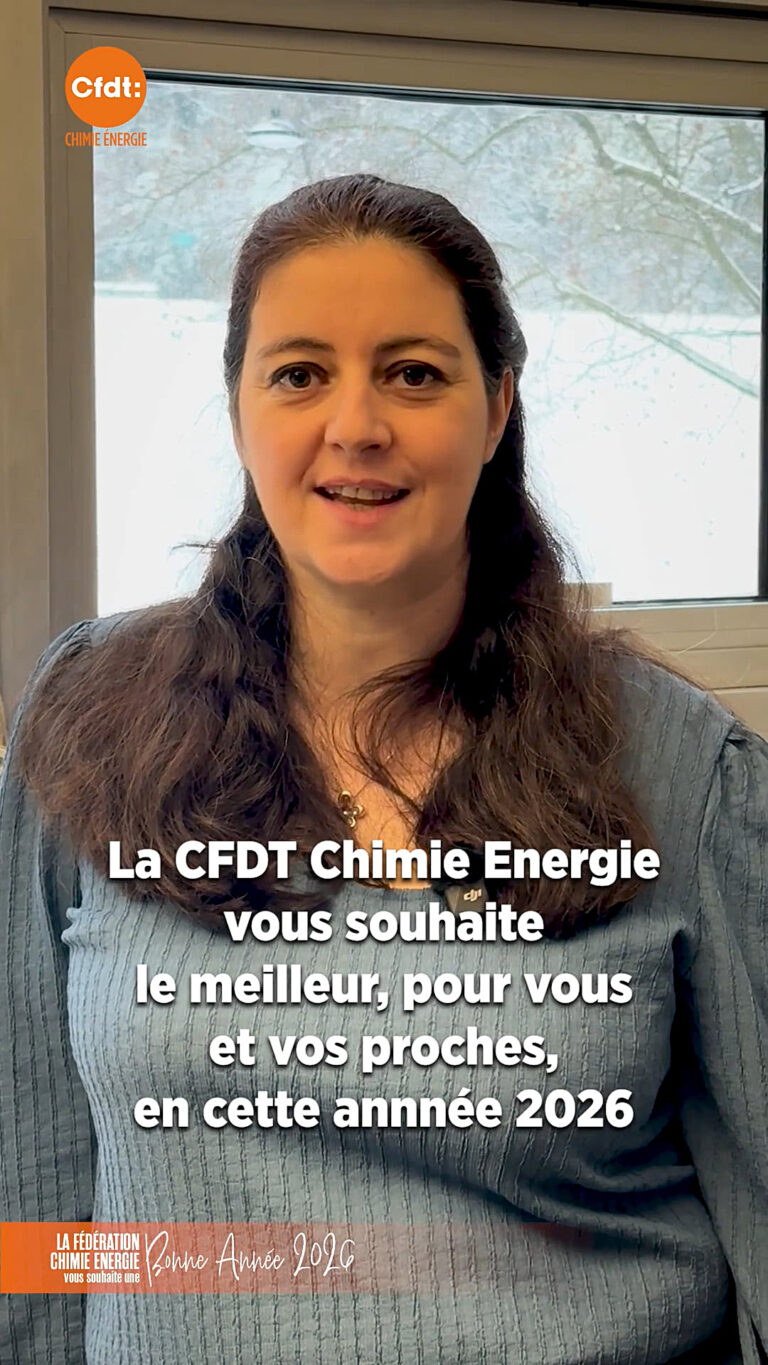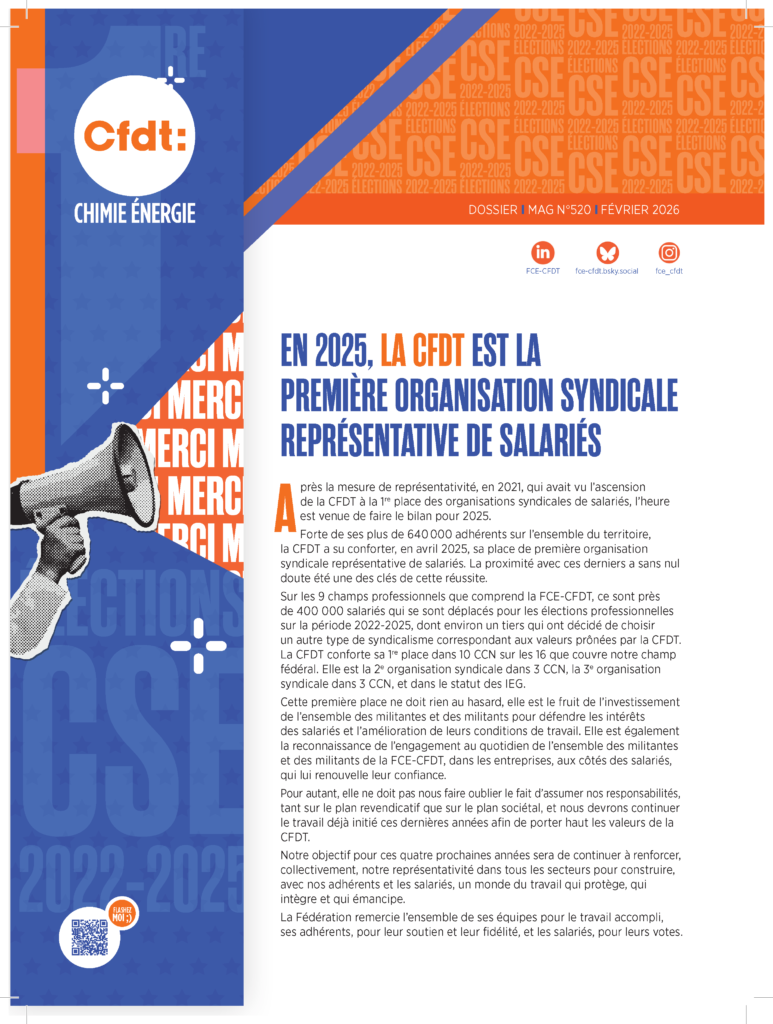Toute société énonce un certain nombre de règles qui régissent la vie de ses citoyens, à un moment donné et en un lieu donné. Ce sont les droits fondamentaux, les droits individuels ou collectifs, publics ou privés, commerciaux, économiques ou juridiques, etc.
Le « recours au droit » se développe et contribue à la régulation économique, sociale et politique. Mais en parallèle, il s’accompagne d’un développement de la judiciarisation de la société, et parfois même d’une importante médiatisation. Cette mobilisation croissante de la justice se manifeste dans de nombreuses sphères de la vie sociale, privée comme publique. C’est, par exemple, l’emprise du judiciaire sur la vie politique ou l’utilisation croissante de l’arme juridique dans les luttes syndicales et sociales. Elle illustre un changement des mentalités.
Quels en sont les causes et les ressorts ? Les « affaires » de santé publique comme le sang contaminé ou l’amiante, sont le signe d’une quête de transparence dans la gestion politique, mettant en cause des hommes politiques, des chefs d’entreprise et des experts. Le nombre de groupements, associations ou syndicats ne cesse d’augmenter. Le recours à l’action judiciaire devient un tremplin pour valoriser leur cause et leur action. Pour eux, c’est également la possibilité d’instaurer de nouvelles normes sociales, ou de les harmoniser entre pays, en intervenant auprès de la cour de justice européenne. Pour chaque personne, c’est aussi un moyen de faire reconnaître ses droits, pour obtenir réparation d’une injustice.
Dans une société en manque de repères collectifs, où les citoyens disent ne plus se retrouver dans les représentations collectives, le recours au juge semble constituer l’ultime moyen efficace. Parfois, c’est un moyen d’exister en s’opposant à d’autres.
Pour la CFDT, ces attitudes posent de nombreuses questions. Le recours systématique à l’action juridique deviendrait-il la seule solution pour se faire entendre ? Est-il l’aveu d’une incapacité généralisée à traiter les conflits entre les acteurs concernés ? Le juge se manifeste dans un nombre de plus en plus étendu de domaines sociétaux. Quelles implications d’un tel processus pour la démocratie, c’est-à-dire sur la participation de la société à la création et l’application de ses droits, notamment sociaux ? Quelle place accorder à la justice dans la société ? Quels pouvoirs donner aux juges : faire respecter les droits ou les créer à travers la jurisprudence ?
Pour la CFDT, la régulation des conflits doit passer d’abord par le dialogue social et la négociation. L’action juridique ou judiciaire ne doit pas s’y substituer, mais n’être qu’un ultime recours. Cela passe par une plus grande responsabilisation des acteurs, en les sortant du seul schéma victimes ou coupables. Cela nécessite la construction d’un projet collectif et la redéfinition d’un nouveau contrat social.