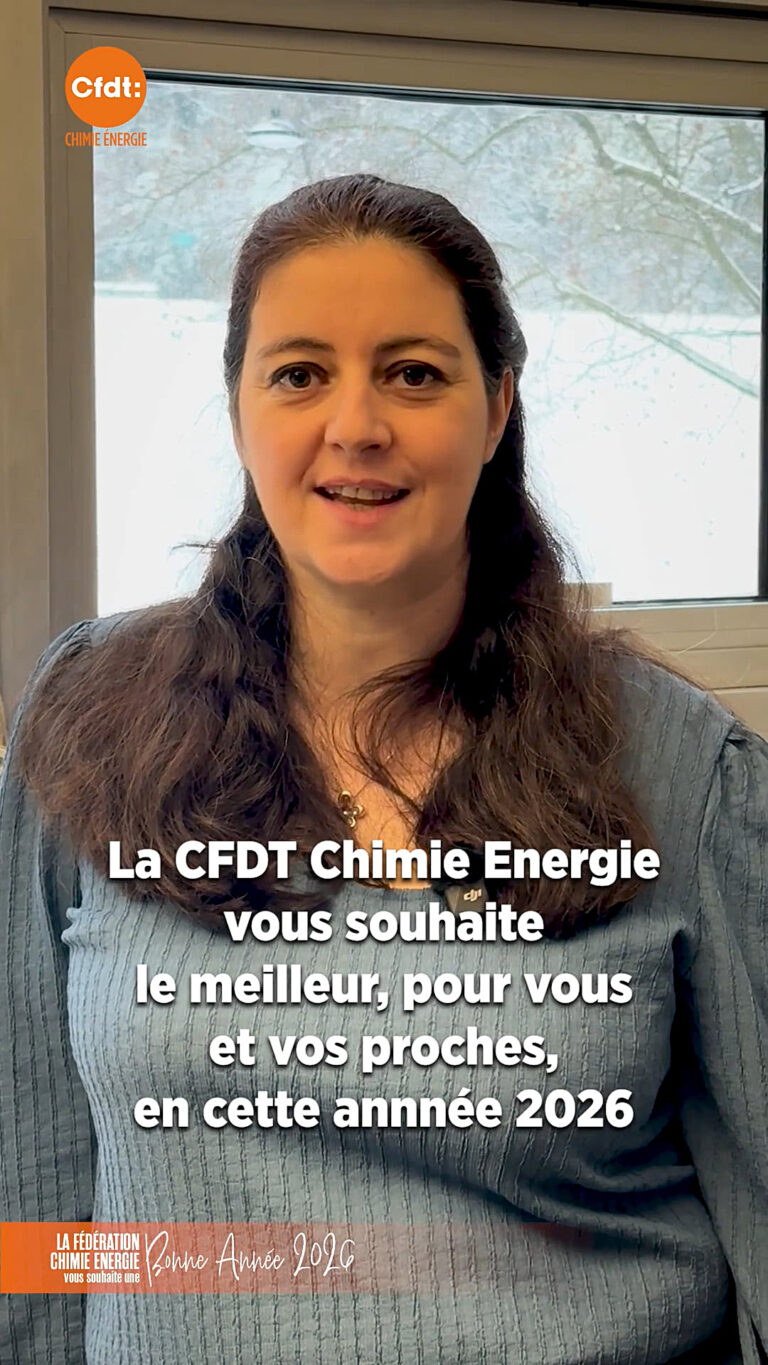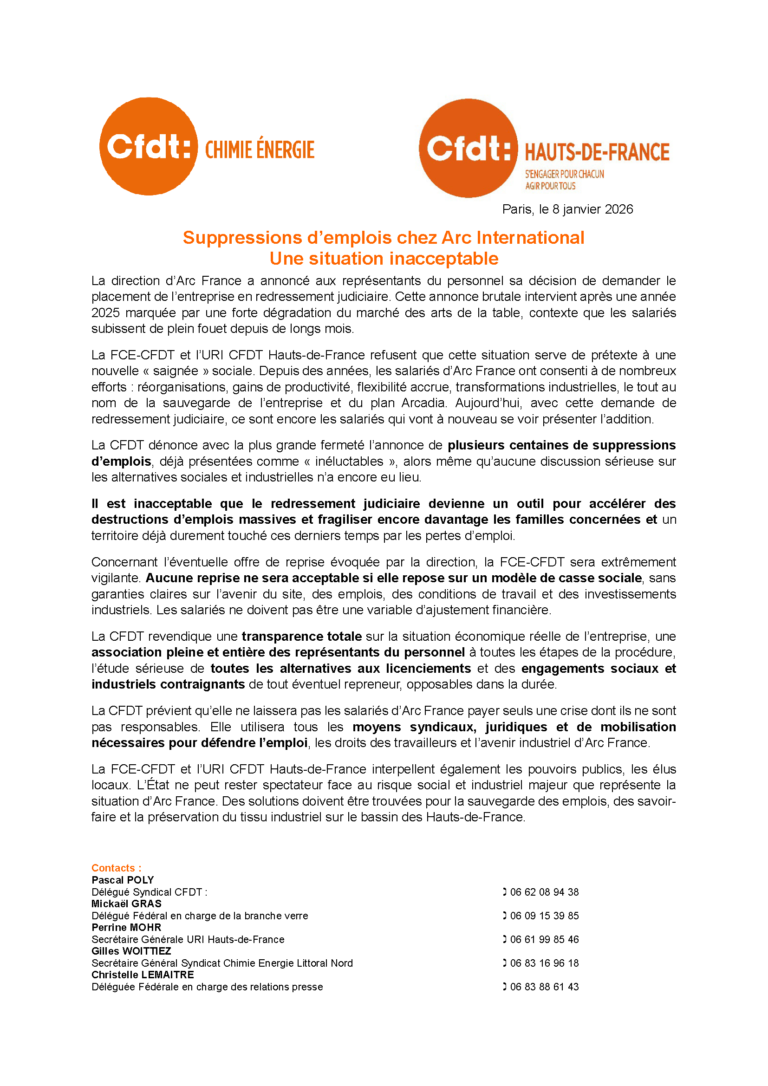Selon plusieurs enquêtes récentes, six français sur dix ne feraient plus confiance ni à la Gauche ni à la Droite, pour gouverner le pays. Et ce phénomène structurel s’est largement amplifié depuis dix ans. La crise de confiance est telle, que l’élection présidentielle n’apparaît plus comme le moyen de résoudre les problèmes, mais plutôt comme l’occasion de sanctionner, d’une façon ou d’une autre, le système. L’impression de ne plus pouvoir agir se manifeste sur un mode désabusé, voire désespéré, et de rejet systématique : moindre fréquentation des urnes, rejet de tous les gouvernements depuis 1981, repli sur soi, « passivité » des citoyens, voire vote contestataire.
Pour la FCE-CFDT, cela est inquiétant et dangereux pour l’avenir. La défiance, transformée en suspicion permanente, génère aussi un poison, le populisme qui stérilise la démocratie. C’est bien alors la question du type de démocratie que nous voulons et de son fonctionnement qui est posée. Alors démocratie directe, représentative ou délégative, ou bien encore parlementaire, contractuelle, constitutionnelle, libérale, proactive, ou d’opinion ?
Plus récemment en France, apparaît aussi l’idée de la démocratie participative. L’implication et la participation des citoyens dans le débat public, et la prise de décisions politiques qui s’en suit, pourraient prendre de nouvelles formes. Une action de contrôle pour donner aux électeurs la possibilité de vérifier l’action de ceux qui les représentent. Un processus de consultation renforcé avec des procédures permettant aux citoyens, mais aussi aux corps in-termédiaires, d’exprimer leur avis sur des projets précis, par exemple en recourant au référendum. Un pouvoir de codécision, qui peut s’exercer à l’échelon local, entre élus et représentants de la société civile, sur des projets de proximité, comme c’est le cas en Allemagne, ou encore en Grande Bretagne. Cela serait facilité par une décentralisation, qui passe par la responsabilisation accrue de tous les acteurs de la société.
Bien que l’implication et la participation des citoyens à titre individuel ou collectif soient nécessaires, elles ne sont pas la solution à tous les problèmes. La démocratie participative que cela implique doit s’inscrire dans un cadre d’intérêt général. Car elle ne peut se résumer à la somme d’expressions locales ou d’intérêts particuliers. La construction d’un projet commun nécessite forcément des arbitrages.
Si nous voulons réaffirmer une démocratie représentative où chaque citoyen se sent partie prenante, ce sont ces nouvelles pratiques participatives qu’il nous faut impulser.