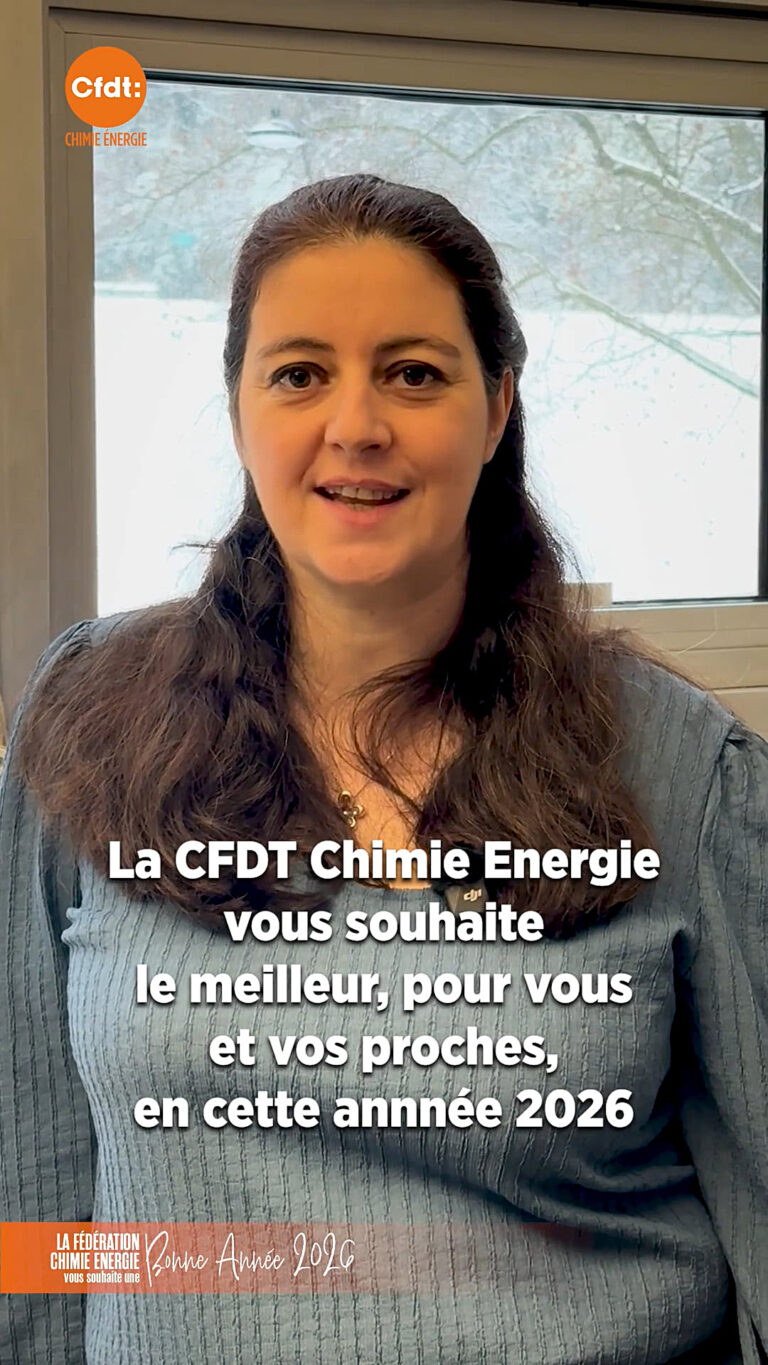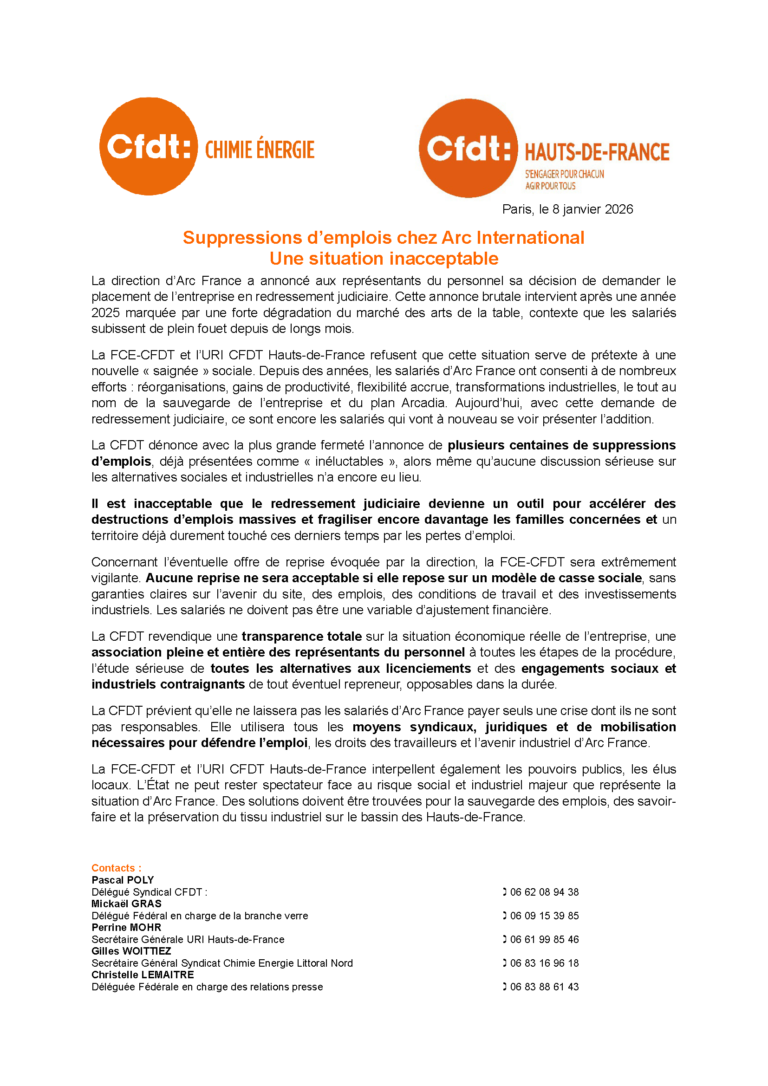Le 17 janvier 1975, la Loi Veil était promulguée. En légalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG), elle a permis de mettre fin aux avortements clandestins. Estimés à 300 000 par an à l’époque, ils provoquaient le décès de 300 femmes par an en France, de nombreuses stérilités, des séquelles graves et des souffrances atroces
Pour comprendre aujourd’hui l’ampleur et le caractère historique de cette date, il faut rappeler qu’une loi votée en 1920, non seulement pénalisait l’avortement, mais interdisait aussi la « propagande anticonceptionnelle « , c’est-à-dire toute information sur la contraception. Les médecins n’avaient alors pas le droit de conseiller les femmes à connaître leur corps, de leur parler de période de fécondité, ni de méthode de courbe de température. En 1943, deux femmes, Marie-Louise Giraud et Désirée Pioge, seront guillotinées pour avoir pratiqué des avortements.
La lutte des femmes pour la liberté de choisir leur maternité et de disposer librement de leur corps fut donc un long combat. Il prendra de l’ampleur au fur et à mesure que le poids et l’importance sociologique et politique des femmes augmenteront dans la société. La création du Mouvement français pour le planning familial, la publication par le Nouvel Observateur du « Manifeste des 343 », le procès de Bobigny et la fondation du Mouvement pour la libération de l’avortement et de la contraception seront autant d’étapes qui permettront aux militantes féministes de faire passer les femmes d’une situation individualisée de clandestinité honteuse et réprimée à l’affirmation d’un droit revendiqué, organisé collectivement et bientôt légitimé par la loi (voir encadré).
Le syndicalisme et la CFDT n’échapperont pas à ce débat et ce choix de société. La féminisation du salariat, la syndicalisation des femmes, l’augmentation du nombre de militantes permettront progressivement à notre organisation de prendre en compte ce débat d’abord, d’affirmer ensuite sa solidarité auprès de lui. Le droit des femmes à disposer librement de leur corps rejoignait des valeurs et des revendications profondes de notre organisation telles que la liberté de choix, l’émancipation, l’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour une femme, avoir la possibilité de décider du moment où l’on veut un enfant était aussi une des conditions à réunir pour pouvoir effectuer des études, obtenir des diplômes et mieux gérer sa carrière professionnelle. Mais ce qui nous paraît aujourd’hui évident ne s’imposera pourtant pas naturellement.
En 1967, la loi relative à la régulation des naissances, dite Loi Neuwirth, autorise la fabrication, l’importation et la vente de contraceptifs sur ordonnance médicale. Mais elle interdit toute publication commerciale ou propagande antinataliste. Il faudra attendre 1974 pour que cette loi soit libéralisée.
Lorsque le 29 novembre 1974, Simone Veil fait voter son projet de loi à l’Assemblée nationale par 284 voix contre 189, ce sera grâce aux voix de l’opposition de gauche. Les deux tiers de la majorité de droite ayant voté contre. Dans une assemblée qui compte alors 9 femmes sur 490 députés, Simone Veil, rescapée du camp de concentration d’Auschwitz, subit les insultes et les amalgames. Des députés de droite déraperont même et n’hésiteront pas à parler de génocide et de fours crématoires pour y jeter les embryons
En 30 ans, les faits ont parlé. La natalité est aujourd’hui plus forte en France qu’à l’époque où la contraception et l’IVG étaient interdites. Nous sommes passés, majoritairement, d’une maternité contrainte à une maternité choisie. Moins d’une femme ne décède aujourd’hui par an à cause de l’avortement.
Mais beaucoup reste à faire. Peu de centres pratiquent l’IVG. Dans l’univers hospitalier, elle reste encore la dernière roue du carrosse. Et les délais autorisés par la loi sont alors vite dépassés. L’information sur la contraception n’est aussi pas assez prise en charge. Elle reste trop souvent l’affaire des seules femmes. Enfin, les lobby natalistes et religieux n’ont malheureusement pas désarmé. Comme nous le dit Simone Veil, les mentalités peuvent vite changer et les femmes ont raison de rester vigilantes. Une chose est sûre, la CFDT tout entière sera à leurs côtés.
/ A lire
Simone Veil, Les hommes aussi s’en souviennent, Editions Stock, novembre 2004.
Le Code civil considère l’avortement comme crime passible d’emprisonnement.
L’avortement est considéré comme crime contre la sûreté de l’État. Il est passible de la peine de mort.
Création de la Maternité heureuse. Elle lutte pour la légalisation de la contraception. Elle deviendra le Mouvement français pour le planning familial en 1960.
La Loi Neuwirth, relative à la régulation des naissances, autorise la fabrication, l’importation et la vente de contraceptifs. Mais toute publicité commerciale ou propagande antinataliste est interdite.
Publication d’un manifeste signé par 343 femmes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités, qui déclarent avoir avorté et réclament l’avortement libre. Fondation du mouvement Choisir par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir.
Procès de Bobigny. Poursuivie pour s’être fait avorter, Marie-Claire Chevalier est relaxée.
Fondation du Mouvement pour la libération de l’avortement et de la contraception.
Procédure législative et débats houleux. L’Assemblée nationale vote le projet de loi légalisant l’IVG.
La Loi Veil est promulguée pour une période de cinq ans.
La Loi Veil est reconduite à titre définitif.
La Loi Roudy permet le remboursement de l’IVG par la Sécurité sociale.
La Loi Neiertz crée le délit d’entrave à l’IVG. Les premières peines de prison sont prononcées contre les membres d’un commando anti-IVG.
Vive polémique. Le gouvernement renonce à la création d’un délit d’IVG lors du vote d’une loi contre la criminalité.
Autorisation de l’IVG médicamenteuse prescrite par un gynécologue.