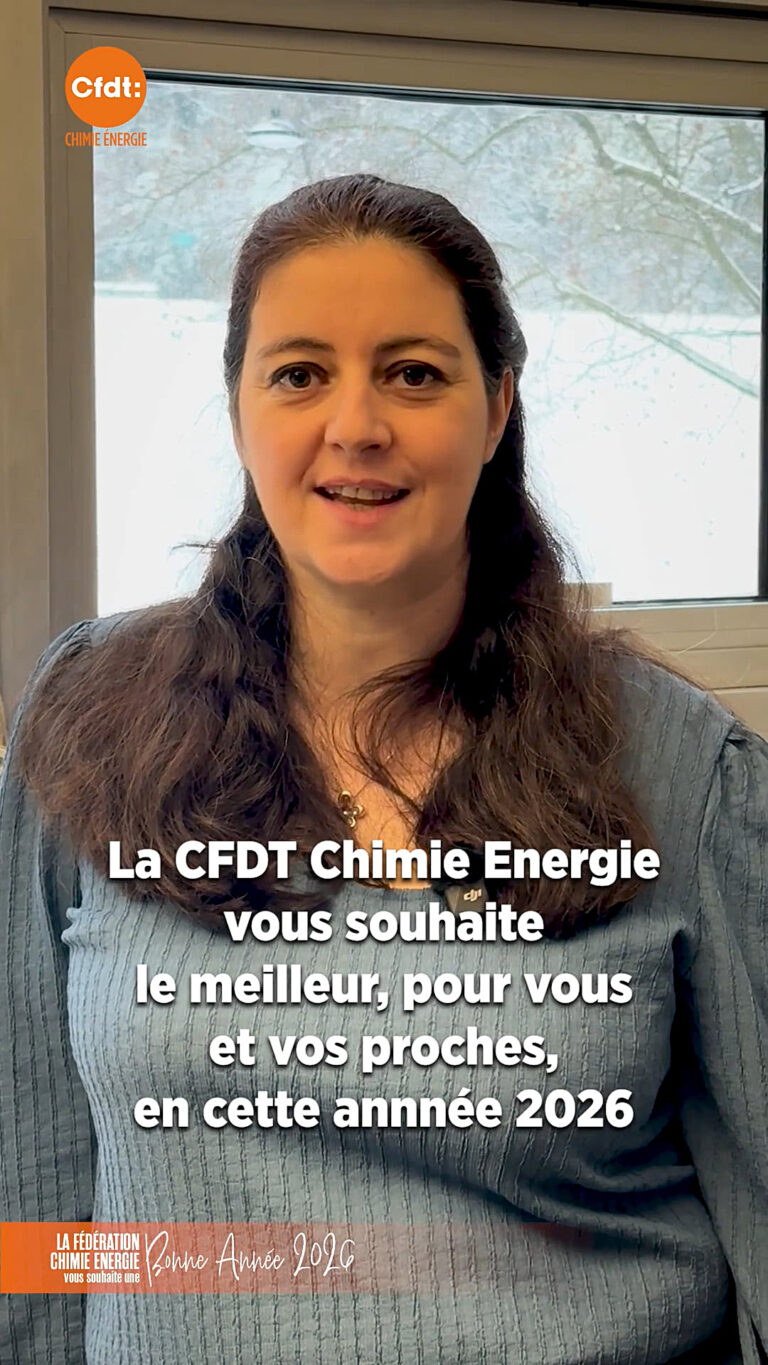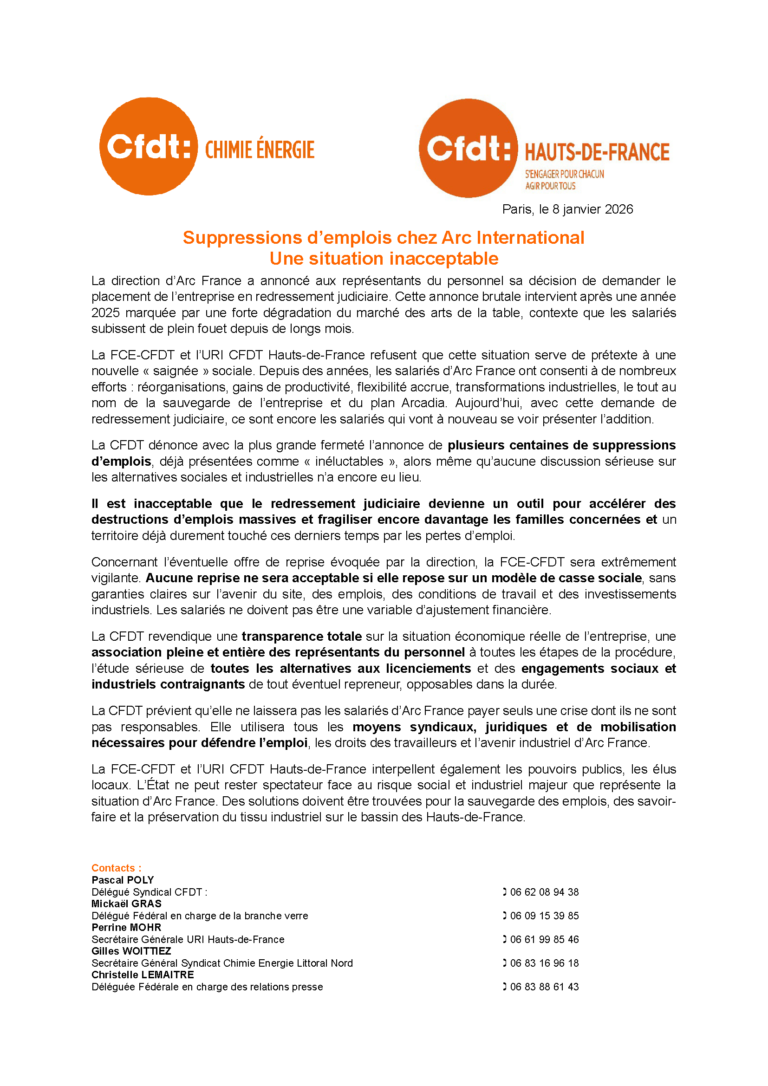Alors que nous fêtons cette année son 50e anniversaire, il faut noter les difficultés du dialogue social au niveau européen, et en regarder l’ensemble des aspects afin de mieux cerner les pistes possibles de son amélioration.
En trente ans, la structure des emplois a particulièrement changé en Europe, beaucoup d’emplois ayant été détruits par les restructurations successives qui ont particulièrement touché les domaines de l’industrie. Le dialogue social est donc plus que jamais nécessaire pour une meilleure prise en compte des questions sociales au même titre que les questions industrielles, économiques, environnementales. D’autant que dans le domaine de l’industrie, ces phénomènes s’observent à l’échelle transnationale. Cependant, les temps européens du dialogue social et du droit communautaire ne sont pas les temps des entreprises. L’accélération des évolutions, consécutive à la globalisation des marchés, prend le pas sur la lente mise en œuvre de nouvelles normes sociales communautaires. Le dialogue social devient dès lors un enjeu pour l’innovation sociale et la définition de nouvelles solidarités.
Un contexte bouleversé par les défis de l’élargissement . L’impact économique et social de l’élargissement est à la mesure de l’importance de l’évènement pour l’Union européenne, qui a accueilli dernièrement plus de 100 millions d’habitants et près de 40 millions de travailleurs supplémentaires. Le risque d’affaiblissement du dialogue social européen est donc sérieux, compte tenu des insuffisances des systèmes de relations industrielles, identifiées par la Commission européenne comme par la Fondation de Dublin.
Plusieurs défis sont à relever dans ce nouveau contexte. Le premier est le manque de structuration des partenaires sociaux. La faible densité syndicale et la réticence des employeurs à adhérer aux organisations patronales posent un problème crucial pour l’Union quant à la représentativité des acteurs. D’autant que la plupart des fédérations européennes d’employeurs n’envisagent leurs organisations que comme structures d’influence au service de leurs intérêts économiques, sans mandat social. Le deuxième défi réside dans l’importante décentralisation des systèmes de négociations collectives, qui se concentrent désormais bien plus au niveau de l’entreprise, et sont particulièrement faibles au niveau de la branche, « chaînon manquant » de la négociation collective pour la Commission européenne. Enfin, le troisième défi réside dans le développement du dialogue social européen bi-partite, rendu aléatoire par la faiblesse des partenaires sociaux et la tentation de repli nationaliste qui, au regard de l’élargissement, voit les acteurs syndicaux et patronaux des pays d’Europe de l’Ouest et du Nord vouloir chacun préserver leur modèle social.
Cette situation doit évoluer, mais elle constitue un frein au développement de nouvelles normes sociales européennes, tant les écarts grandissent entre les attentes des uns et des autres. Elle laisse aussi le champ libre à des expérimentations sociales qui ne sont soumises à aucune règle, et qui pourraient bien devenir la norme.
Si des outils existent, force est de constater que le dialogue social est face à une nouvelle donne que le droit communautaire tarde à prendre en compte. Les multinationales sont confrontées à de plus en plus de fusions et d’acquisitions ; les questions liées au développement durable de plus en plus présentes. Ce mouvement permanent conduit à l’émergence de négociations collectives transnationales sectorielles ou d’entreprise, qui ne sont encadrées par aucune législation communautaire.
La négociation collective transnationale d’entreprise devient un enjeu pour les salariés comme pour les entreprises. Cela vient naturellement percuter et affaiblir la négociation collective de branche lorsqu’elle existe, quand ça ne risque pas de remettre en cause la convention collective. En ce sens, l’absence de législation en la matière offre l’opportunité aux multinationales de définir le droit par la négociation d’accords volontaires, conclus avec les représentants des salariés de leur entreprise.
Le modèle économique et social européen est soumis à un changement permanent. Une nouvelle dynamique sociale et politique s’impose donc. Pour cette raison, la responsabilité sociale des entreprises est directement interrogée lorsqu’on parle de restructuration industrielle des entreprises. Seul le modèle social allemand intègre généralement dans la gouvernance de l’entreprise les représentants des travailleurs qui sont associés à la définition des stratégies. Dans les 26 autres pays d’Europe, le dialogue social n’atteint pas ce niveau de discussion. Par conséquent, parler de responsabilité sociale des entreprises signifie articuler les questions économiques, industrielles, environnementales et sociales. Il ne s’agit pas de discuter simplement de choses sociétales, mais de dialoguer véritablement sur les problématiques qui se posent aux salariés : l’avenir de leur entreprise, leur avenir personnel dans le cadre des restructurations successives. C’est la raison pour laquelle le dialogue social et la question des accords transnationaux sont étroitement liés lorsqu’on parle de restructurations des entreprises.