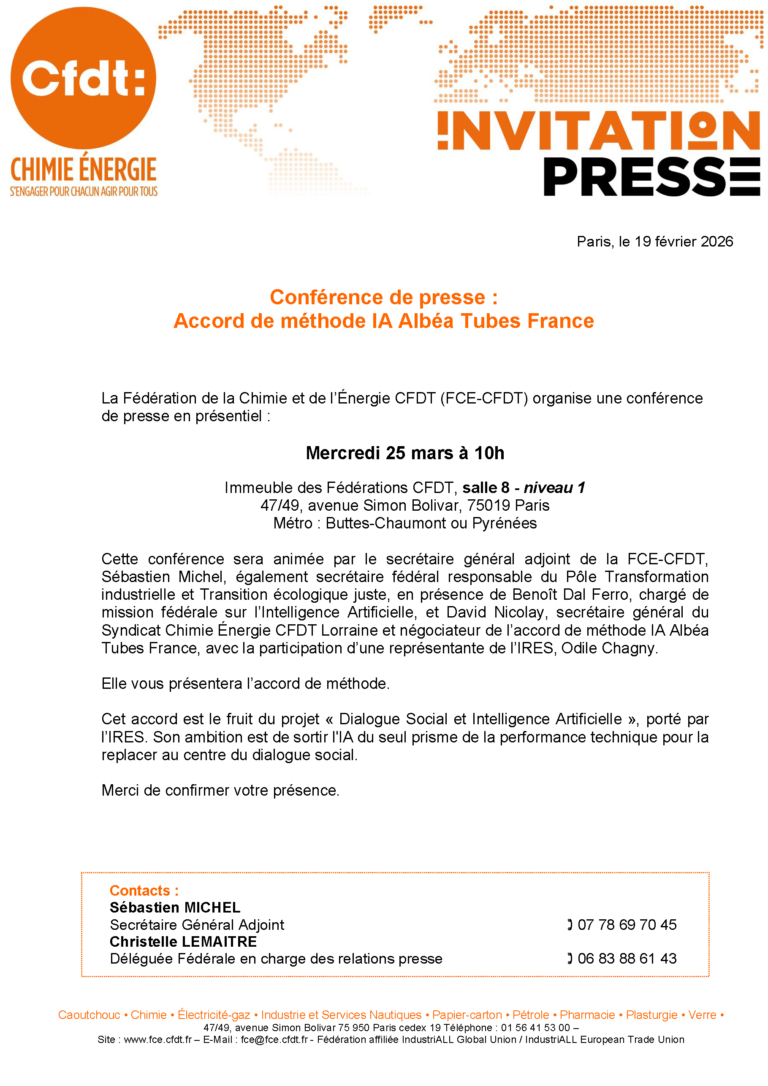Sept ans après le naufrage de l’Erika, le procès s’est enfin ouvert le 12 février dernier. Il devrait durer quatre mois. Sans faire ici le procès à la place du Tribunal correctionnel de Paris, la FCE-CFDT peut faire néanmoins le bilan des dispositions prises par les différents acteurs.
Aussitôt après la catastrophe, la FCE avait pointé du doigt les problèmes que soulevait le naufrage. « Les pétroliers ne se sentent pas responsables de cette catastrophe, parce qu’ils refusent désormais de prendre à leur charge une partie des risques inhérents à leur activité. Le transport maritime des produits pétroliers est une des nombreuses activités que les pétroliers considèrent comme ne faisant plus partie de ce qu’ils nomment
le cœur de leur métier. » En d’autres termes, ni responsables ni coupables… Il est probable que le procès fasse apparaître plusieurs niveaux de responsabilité. D’autant que l’enquête du juge se résume en une phrase : le naufrage n’était pas inéluctable. Mais résulte d’une cascade de négligences et d’incuries, de l’exploitation à outrance du navire, des règles opaques du commerce maritime et des pavillons de complaisance.
Sept ans après, l’Union européenne a durci ses règles de contrôle maritime au travers de trois directives. Les directives Erika-I, II et III ont institué plusieurs mesures fortes destinées à renforcer la sécurité et à lutter contre les pollueurs : élimination des pétroliers à simple coque, mise en place d’une inspection annuelle, contrôle renforcé des sociétés de classification, ou encore responsabilité plus accrue des propriétaires et des opérateurs. Sept ans après, si l’Etat français a anticipé l’application des directives européennes, il n’a toujours pas impulsé de mise à plat des pavillons de complaisance pour contribuer à l’élaboration de nouvelles normes internationales. Sept ans après, la sous-traitance de toute activité qui n’est pas le cœur de métier, prédomine toujours, transférant ainsi les risques industriels, environnementaux et sociaux aux sous-traitants. Et cette stratégie de profit maximum a encore de beaux jours devant elle. Sept ans après, Total plaide toujours non coupable, trompé qu’il a été par la société italienne d’homologation, à l’entendre.
Face à ce bilan mitigé, se posent encore les mêmes questions. Pourquoi faut-il des lois pour mieux garantir la sécurité ? Pourquoi les entreprises n’appliquent-elles pas des normes plus rigoureuses ? La responsabilité sociétale des entreprises (RSE), telle que la conçoit la CFDT, ne s’est donc pas complètement concrétisée à ce jour. Pour la FCE, RSE signifie que les entreprises sont responsables de la situation et du devenir de leurs salariés, mais aussi des conséquences de leur activité sur les usagers, les clients, les consommateurs, les territoires et l’environnement. L’histoire industrielle nous montre qu’il reste du chemin à parcourir. La CFDT continuera d’agir pour que la RSE prenne enfin tout son sens.