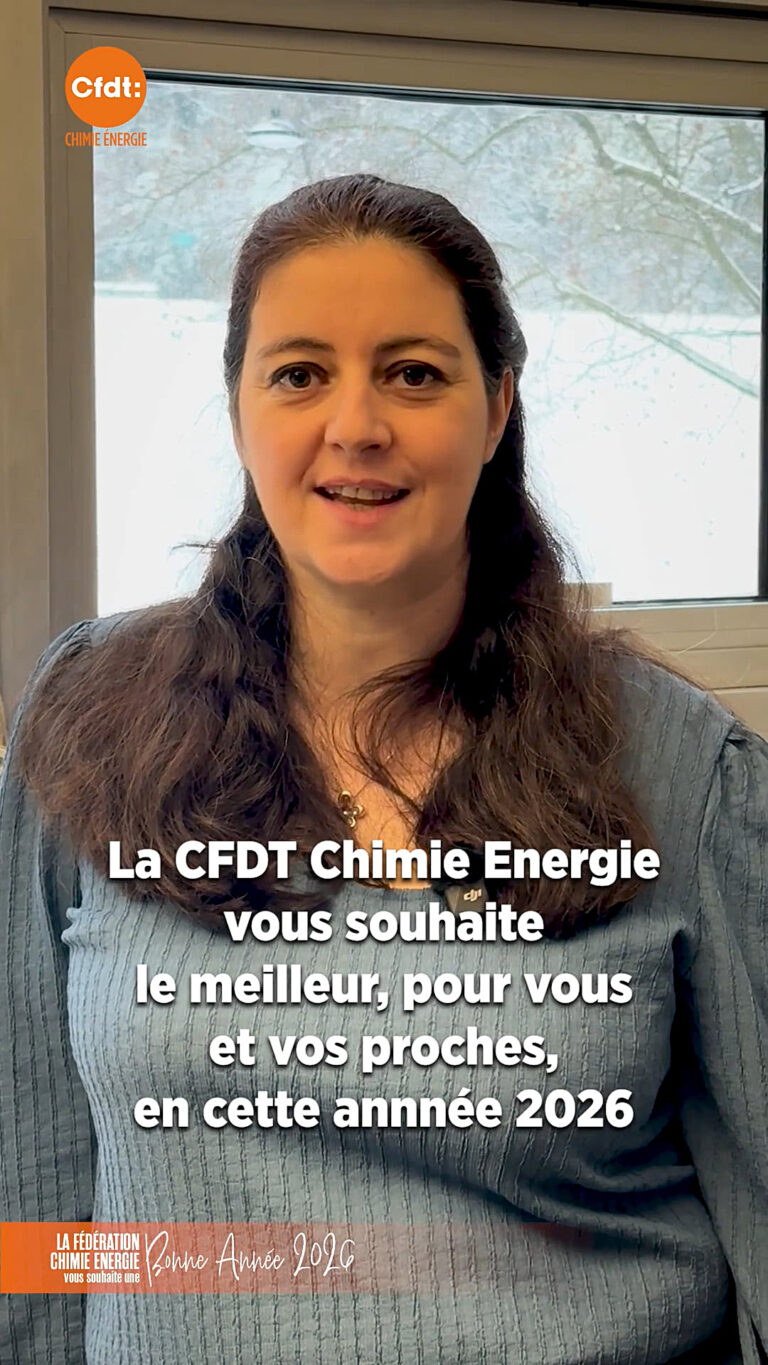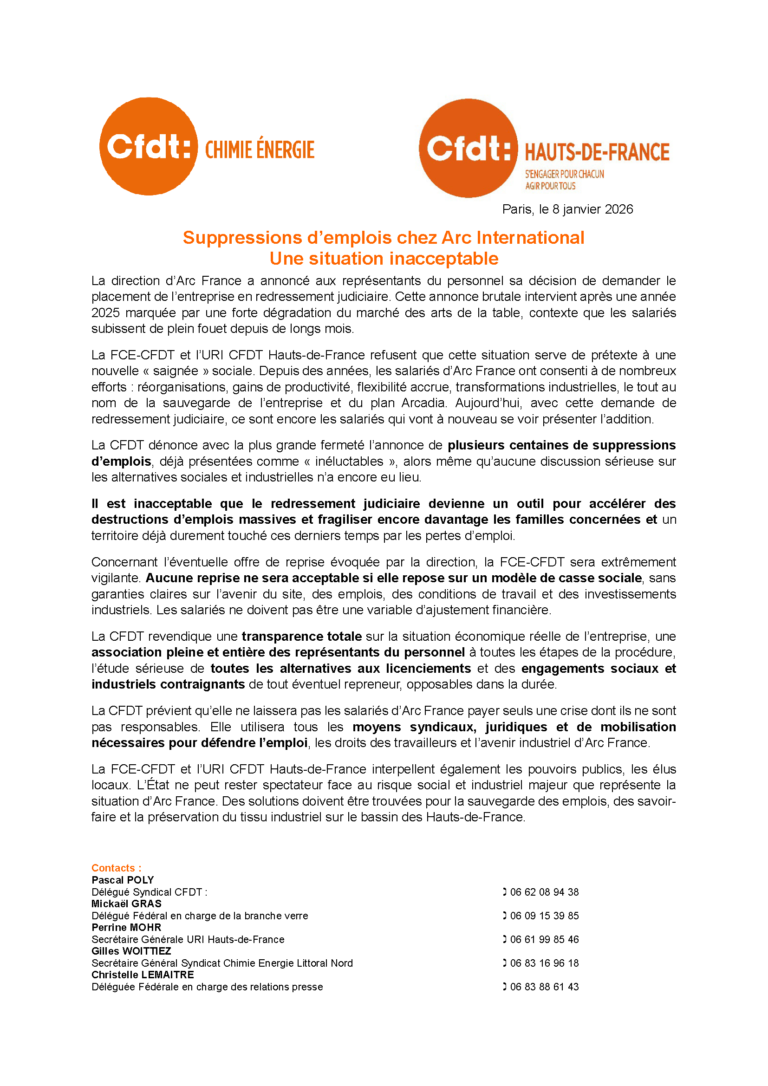Le traité de Lisbonne est finalement entré en vigueur le 1er décembre 2009. C’est dans un silence médiatique et politique assourdissant qu’un pas décisif dans l’Union européenne (UE) a été fait. Le traité a enfin été ratifié par ses 27 Etats membres. Des référendums irlandais aux atermoiements tchèques, cette période fut un véritable casse-tête.
Cette avancée se concrétise dans un premier temps par la désignation de ceux qui seront les nouveaux visages de l’Union européenne. En effet, un président du conseil européen et un ministre des affaires étrangères auront la lourde tâche d’exprimer une parole européenne unifiée. Sur le plan institutionnel, d’autres avancées significatives vont permettre à l’UE de gagner en efficacité et en visibilité politique. La nouvelle règle de double majorité pour les décisions et une meilleure articulation entre les politiques communautaires et les débats parlementaires nationaux devraient participer aussi à un renforcement de cette Europe.
Ce nouveau traité contient aussi des avancées sociales non négligeables. Bien que la charte des droits fondamentaux soit relayée en annexe, elle prend une valeur juridique contraignante. On peut cependant regretter la dérogation octroyée concernant sa mise en œuvre en Pologne, au Royaume-Uni et en République Tchèque. Au-delà de cette exception, le traité renforce les objectifs sociaux de l’UE en mentionnant l’économie sociale de marché, le plein emploi et le progrès social, la lutte contre l’exclusion sociale et les discriminations, la promotion de la justice et de la protection sociale. Une clause prévoit explicitement la prise en compte de ces éléments dans les politiques de l’Union.
Dans le même temps, le renforcement du dialogue social et la place des partenaires sociaux sont promus comme éléments essentiels du modèle européen. Il est même précisé que le sommet social tripartite (partenaires sociaux, membres du conseil européen et la commission) pour la croissance et l’emploi, contribue au dialogue social.
Encore une avancée à souligner et non des moindres concerne la reconnaissance des services publics. Le traité de Lisbonne donne une base juridique aux services d’intérêt économique général. Cela permettra aux institutions européennes de légiférer sur les principes et conditions de leur mise en place et de leur fonctionnement.
Un protocole ayant même valeur que le traité rappelle la compétence exclusive des Etats membres pour la fourniture, la mise en service et l’organisation des services non économiques d’intérêt général (santé, éducation,…). Ce texte vise à rassurer ceux qui craignaient l’ouverture de ces services à la concurrence.
Toutes ces avancées imposent au syndicalisme, et aux partenaires sociaux plus largement, d’être responsables en étant moteur dans la construction de l’Europe sociale à travers des négociations à ouvrir, des compromis à trouver afin de gagner des avancées significatives pour le salarié et le citoyen européen.