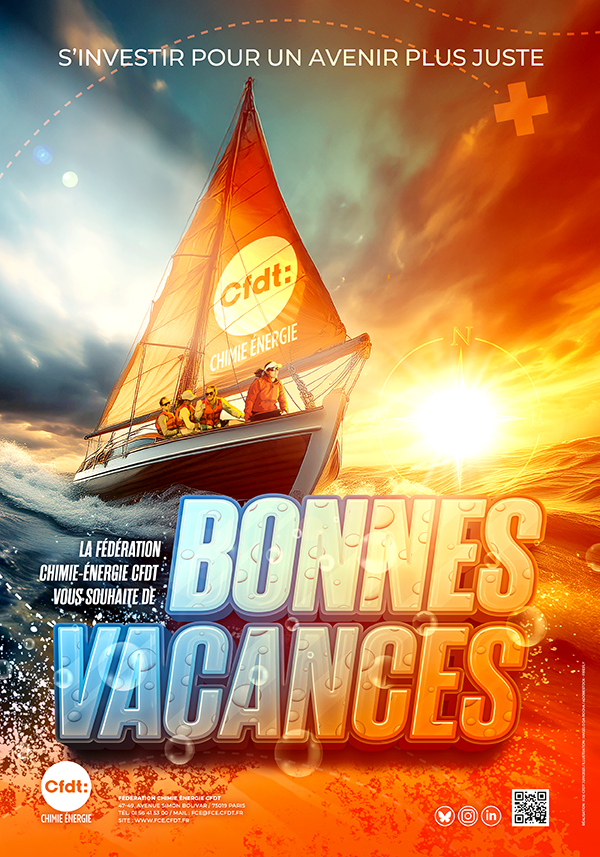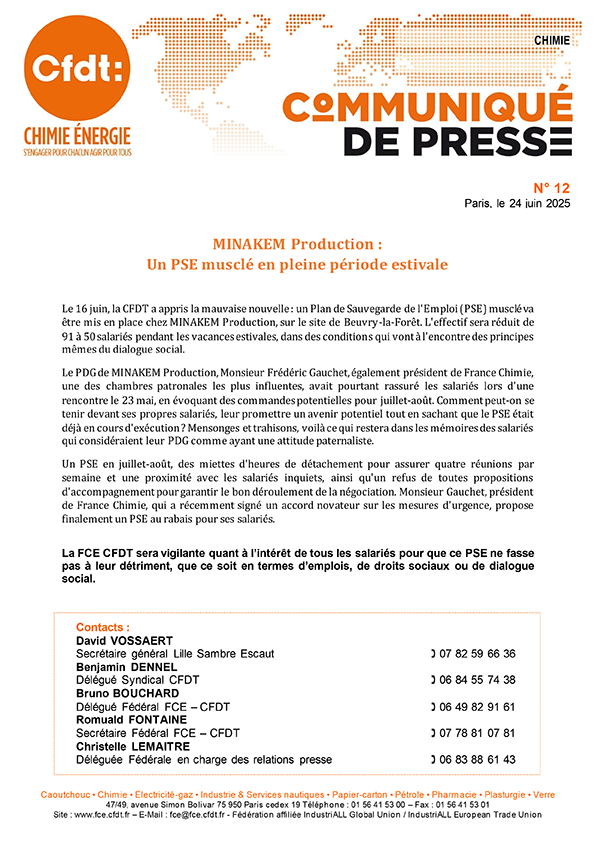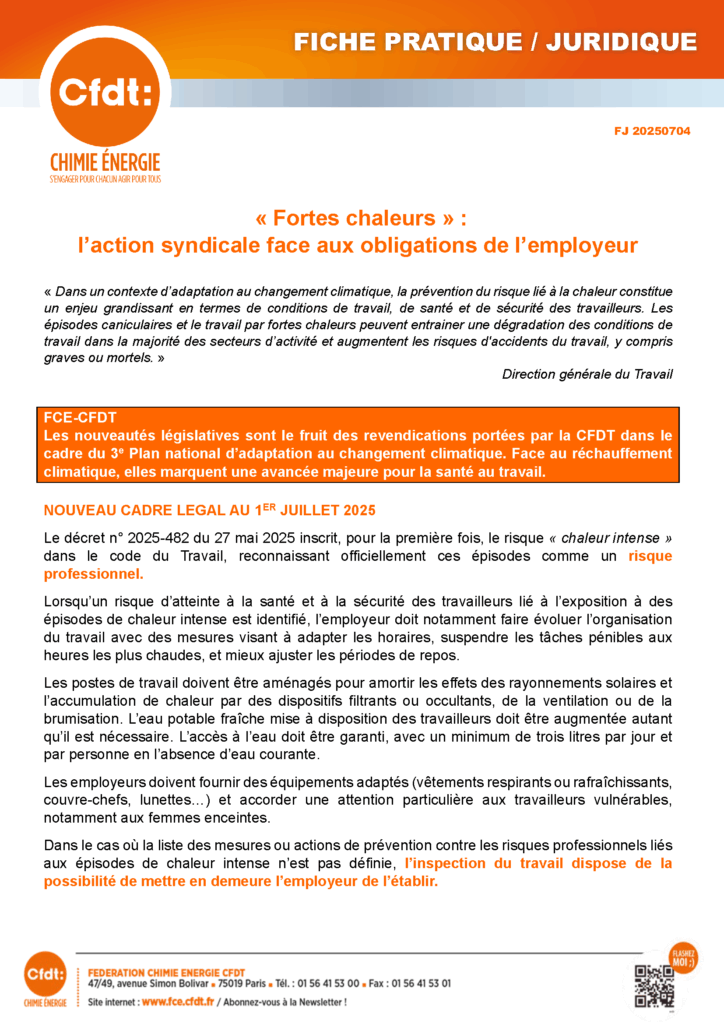La volonté des équipes militantes lors des négociations salariales est bien d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés. Mais le maintien ou l’amélioration du pouvoir d’achat se limite-t-il aux seules augmentations de salaires ? Pouvoir d’achat, quelles définitions, quelles réalités ? Quels leviers syndicaux ? Dissection d’un vocable aux multiples facettes.
Le terme de pouvoir d’achat est abondamment utilisé par les différents acteurs économiques, sans qu’il recouvre nécessairement la même acception dans l’esprit de chacun. Pour le consommateur, son pouvoir d’achat représente sa capacité à acquérir des biens et des services. En cela, il a un point de vue microéconomique. Sa conception du pouvoir d’achat s’apparente plutôt à celle du coût de la vie. L’INSEE au contraire, développe une analyse conjoncturelle et macroéconomique qui est de fait une mesure globale qui couvre l’ensemble des ménages. La notion usuelle de « pouvoir d’achat » utilisée par l’INSEE est celle du revenu disponible brut (RDB).
Pour l’INSEE, l’évolution du pouvoir d’achat est égale à :
Evolution du revenu disponible brut des ménages – (moins) évolution des prix
Evolution du pouvoir d’achat et ressenti de l’opinion
Les Français considèrent depuis des années et notamment depuis le passage à l’euro en 2002, que leur pouvoir d’achat est en baisse. Les statistiques de l’INSEE sont quant à elles formelles : leur pouvoir d’achat continue d’augmenter, sauf en 2011 où il stagne et diminue même sur les deux derniers trimestres. Pour 2012, l’INSEE a revu récemment ses prévisions à la baisse.
Quelles sont les raisons de ce décalage ?
– L’INSEE réalise une mesure globale sur l’ensemble des ménages. Or, cette mesure ne reflète pas la multiplicité des situations et des changements individuels. Par exemple, sont mal pris en compte les effets de la « décohabitation » lors des divorces et qui entraînent un appauvrissement réel des ménages.
Cette mesure très globale est désormais accompagnée de données complémentaires, les unités de consommation (UC). Elles tiennent compte du fait que la vie en commun permet de réduire certaines dépenses. Deux personnes vivant sous le même toit n’ont pas besoin d’un revenu double de celui d’une personne vivant seule pour atteindre le même niveau de vie. Une personne adulte compte pour une UC, une personne supplémentaire de plus de 14 ans pour à 0,5 UC et chaque enfant de moins de 14 ans compte pour 0,3 UC. Cette mesure fait apparaître que le pouvoir d’achat de l’ensemble des ménages peut augmenter mais que le pouvoir d’achat ramené par UC, c’est-à-dire ramené à un niveau individuel, lui peut baisser.
– Les Français appréhendent souvent leur pouvoir d’achat de manière plus étroite. En effet, la plupart des ménages se focalisent sur l’évolution des prix de quelques produits spécifiques (produits alimentaires, tabac, énergie, loyer et charges, certains services comme l’éducation, les loisirs, les soins aux ménages) pour se forger une opinion sur l’évolution générale des prix. En revanche, ils y intègrent rarement des biens manufacturés, alors que ces produits représentent 30% de l’indice des prix de l’INSEE. En conséquence, pour ces ménages, l’INSEE sous-estime la « véritable » hausse des prix et donc l’indice des prix à la consommation (IPC)* n’est pas conforme à la réalité. (* La part des dépenses contraintes dans la consommation finale des ménages est ainsi passée de 15,1% à 33,1% entre 1959 et 2010. La part des dépenses contraintes dans le revenu disponible brut a plus que doublée en 50 ans, passant de 12,6% en 1959 à 27,8% en 2010).
– La vision de l’inflation par les ménages est guidée par le fait que les produits qui attirent leur attention sont souvent considérés comme des dépenses « contraintes ». Le Conseil national de l’information statistique parle de « dépenses à engagement contractuel », sommes dépensées en début de mois, avant tout arbitrage en matière de dépenses courantes.
Il s’agit essentiellement des dépenses consacrées au logement (loyers et diverses charges liées au logement), les services de téléphonie ainsi que les diverses assurances et les services financiers.
– L’IPC ne prend pas en compte l’évolution du prix d’acquisition des logements. Le prix de l’immobilier a fortement augmenté ces dernières années. De ce fait, la part du logement dans les revenus des ménages est de plus en plus importante, ce qu’ils ressentent comme une diminution de leurs moyens financiers.
L’IPC est une moyenne des indices élémentaires des prix de 1 000 familles de produits suivis tous les mois. Mais le consommateur « moyen » n’existe pas. Chaque ménage a sa propre structure de consommation, qui diffère plus ou moins de la structure générale de l’ensemble des ménages.
De nouveaux indices
Les statistiques traditionnelles de l’INSEE gardent leur pertinence pour analyser la situation conjoncturelle et macro-économique française. Elles ont été complétées par de nouveaux indicateurs permettant de mieux rendre compte des tendances de niveau de vie et de dépense. Par exemple, l’indice des prix catégoriels qui traduit l’évolution des prix de paniers spécifiques des diverses catégories de la population, le niveau de vie par individu ou encore le revenu salarial net moyen. Ils offrent une vision diversifiée des problématiques liées à la notion de pouvoir d’achat et prenant en compte toutes les dépenses des ménages, notamment en logement.
D’autres indicateurs existent comme l’indicateur BIPE-Leclerc. Il mesure le pouvoir d’achat du consommateur et non celui des ménages. « Indicateur du pouvoir d’achat libéré », il a observé une baisse de 1,5% du pouvoir d’achat du consommateur en 2011. L’Institut national de la consommation (INC) a également développé son propre indice qui déduit du revenu disponible brut, les dépenses contraintes. Toutefois ces deux indices ne sont pas exempts de critiques. La plus sérieuse porte sur la justification d’isoler des dépenses contraintes dont la définition est, par ailleurs, délicate. Ainsi, dans le panier retenu par le BIPE, les carburants ne figurent pas alors que sont présents les remboursements de crédits à la consommation et à l’habitation.
Les leviers syndicaux
L’organisation syndicale a des leviers d’actions qui visent à améliorer le pouvoir d’achat des salariés. La négociation collective sur les augmentations salariales (générales et individuelles) et autres composantes de la rémunération (primes, chèques-déjeuners,…) ont des incidences directes sur le pouvoir d’achat. La négociation de branche sur les salaires est primordiale pour les salariés des TPE/PME qui ne bénéficient pas pour la plupart d’autres augmentations. La participation, l’intéressement et l’abondement sont aussi des éléments de rémunération qui ont des effets sur le pouvoir d’achat. Les équipes syndicales agissent aussi dans les fonds communs de placement des entreprises, dans lesquels elles s’appliquent à faire fructifier durablement l’épargne salariale des salariés. L‘action de la CFDT se situe aussi au niveau du logement, au travers d’ACTION LOGEMENT (ex. 1% logement) et des commissions au comité d’établissement. Aider les salariés à accéder à un logement, les informer sur leurs droits, les accompagner dans leurs démarches, font partie des prérogatives syndicales. La CFDT s’engage aussi pour améliorer les conditions et les niveaux d’indemnisation du chômage. Enfin, les accords sur une mutuelle santé, une prévoyance collective gros risques ou une épargne retraite sont autant d’outils qui permettent d’améliorer le pouvoir d’achat des français. De même lorsque nous négocions des primes « transport » ou des incitations financières au covoiturage, ou quand nous proposons d’autres modes de calcul du prix du gaz. Cette liste n’est pas exhaustive.
? QUIZZ
Q1 – L’indice des prix à la consommation sert à mesurer l’évolution de mon pouvoir d’achat
– Oui
– Non
Q 2 – Mon pouvoir d’achat peut augmenter quand les prix montent
– Oui
– Non
Q3 – Il existe un indice des prix des produits et services vitaux que je consomme tous les jours pour me nourrir, me loger, …
– Oui
– Non
Q4 – Mes dépenses de loyer sont-elles prises en compte dans l’indice mensuel des prix à la consommation ?
– Oui
– Non
Q5 – En France, les prix augmentent en moyenne
– Plus vite que dans l’Union européenne à 27
– Au même rythme que dans l’Union européenne à 27
– Moins vite que dans l’Union européenne à 27
Q6 – Si le taux d’inflation augmente chaque année de 4 %, au bout de combien d’année, les prix vont-ils doubler ?
– 6 ans
– 12 ans
– 18 ans
– 25 ans
Q7 – J’ai acheté pour la dernière fois une baguette en franc en décembre 2001 :
– Moins de 2 francs (moins de 0,30 euros)
– Entre 2 et 4 francs (entre 0,30 et 0,61 euros)
– Plus de 4 francs (plus de 0,61 euros)
Q8 – Quel est le panier moyen d’un consommateur français (en 2011) ?
– 67,45 euros
-112,56 euros
– 137,60 euros
Q9 – Quelle part le logement représente-t-il dans le budget des français ?
– 11,7 %
– 18,2 %
– 25 %
Q 10 – Au-delà de quel montant se situent les salaires nets des 10 % de français les mieux payés ?
– 3267 euros
– 5274 euros
– 8751 euros
REPONSES DU QUIZZ
?Q1 – Non
L’évolution du pouvoir d’achat est calculée comme l’évolution des revenus diminuée de l’évolution de l’indice des prix. L’évolution des revenus est donc estimée à partir du
« revenu disponible brut ».
Q2 – Oui
L’évolution du pouvoir d’achat est égale à l’évolution des revenus diminuée de l’évolution des prix. Si la croissance des revenus est supérieure à celle des prix des produits et services, le pouvoir d’achat augmente.
Q3 – Ni oui ni non
Un tel indice n’existe pas Et ceci parce qu’il n’y a pas de consensus sur les produits de consommation courants ou vitaux. Toutefois l’INSEE publie des évolutions de prix à un niveau fin. A partir de ces évolutions et pondérations fournies, chacun peut calculer un indice de prix à la consommation des produits et services qu’il juge vitaux ou courants, à l’aide d’un simulateur.
Q4 -Oui jusqu’à 7%
La part des loyers dans l’IPC mensuel est de 7%. Il s’agit d’un taux moyen calculé pour l’ensemble des ménages, locataires ou propriétaires.
Par contre, l’IPC ne retient pas les remboursements des emprunts liés à l’achat d’un logement, du fait qu’ils relèvent d’opérations financières. Il ne retient pas non plus l’acquisition d’un logement qui est considéré comme un placement financier.
Q5 – Les prix en France augmentent au même rythme que dans l’UE des 27
Q6 – 18 ans
Même avec un taux d’inflation annuelle de 4% , les prix doublent au bout de 18 ans parce les hausses se cumulent d’année en année. La Banque centrale européenne cherche à contenir le taux d’inflation au niveau de 2%, dans ce cadre les prix double en 35 ans.
Q7 – 4,39 francs (0,67 euros)
En décembre 2001, une baguette de pain ordinaire de 250 gr coûtait en moyenne 4,39 francs (0,67 euros )en France métropolitaine. En décembre 2010, une baguette coûtait 0,84 euros, soit une augmentation de 25% (2,7% en moyenne par an).
Q8 – 137,6 euros
Le panier moyen élaboré par l’association de défense des consommateurs « Familles rurales » comprend 35 produits de consommation courante (eaux, biscuits, jus de fruits, desserts, confiture, produits laitiers,…). Il a grimpé de 4,4% en 2011 avec la flambée de certains produits comme les jus de fruits. En revanche si l’on compare la moyenne des prix en 2010 et en 2011, la progression n’est plus que de 1,5%, une hausse inférieure donc aux 4,4% pour la seule année 2011.
Q9 – 18,2%
Ce chiffre est une moyenne sur l’ensemble de la France métropolitaine. Elle cache d’importantes diversités. Ainsi dans les grandes villes, la part du logement dans le budget des ménages peut atteindre plus de 30%, voire 40% dans la région parisienne.
Q10 -3267 euros
50% des français gagnent moins de 1644 euros dont 10% moins de 1128 euros. 1% des français gagnent plus de 7499euros