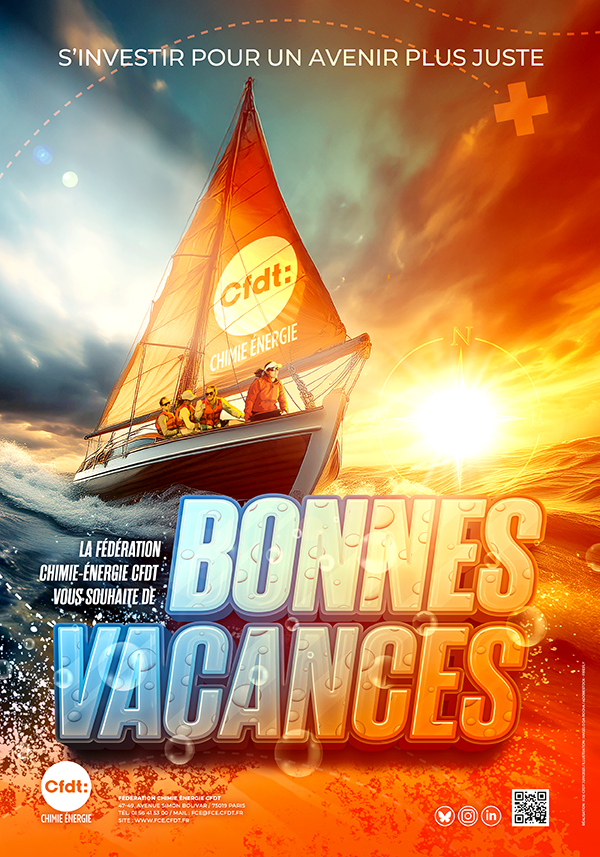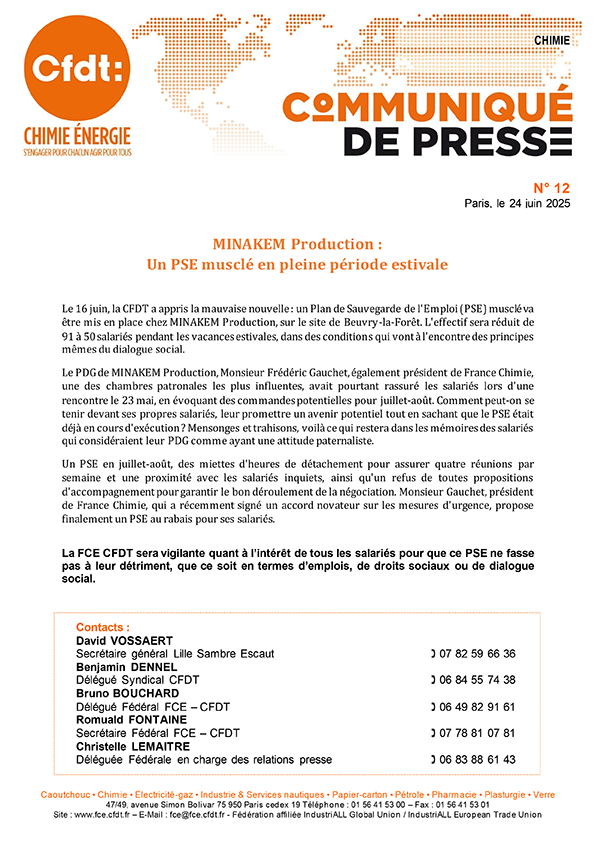Dans trois arrêts du 13 septembre 2023*, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé pour garantir une meilleure effectivité des droits des salariés.
La France a été sanctionnée à plusieurs reprises par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en raison de la non-conformité de sa législation relative aux congés payés, alors même que la Cour de cassation a suggéré à de nombreuses reprises au législateur de mettre le droit français en conformité avec le droit européen.
Le 13 avril 2023 (n°21-23.054), la Cour de cassation avait déjà écarté les dispositions françaises contraires à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. La chambre sociale avait alors considéré que le salarié avait droit à des congés payés d’au moins quatre semaines du seul fait de sa qualité de travailleur, peu importe qu’il ait été absent à raison d’un arrêt de travail pour maladie.
Les solutions apportées par la Cour sont les suivantes :
Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;
En cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail ; La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile. Ainsi, la Cour de cassation assume pleinement son rôle de juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, chargé de veiller à l’application des conventions internationales.
1. Congé payé et maladie non professionnelle
Pour la CJUE, si les droits à congé peuvent être déterminés au regard des périodes de travail effectif, les périodes d’incapacité de travail, qui sont imprévisibles et indépendantes de la volonté des travailleurs, doivent également être prises en compte. La Cour de cassation, eu égard à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français, qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne. Ainsi, elle juge que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) sont en mesure de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler. La Cour de cassation va plus loin, puisqu’elle considère que le salarié malade peut prétendre, non seulement, à l’intégralité de ses droits à congés payés, mais également aux congés payés éventuellement prévus par une convention collective, au regard de l’article L. 1132-1 du code du Travail, qui interdit toute mesure discriminatoire à l’encontre des salariés, et notamment celles liées à l’état de santé de ces derniers.
2. Congés payés et accident du travail
Pour la CJUE, un salarié acquiert des congés payés sans aucune limite temporelle, et ce, quelle que soit l’origine de son accident ou de sa maladie. Il acquiert donc des CP durant toute la durée de son arrêt de travail, et non pas seulement sur une période d’une année, comme le prévoit le droit français. La Cour de cassation, eu égard à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne. Ainsi, elle juge qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an. La Cour de cassation vient ainsi affirmer qu’en cas d’accident du travail le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail.
3. Prescription du droit à l’indemnité de congé payé
Concrètement, un salarié ne peut donc pas perdre son droit à congé payé annuel si l’employeur ne l’a pas informé sur la période de prise des congés et l’ordre des départs en congé. Qu’elle soit fixée par la loi, ou de façon conventionnelle, il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés. Ce n’est que lorsque cette période s’achève que commence à courir le délai de prescription de l’indemnité de congé payé. Toutefois, en application du droit de l’Union, la Cour de cassation juge que le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé. Dans l’absolu, un salarié pourrait réclamer tous les congés payés qu’il a acquis durant ses arrêts maladies, et ce, depuis le début de sa relation de travail. En revanche, si l’employeur parvient à démontrer qu’il a permis au salarié de prendre des congés et que le salarié a refusé de les prendre, ce dernier ne pourra prétendre à aucun congé.
Attention
Lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés payés, la jurisprudence considère que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié ne peut pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu réellement bénéficier du fait de sa maladie. Ce qui est contraire à la jurisprudence de la CJUE… (CJUE, 5e ch., 21.06.12, aff. C-78/11, ANGED
c/FASGA).
En résumé :
Désormais, peu importe la nature de la maladie, tous les salariés en arrêt de travail bénéficient du droit à congé payé. Il n’y a plus de limitation temporelle pour l’acquisition des congés en cas d’accident du travail. Cette décision a une portée rétroactive, permettant aux salariés de réclamer des jours de congés perdus, même s’ils ne sont plus dans l’entreprise. Les congés payés arriérés peuvent être réclamés rétroactivement sur une période de 3 ans. La rétroactivité pourrait être plus lointaine si l’employeur n’a pas permis au salarié d’exercer son droit en temps utile. Plusieurs questions se posent concernant l’application de cette décision, comme sa validité pour les arrêts en cours et la capacité des entreprises à respecter cette nouvelle obligation. Pour la FCE-CFDT, il est important que les équipes syndicales interpellent les employeurs afin de réclamer l’ouverture d’une négociation sur la mise en œuvre de l’effectivité des droits à congés payés des travailleurs par le dialogue social. Il est essentiel que les salariés ne soient pas pénalisés par ces périodes d’incapacité de travail imprévisibles et indépendantes de leur volonté, car la finalité du droit au congé est bien de permettre aux travailleurs de se reposer et de bénéficier d’une période de détente et de loisir. Ce qui est loin d’être le cas lorsque les salariés sont en arrêt maladie…
En savoir +
- Cour de cassation 13 septembre 2023, n° 22-17.340
- Cour de cassation 13 septembre 2023, n° 22-17.638
- Cour de cassation 13 septembre 2023, n° 22-10.529