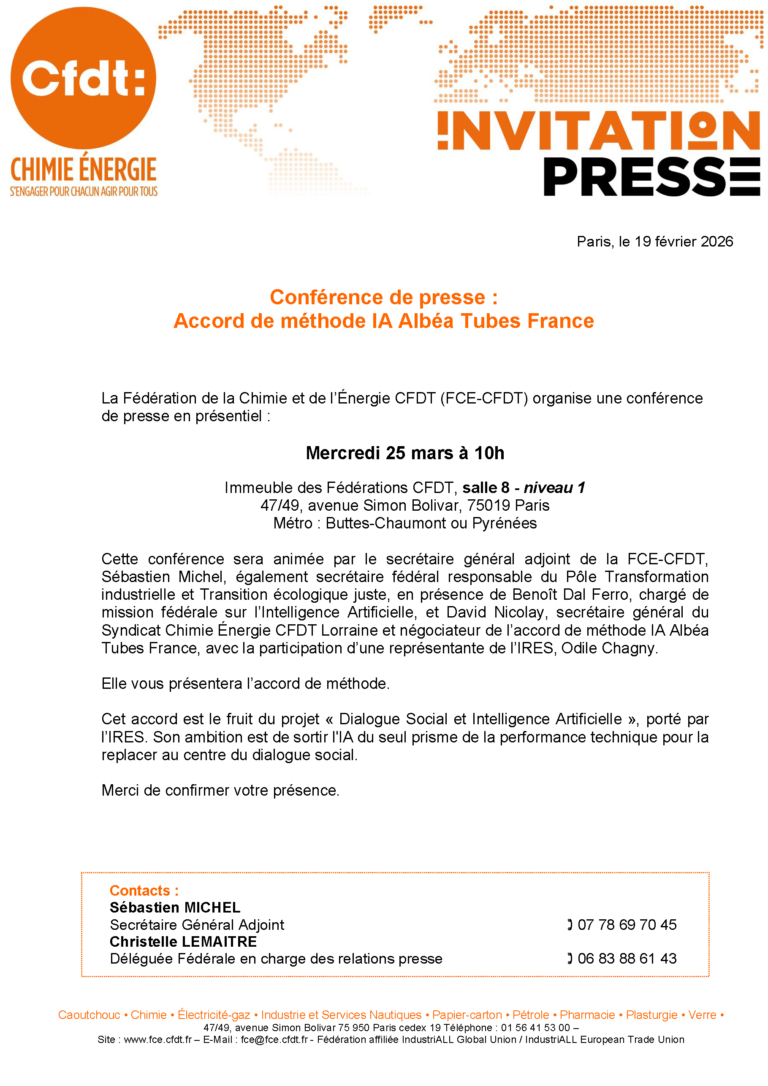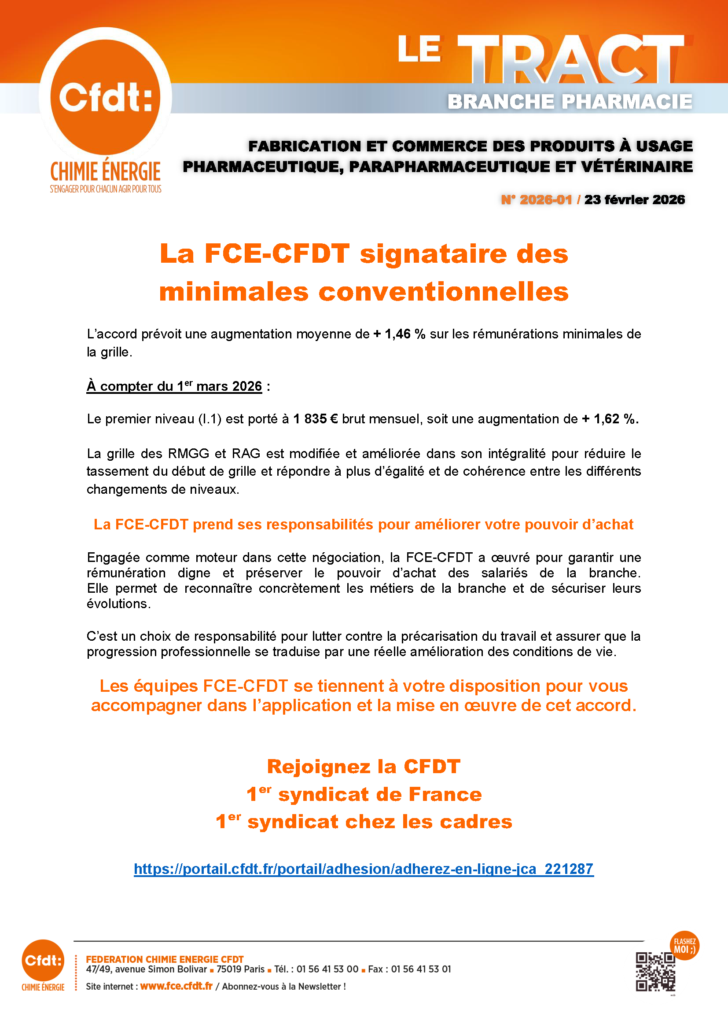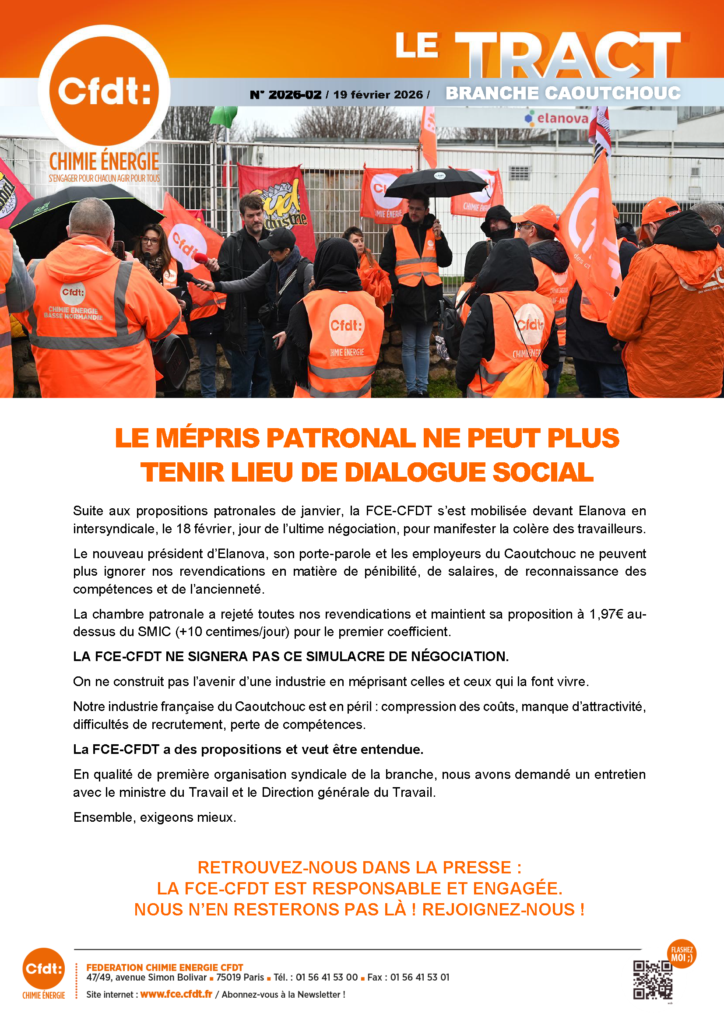des comportements à revoir dans mon entreprise et chez moi
Si l’eau est très présente sur terre, 97 % de la ressource est de l’eau salée et 2 % est bloquée sous forme de glace. Il ne reste environ que 1 % d’eau douce sous forme liquide. Dans le même temps, les réserves d’eau subissent des pollutions diverses et graves. Les fleuves et les rivières d’Europe, ainsi que les zones humides qui leur sont associées, comptent parmi les milieux ayant le plus souffert des activités de l’homme.
Une personne consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour. Cela prend en compte des usages directs (douche, vaisselle, boisson…) et des usages indirects (eau utilisée dans la fabrication de produits de consommation tels que les écrans plasma, les fruits et légumes, la viande…). Une consommation qui va de pair avec une demande toujours croissante.
La France n’est pas à l’abri !
Les pénuries d’eau ne touchent pas seulement les pays du sud : en France, cinq départements sont classés en situation «préoccupante». Le Vaucluse, le Var, les Deux-Sèvres, les Bouches du Rhône et la Charente-Maritime sont régulièrement touchés par la sécheresse.
Le réchauffement climatique n’est pas le grand responsable de la diminution des ressources d’eau.
Ce sont l’irrigation des cultures intensives et toute la chaîne agro-alimentaire qui sont très gourmands en eau. Il faut : 590 litres d’eau pour un kilo de blé, 15 500 litres pour un kilo de bœuf, 5 000 litres pour un kilo de riz, 300 litres pour un kilo de papier, 1 250 litres pour un kilo d’aluminium. L’agriculture consomme les 3/4 du volume d’eau mondial pour l’irrigation des cultures. Les agriculteurs peuvent limiter leur consommation d’eau en adoptant certaines techniques et en faisant les bons choix.
L’industrie est responsable d’environ 20 % de la consommation mondiale d’eau douce, et cette consommation industrielle augmente beaucoup depuis les années 1950.
Mais surtout, l’industrie est responsable d’une grande part des rejets polluants et toxiques dans les milieux aquatiques. Ces pollutions peuvent avoir des effets directs ou indirects sur la santé humaine mais également sur l’environnement : c’est le cas, par exemple, des métaux lourds (mercure, plomb, cadmium, nickel), des nitrates, des pesticides.
La directive cadre eau (DCE) de l’Union Européenne du 23 octobre 2000, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et fixe comme objectifs d’atteindre un bon état des eaux en 2015 et de réduire progressivement les rejets des substances dangereuses (métalliques et organiques notamment) jusqu’à les supprimer d’ici à 2021. Les entreprises sont donc concernées au premier chef par les réglementations dans ce domaine.
La part de l’assainissement dans le prix de l’eau est croissante du fait des nouvelles normes réglementaires et du coût des analyses et des traitements des eaux usées. De ce fait, le prix de l’eau augmente plus vite que l’inflation en France, au rythme de 3,3% par an en moyenne depuis 2004, avec de grandes disparités entre les régions. Cette tendance risque de se prolonger dans l’avenir.
C’est pourquoi les équipes syndicales, via les CHSCT et les instances de représentation du personnel, se doivent d’être vigilantes pour que les entreprises réduisent le plus possible leurs rejets. Si elles ne le font pas, la réglementation les rattrapera inéluctablement.
Les entreprises et les industries ont également un grand rôle à jouer en matière d’économies d’eau. Elles peuvent mettre en place des techniques pour optimiser leur gestion de l’eau. En tant que syndicalistes, nous avons un rôle à jouer dans ce domaine.
L’eau est un élément de base essentiel pour l’humanité. Sa surexploitation et sa pollution vont renforcer les inégalités d’accès. Déjà aujourd’hui, on parle de l’eau, comme l’or bleu en référence à l’or noir, période faste du pétrole. N’oublions pas que l’eau est un bien de nécessité et que l’or noir génère encore des conflits.