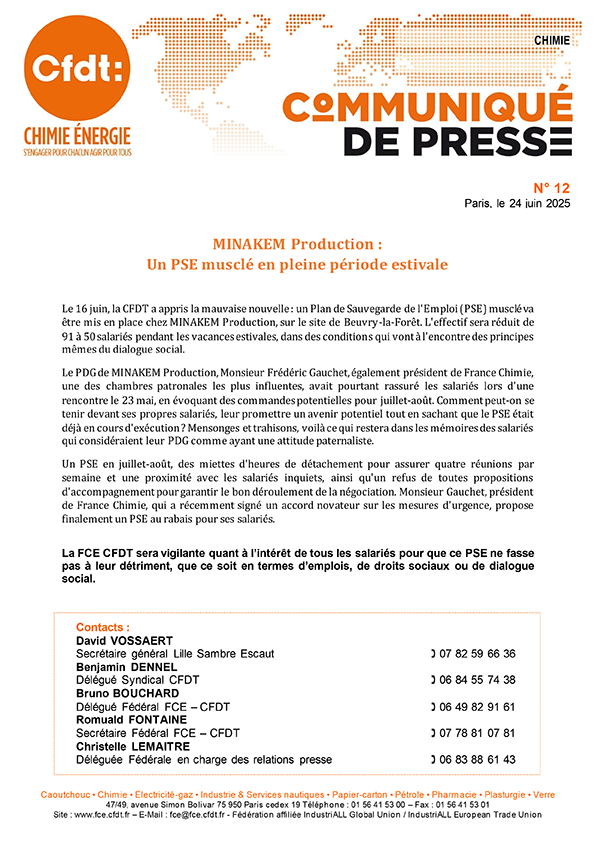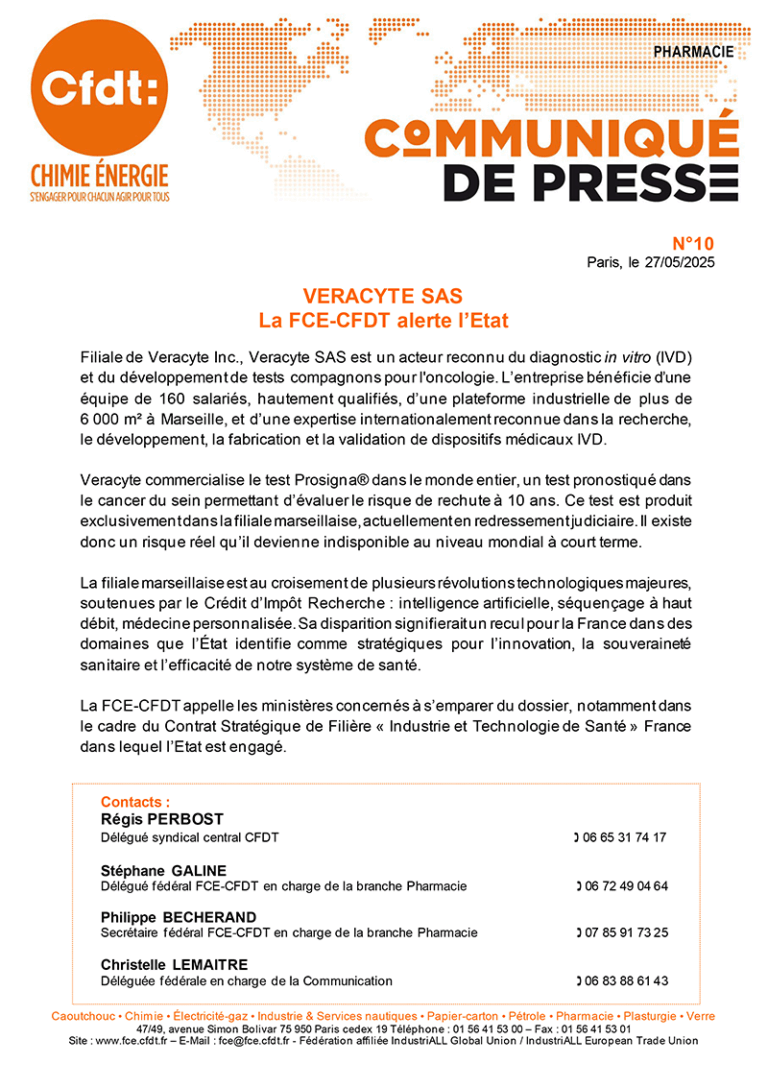La 21e Conférence des parties de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s’est achevée sur un accord pour permettre de limiter le réchauffement climatique à + 2°. 195 pays se sont engagés à limiter l’émission de gaz à effet de serre.
En 2012, seule la France a candidaté pour organiser cette conférence après l’échec de Copenhague en 2009. Le travail réalisé bien en amont, par la diplomatie française notamment, permet aujourd’hui d’aboutir à un accord universel, le premier sur le climat, qui donne par ailleurs une dimension internationale à la France.
C’est une réussite diplomatique, mais pas seulement. Dans un contexte politique et économique mondiale instable, tous les pays se sont unis pour défendre une cause commune. Ils démontrent ainsi leur capacité à se mobiliser sur des enjeux planétaires. Ceux qui ont refusé de participer, comme la Corée du nord, s’isolent à nouveau un peu plus.
C’est aussi un succès pour la démocratie, la conférence a réuni les plus grands chefs d’Etats, mais aussi tous les acteurs de la société civile. L’implication de grandes entreprises, de collectivités et d’associations est un élément clé et une démonstration de l’utilité du débat public ainsi que de la capacité à aboutir à des compromis lorsque cela est indispensable.
La mobilisation ne s’arrête pas au 12 décembre 2015. Pour être en vigueur en 2020, l’accord doit maintenant être ratifié par au moins 55 pays représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Evidemment plus le nombre de pays à le valider sera important, plus grande sera sa portée. Par ailleurs, il est prévu une révision des engagements avant 2025 et ensuite tous les 5 ans, il faudra à la fois revoir à la hausse les contributions de chaque pays mais aussi l’assiette de financement pour aider les pays les plus pauvres à se développer durablement.
Bien sur la prudence est de mise car sa mise en œuvre repose sur le respect des engagements de chaque pays. C’est le risque à prendre pour aboutir à l’assentiment du plus grand nombre. L’accord repose donc sur la confiance. Charge à tous les acteurs, dont la société civile, d’assumer un rôle de mesure, de contrôle et d’alerte.
La FCE-CFDT s’est fortement investie dans ce processus notamment dans le cadre de la transition énergétique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle travaille sur l’anticipation des conséquences sur nos industries et l’emploi.
La FCE-CFDT sera attentive au respect de l’engagement d’une transition juste et du respect des droits fondamentaux inscrits dans le préambule de l’accord.