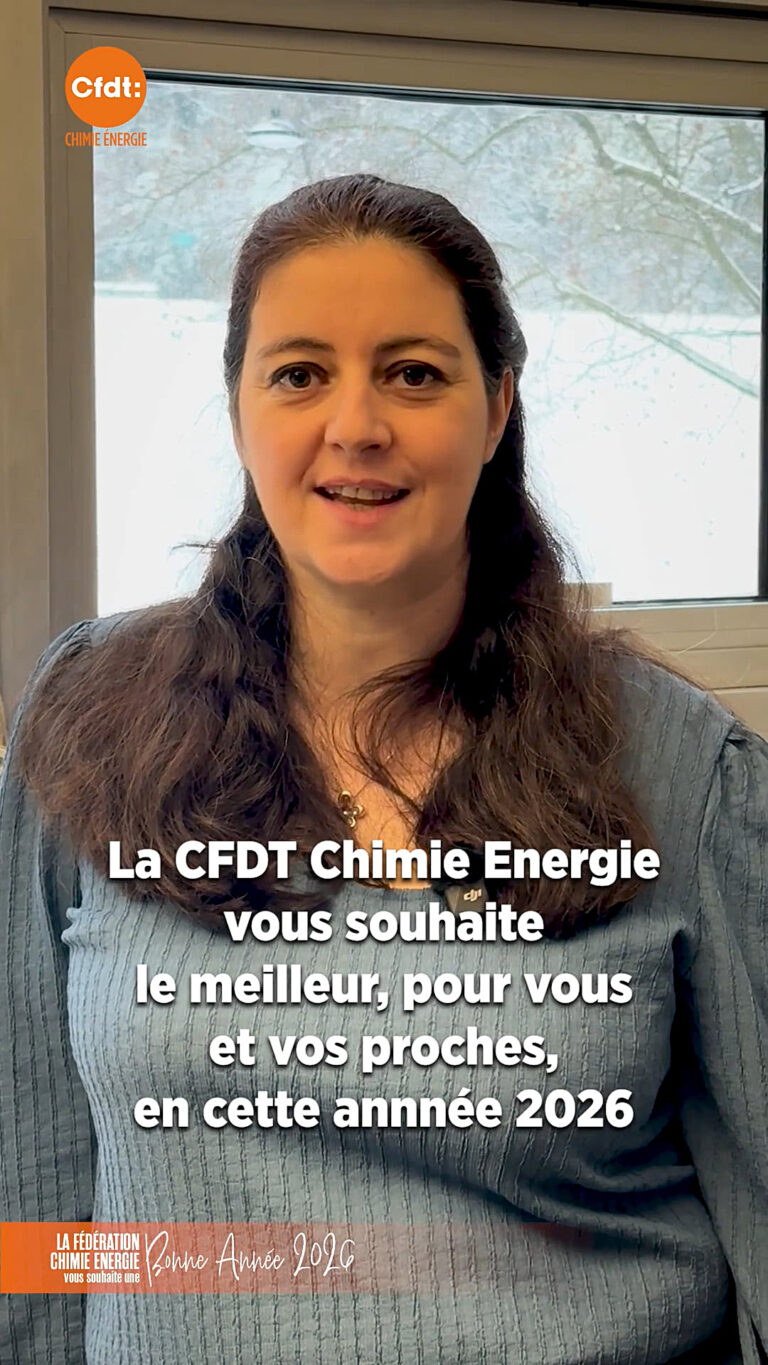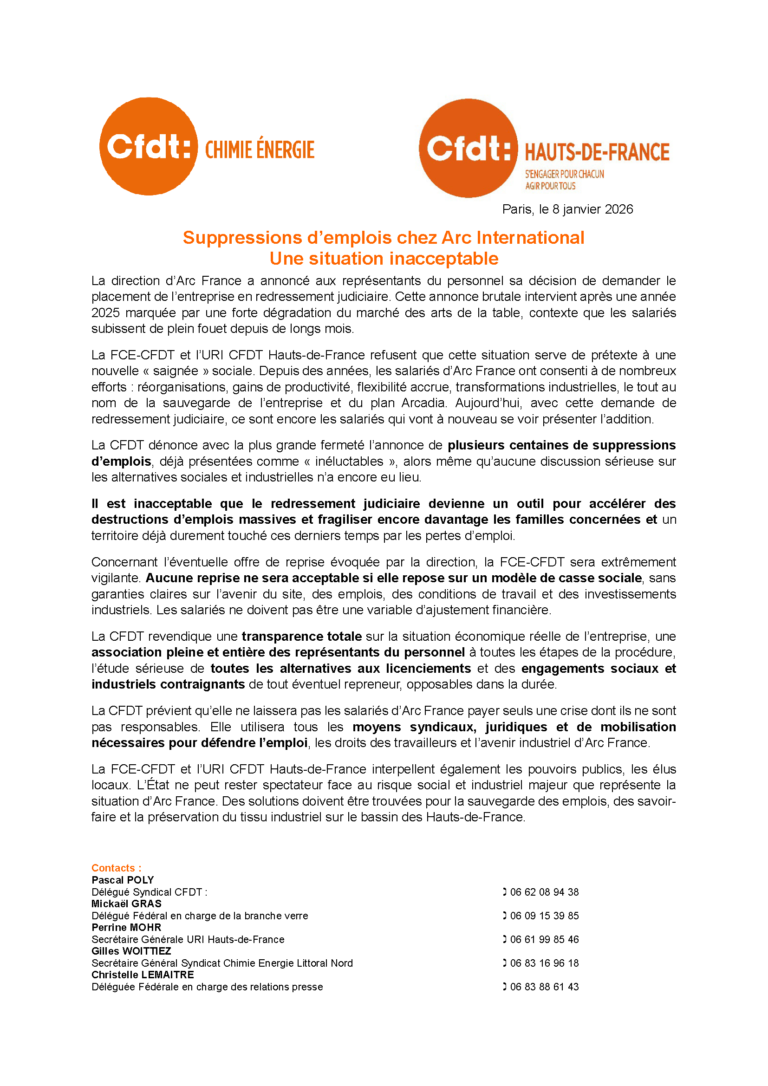Paris 4 décembre 2002
Le moment que nous vivons est de ceux dont il faut apprécier l’importance.
Cette conférence est une étape majeure dans un cheminement déjà long. Elle est l’expression d’une volonté partagée d’autant plus réelle qu’elle a été confrontée parfois durement à l’épreuve des faits.
Cette conférence ne prendra pourtant sa dimension que si elle s’avère à terme avoir bien été le creuset d’un dialogue social à la mesure de nos professions et de l’Europe.
Le dialogue entre partenaires sociaux, sa nature et son intensité qualifient les relations sociales dans nos différents pays et nous savons tous, ici, l’atout que constitue l’existence d’un dialogue sincère et constructif.
Atout pour les salariés qui ont là le meilleur moyen pour définir, consolider et actualiser des garanties véritables et durables.
Atout pour les entreprises dont les performances et les capacités d’adaptation supposent de plus en plus une implication des salariés et une capacité d’entente avec leur environnement qui ne peut s’envisager sans un dialogue actif et permanent.
Atout pour la démocratie elle même, car le dialogue social est un des éléments constitutifs de l’identité de nos sociétés. Son existence, sa portée, sa vitalité forment l’un des plus riches terreaux démocratiques.
La qualité du dialogue et de la coopération qu’il nourrit entre les acteurs du travail, et entre eux et la société revêt la même importance au plan européen.
Comme d’autres et je sais pouvoir le dire, comme vous tous ici, je pense que l’Europe sera citoyenne et donc sociale ou ne sera pas.
Réunir à ce niveau les conditions du dialogue social est ainsi le moyen de contribuer à une construction sans équivalent dans le monde et qui trace le cadre de notre avenir commun.
C’est pourquoi, cette conférence est d’une réelle importance et il faut d’autant plus se féliciter de sa tenue que le chemin pour parvenir à elle aura été long et difficile.
Difficultés avec le patronat de nos industries qui, en cœur avec celui des autres branches, a longtemps affirmé que le dialogue social européen n’était pas une nécessité et s’est employé à y faire obstacle.
Difficultés aussi au sein de l’EMCEF où, encore aujourd’hui, les affiliés, naturellement marqués par leurs cultures nationales, ne portent pas tous l’engagement européen avec la même force et n’ont pas la même conception de l’Europe, de l’Europe sociale et parfois même de l’Europe syndicale.
Progresser dans de telles conditions ne pouvait être aisé, ne l’a pas été et ne le sera probablement pas à l’avenir. Mais notre présence ici et l’expérience engrangée montre que c’est possible.
Celle de la Trilatérale est ainsi particulièrement précieuse.
C’est en 1993 et face à la difficulté d’obtenir une avancée générale des acteurs de nos professions dans la voie du dialogue européen que la FCE-CFDT a recherché les partenaires qui, comme elle, étaient prêts à explorer pas à pas cette voie.
Nous les avons trouvés et cela a donné naissance à la Trilatérale qui a réuni dès lors les chambres patronales et les fédérations syndicales italiennes et espagnoles et, pour la France, l’UIC et la CFDT.
Il faut souligner le caractère peu ordinaire de la Trilatérale.
Unique en Europe cette démarche totalement volontaire motivée par la volonté de rechercher entre partenaires sociaux les voies et moyens d’un dialogue sectoriel européen est toujours effective dix ans plus tard.
Elle a notamment permis la réalisation d’une étude sur les politiques remarquables de formation professionnelle dans les trois pays et a obtenu pour cela la reconnaissance de la commission européenne sous la forme du label du programme Leonardo.
Ce travail mené à bien n’est pas rien si l’on se réfère aux incompréhensions et difficultés que j’évoquais un peu plus tôt.
Les échanges au sein même de la Trilatérale n’auront pas toujours été lisses et apaisés !
Mais le fait même que nous ayons pu, tout au long de ses dix années, nous dire très directement et parfois vivement notre façon de penser sans que cela ne nous sépare prouve que nos ambitions communes sont plus fondamentales que nos désaccords ponctuels.
Dans cette aventure les hommes et les femmes auront compté et je les salue tous avec une pensée pour cinq d’entre eux .
Deux nous ont malheureusement quitté, Arnaldo Marianni alors secrétaire général de la FLERICA-CISL et Eduardo Guarinno secrétaire général de la FILCEA-CGIL ; une autre est heureusement bien là il s’agit de Francisca Sanchez secrétaire générale de la FIA-UGT. Et puis je veux dire mon estime et mon amitié à deux ennemis de classe, je veux parler de Nicolas Messina de la chambre patronale de la chimie italienne et de François Gaschka de l’UIC.
Sans eux tout aurait été à l’origine plus difficile sinon impossible.
Aujourd’hui, cette conférence constitue un prolongement déterminant de la dynamique lancée par la Trilatérale.
Avancées déjà significatives, les conférences déjà tenues à Milan puis à Berlin étaient respectivement organisées par les partenaires sociaux italiens et allemands.
Celle de Paris l’est par l’EMCEF et l’ECEG et la différence est de taille car le dialogue sectoriel européen suppose l’existence d’interlocuteurs de cette dimension et leur reconnaissance mutuelle.
Or jusqu’au début de cette année l’EMCEF n’avait pas d’homologue patronal et cela n’était pas le moindre des problèmes.
D’autant que ce n’était pas là le résultat d’un oubli de la part du patronat européen de la chimie, mais le produit d’une conception de la nature de la construction européenne et des exigences qu’elle pose à tous.
La création de l’ECEG est une décision politique qui non seulement rend possible le dialogue mais indique un glissement fondamental de position et il ne fait guère de doute quant au fait que demain l’ECEG rassemblera la totalité des affiliés du CEFIC.
La portée de l’évolution que marque la création de l’ECEG va maintenant dépendre de ce nous voudrons et saurons faire ensemble.
Et le chantier est vaste !
Les thèmes de réflexion et de réalisation qui nous attendent sont nombreux et dans bien des cas leur prise en charge ne se suffira pas d’échanges périphériques. Les thèmes retenus pour cette conférence font partie de ceux là.
Point n’est besoin de trop insister pour que les questions de la performance et de la sécurité apparaissent s’imposer.
L’image générale de nos industries dans l’opinion, la réalité de leurs dangers et l’actualité récente y suffisent.
La catastrophe de l’usine AZF à Toulouse par la gravité de son bilan humain et l’ampleur des destructions occasionnées à la ville a marqué et marquera durablement les esprits. Il y aura incontestablement un avant et un après Toulouse pour les industries à risques dans ce pays mais aussi au-delà.
Vouloir ignorer l’appel pressant adressé à nos industries pour qu’elles limitent et contiennent leurs risques, refuser de voir que performance et sécurité sont indissolublement liées serait tout simplement irresponsable.
Irresponsable du fait des risques qui seraient alors pris pour les entreprises, leurs salariés, les populations et l’environnement mais aussi parce que ce serait la meilleure façon de condamner à terme rapproché nos industries dans les pays développés.
Les industries à risques et leurs emplois n’ont d’avenir acceptable que si elles s’assurent de la connaissance de la réalité de leurs risques, si elles les assument dans la transparence et si elles en organisent la maîtrise dans un cadre de dialogue, de concertation et de négociation.
Sur ces domaines il y a plus que matière a développer le dialogue et les coopérations, pour améliorer la sécurité de nos entreprises et leur insertion harmonieuse sur les territoires mais aussi pour accroître la crédibilité de nos industries en la matière.
Le dialogue est l’un des ingrédients du management socialement responsable et de la confiance qui rendent possible les expressions convergentes ou mieux encore communes sur les enjeux communs.
Ainsi, parce que porteurs de positions équilibrées et partagées nous aurions pu être mieux entendus sur des dossiers tel celui du Livre blanc européen sur les substances chimiques. Non pas pour en rejeter l’esprit ni pour en retarder les effets, mais pour en rendre les dispositions et les modalités d’application compatibles tout à la fois avec les exigences d’une sécurité industrielle accrue et avec les capacités de réponse ordonnée des entreprises de la profession.
En la matière rien n’est perdu et la sincérité du dialogue que nous engageons aujourd’hui peut, renforcer là où elle existe et fonder ailleurs, la coordination de nos interventions à venir sur cette question.
Mais il est important que les expressions ou les démarches communes ne soient pas assimilables à un corporatisme étroit qui entacherait la crédibilité du syndicalisme aux yeux de l’opinion, les organisations écologistes et autres groupes de pressions apparaissant alors seules à être autonomes des intérêts de la profession et des entreprises.
La voie est étroite mais le fait que les partenaires sociaux de la chimie française, à l’exception de la CGT, soient parvenus à conclure un accord sur ce thème alors que le climat était particulièrement tendu après la catastrophe de Toulouse et que le prima du dialogue n’est pas ce qui caractérise le mieux les relations sociales dans mon pays montre qu’elle est praticable .
Engager et étendre le dialogue européen est nécessaire à tous les niveaux.
La création des comités européens d’entreprise a créé un mouvement très positif. La rencontre de salariés d’autres pays permet de donner des visages à l’Europe et améliore la compréhension des réalités de l’entreprise au-delà du cadre national. Les échanges permettent aussi de confronter des cultures sociales différentes et le constat que l’on peut d’ores et déjà dresser est que l’exemple des pratiques de dialogue les plus ouvertes ont tendance à emporter l’adhésion. C’est sans doute ce qui contribue à ce que le dialogue européen d’entreprise dès lors que son exercice s’affirme ait tendance à s’étendre au-delà des limites des textes qui le régissent.
Cette propension des acteurs de l’entreprise à décider sur la base de leur expérience d’aller plus loin ensemble souvent sans engagement formel dans un premier temps est le meilleur encouragement à porter le dialogue social européen au niveau sectoriel.
L’Europe du dialogue social ne peut se résumer à ce qui se passe dans les entreprises.
D’abord parce que la très grande majorité des salariés n’accèdent pas à ce dialogue car leur entreprise ne relève pas du champ d’application de la directive européenne.
Ensuite parce que l’Europe sociale et l’Europe tout court d’ailleurs se construisent par une série d’arbitrages qu’il est illusoire et contraire à l’objectif européen de vouloir rendre entreprise par entreprise. Le simple souci des règles de bonne concurrence devrait suffire à l’établir. L’Europe a besoin de professions organisées au plan social aussi.
L’organisation du dialogue sectoriel européen dans la chimie est donc le grand chantier qui se trouve devant nous.
Ce chantier sera complexe à mener à bien. Parce qu’existe encore, tant du côté patronal que syndical, des réticences qui se nourrissent d’incompréhensions et de craintes. Aussi parce que le développement d’un tel dialogue supposera à terme la définition de cadres conventionnels européens qui appelleront une articulation aux conventions collectives nationales qui devront elles mêmes être actualisées. Autant de changements qui ne seront pas sans effet sur les pratiques sociales dans les différents pays. On peut s’attendre à ce que ces dernières s’harmonisent progressivement comme elles ont commencer à le faire. On peut aussi penser que l’identité même des acteurs du dialogue social européen continuera à converger et l’on peut espérer que l’évolution actuelle vers plus de sérieux, de sens constructif et de responsabilité mutuelle se trouvera largement confirmée.
Bref ! Traiter de dialogue social et de coopération c’est d’abord parler de nous, de ce que nous sommes, de la connaissance et de la reconnaissance que nous avons les uns des autres, c’est dire ce que nous voulons pour nous et pour les autres.
Voilà pourquoi ce chantier ne sera pas qu’un long fleuve tranquille. Voilà pourquoi il est compréhensible que l’ouverture de ce chantier ne soit pas à notre ordre du jour d’aujourd’hui.
Il nous faut, à tous, encore un peu de temps pour imaginer notre espace de dialogue sectoriel et décider de sa construction. Nous savons simplement que le seul choix qui se présente à nous est de le faire et de réussir.
Et nous n’avons pas de raison de douter de nous.
Ce que nous avons déjà réalisé ensemble, ce qui au final et bon gré mal gré nous pousse les uns vers les autres, la tenue de cette conférence, l’objectif d’aboutir ce soir à une déclaration commune, tout cela démontre une fois de plus que là ou il y a une volonté il y a un chemin.
Merci.