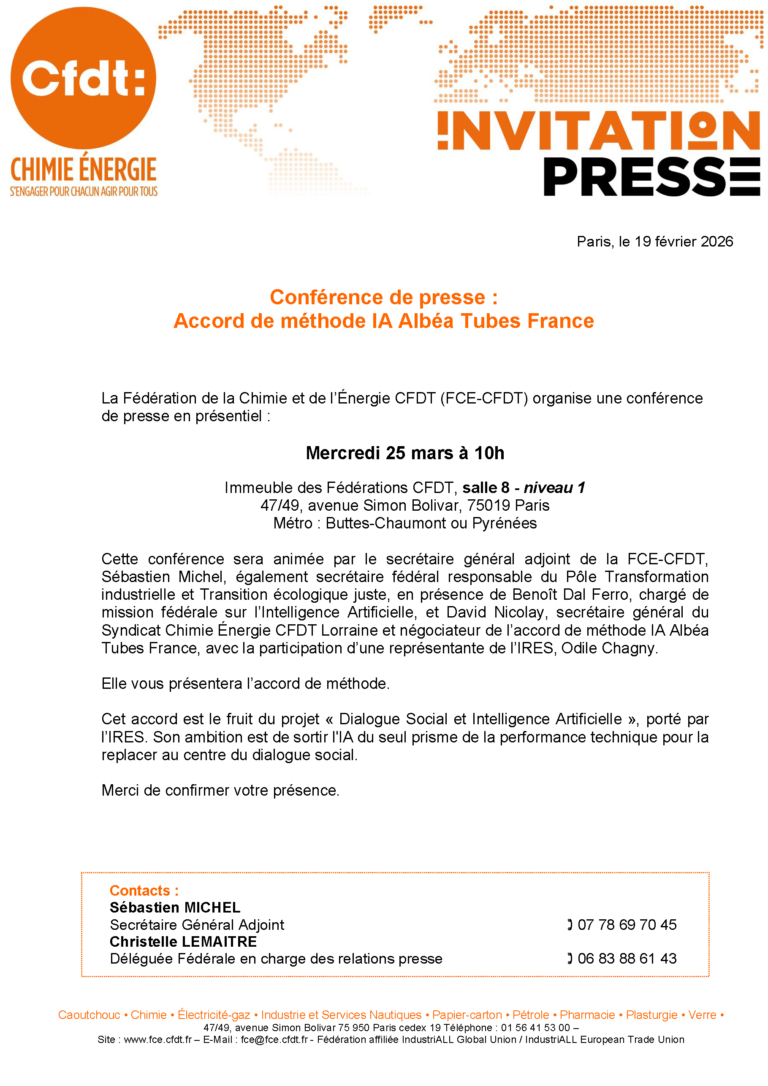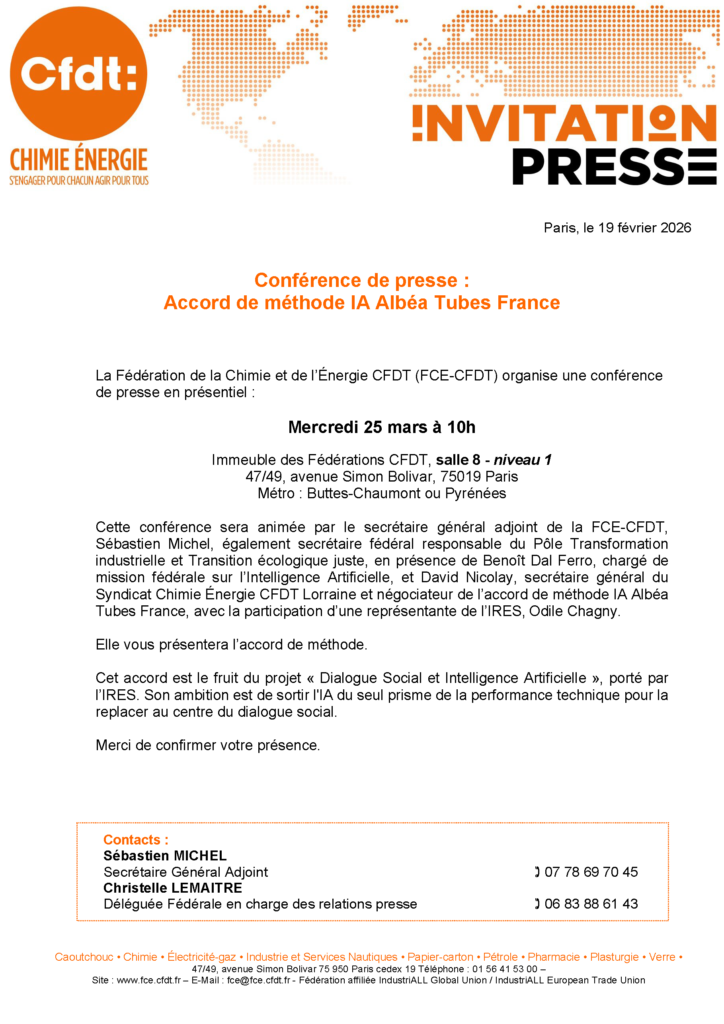ANALYSE SECTORIELLE DES INDUSTRIES DE LA PÂTE ET DU PAPIER
1 – Généralités
A partir du bois, matière première renouvelable et du recyclage de vieux papiers, l’industrie papetière fabrique un grand nombre de produits d’usage quotidien.
L’essor de l’emballage et notamment des produits d’hygiène soutiennent l’activité de cette filière.
Dans le domaine du papier ménager, à l’échelle mondiale, c’est une consommation de 3,2 kg par habitant qui est enregistrée pour 1999 soit 315,7 tonnes. Les prévisions de consommation pour 2010 sont de l’ordre de 450 millions de tonnes. La consommation de produit à base de pâte ne cesse donc d’augmenter.
Le secteur du papier carton est marqué par un déplacement des zones de production mondiale de pâte et de papier.
Aujourd’hui, le continent Nord américain est le premier producteur de papier et de carton grâce notamment au renforcement à la production canadienne. L’Europe de l’Ouest est une zone qui concentre le cœur des flux internationaux en raison du commerce européen. Elle est en seconde position des producteurs. L’Asie est une région émergente avec un taux de croissance de 6,9% de production. Si cette tendance perdure, le continent asiatique passera leader mondial dans les années qui viennent.
L’Amérique latine, avec une progression de 4,3% en moyenne sur le papier et le carton devrait trouver rapidement sa place dans les leaders.
L’Europe orientale progresse lentement dans ce domaine avec la Russie qui émerge sur cette activité notamment grâce aux investissements du géant américain international paper.
Le continent africain, quant à lui, reste à un niveau très faible avec une production en recul en 1999.
2 – Une industrie cyclique :
Le secteur du papier carton est marqué par l’existence de cycle de production. Il est confronté régulièrement aux effets des variations de la demande.
Il subit également les fluctuations de ses matières premières, parfois importantes qui se répercutent partiellement en aval de la chaîne.
Ainsi, en longue période l’offre finit toujours par s’adapter à la demande. Les ruptures dommageables tantôt pour la clientèle, tantôt pour les producteurs, s’observent en courte période.
L’industrie papetière engendre donc des processus d’amplification du cycle économique général, auquel elle est fondamentalement assujettie, du fait des relations qui s’établissent entre plusieurs variables :
> Le volume de la demande, dont l’évolution peut être très rapide.
> Des capacités de production, plus rigides, qui s’adaptent avec un décalage.
> Des mouvements de prix qui entrainent des phénomènes de stockage et de déstockage chez les utilisateurs.
> L’évolution des échanges internationaux.
Lorsque l’économie générale est en phase de croissance, le développement de l’activité papetière entraîne une augmentation de la consommation, les utilisateurs cherchent alors à ajuster leurs stocks de façon mécanique. Face à cette relance de la demande, les industriels investissent dans de nouvelles capacités de production. En attendant que celles-ci soient opérationnelles (délai de construction d’environ deux ans), le déséquilibre entre l’offre et la demande provoque une hausse des prix, renforçant le mouvement initial de stockage.
Les distorsions se multiplient et s’intensifient jusqu’au point de rupture où le retournement s’opère. Le ralentissement de la demande, le phénomène de déstockage ajoutés à la mise en place des nouvelles unités de fabrication se traduisent par un excédent d’offre, et donc une entrée en phase baissière du cycle.
Ainsi, les cours de la pâte NBSK [1] ont chuté de 840 dollars la tonne au premier semestre 1990, haut du cycle mondial, à 400 dollars à l’automne 1993, creux de la récession européenne, pour remonter brutalement durant la phase de reprise, jusqu’à 925 dollars la tonne au second semestre 1995.
Entre 1996 et 1998, les cours ont fluctué dans une bande étroite (de 560 à 590 dollars la tonne), tandis que les stocks NORSCAN [2] variaient plus modérément que précédemment. Cependant avec la baisse de la demande asiatique, les stocks ont augmenté en 1998 tandis que les cours revenaient au second semestre, 580 à 480 dollars la tonne.
Les tendances observées sur le marché des pâtes devraient se prolonger durant l’année 2000. Il faut cependant s’attendre à des reprises d’investissements au fur et à mesure que le marché des pâtes redevient attrayant pour les producteurs de pâtes. La conséquence immédiate sera une stabilisation voire une rechute des cours.
1 – Une course vers l’économie d’échelle :
Dans un souci de produire plus et au plus près des consommateurs, les groupes élaborent leur stratégie en mesurant de façon permanente la nécessité de maintenir les unités de production existantes dans des marchés établis, souvent matures et en construisant de nouvelles capacités de production dans des zones de consommation émergente.
La faiblesse des coûts sociaux, environnementaux et de main d’œuvre dans des pays en voie de développement est un critère déterminant pour les implantations nouvelles.
La construction de machines à papier gigantesques par la surcapacité engendrée, a provoqué la chute des prix, une bataille sans merci vers la réduction des coûts et la disponibilité des outils de production.
Toutes ces tendances ont eu des conséquences négatives sur l’emploi et les conditions de travail des salariés du secteur.
Un contexte renforcé par l’accélération des mouvements de concentrations des groupes qui a eu pour effet, entre autre, de réduire de façon conséquente le nombre de producteurs. A l’aube du 21ème siècle, ce sont les premières fusions mondiales qui donnent le ton et dessinent ce que sera l’industrie papier-carton de demain.
Le résultat de ces tendances se mesure par le fait que les secteurs du papier journal et du papier magazine sont devenus les industries européennes du papier les plus concentrées depuis les 5 dernières années.
Les entreprises scandinaves sont un bon exemple, puisqu’elles dominent le marché de la pâte et du papier et détiennent un avantage concurrentiel lié à leur taille.
Toutes ces fluctuations de marché ont été accompagnées par des restructurations importantes dont le but est de :
– Rapprocher les unités de productions des principaux clients
– Renforcer la présence des entreprises sur les marchés à fort potentiel de développement
– Se rapprocher des sources d’approvisionnements ou des facteurs de production
– Rechercher des économies d’échelle sur les segments de marché à produits standardisés
– Faire face à la concentration des acheteurs sur certains segments en faisant de la croissance externe.
2 – Une industrie diversifiée :
Les papiers de masse et les papiers spécialisés
Les papiers-cartons destinés à des usages d’importance quantitative modeste sont le plus souvent de conception technique très élaborée, et leur valeur ajoutée est plutôt forte. A l’inverse, les papiers cartons destinés à des marchés de grande diffusion satisfaisant des usages de base, sont le plus souvent standard, de conception et de fabrication plus simple. Il est donc devenu traditionnel d’établir dans le domaine des papiers-cartons, une distinction entre : papiers de masse ou de grande consommation, et papiers spéciaux ou spécialités.
La distinction entre ces deux catégories de papiers-cartons est loin d’être anodine. Elle recouvre en fait des aspects déterminants, notamment d’ordre économique et stratégique :
> Les exigences qualitatives d’emploi des matières premières sont plus fortes pour les spécialités.
> Les efforts de recherche et développement, de marketing sont plus intenses et plus évolutifs pour les spécialités que pour les papiers de masses.
> Les papiers de spécialités connaissent souvent des courbes de vie assez courtes, mais peuvent bénéficier « d’effets d’ombrelle », c’est-à-dire bénéficier de l’absence de concurrents durant une période plus ou moins longue ;
> Les changements de fabrication sur machine sont souvent fréquents dans le cas des spécialités, alors que les papiers de masse font l’objet de longues fabrications, voire d’une spécialisation poussée ;
> Lorsque, du fait de la concurrence, une machine à papier perd de sa compétitivité industrielle dans une des deux sortes, la démarche immédiate adoptée consiste à rechercher de nouvelles productions de papiers à valeur ajoutée accrue.
> Dans les papiers de masse, les investissements sont devenus considérables et, de ce fait, non accessibles à tous. Dans les spécialités, ils demeurent beaucoup plus modestes.
La croissance des marchés et leur internationalisation (passage du marché français au marché européen ce qui changent l’unité de mesure), les incessants progrès techniques, mais aussi les changements dans les habitudes et les conceptions des utilisateurs à la recherche de meilleurs prix pour une qualité suffisante, sont autant de facteurs qui ont généré, sur certains marchés, la transformation de papiers de spécialité en produits de masse.
Ainsi, le fabricant d’un papier de spécialité peut, à un moment donné, se trouver confronté à une situation critique :
> Perte de « l’effet d’ombrelle » par banalisation du produit ;
> Impossibilité d’assumer la concurrence de nouvelles machines plus modernes, de plus grandes dimensions et de plus fortes capacités, qui entrent dans la production de papiers de spécialité, en entraînant une baisse des prix.
Dans de tels cas, le fabricant se trouve souvent contraint de sortir de sa production de papiers de spécialités et à en chercher une autre à bonne valeur ajoutée. Lorsque le matériel est très spécialisé et que la mutation implique de nouveaux investissements importants, les contraintes financières peuvent devenir alors insurmontables. Pour évoluer et assurer son avenir, l’entreprise papetière, hautement capitalistique, apparaît donc bien dans le domaine industriel comme l’une de celles qui ont le plus besoin d’une rentabilité satisfaisante.
L’investissement dans la recherche permet de trouver des produits à valeur ajoutée accrue, en montant dans la gamme ou en créant de nouveaux créneaux et spécificités et ainsi de rester hors de portée des grands groupes plus puissants financièrement et industriellement. Cette voie représente la seule stratégie des entreprises moyennes qui veulent subsister.
Les mouvements et déplacements qui se manifestent en permanence entre la plupart des différents produits agitent donc les structures d’offre du secteur papetier, contraignant sans cesse les entreprises à réagir, à s’adapter, à trouver à temps de nouvelles voies, faute de quoi telle machine, ou telle usine, est conduite dans une impasse et/ou contrainte à disparaître.
3 – La création de la valeur pour l’actionnaire : Le nouveau mot d’ordre de l’industrie papetière.
Les groupes papetiers ont longtemps axé leur stratégie de développement sur la croissance de leurs capacités de production, leur positionnement sur le marché étant plutôt déterminé par leur volume de production que par leurs résultats. Ainsi, les forces commerciales du secteur utilisaient traditionnellement le tonnage vendu comme indicateur de performance, plutôt que la rentabilité par tonne, pour arriver à saturer les capacités de production et pour couvrir les coûts fixes. La maxime était toujours : « chaque tonne compte, quelles que soient ses conditions de vente ».
Les fluctuations du cours de la pâte ont souvent été utilisées comme l’argument principal pour justifier les faibles résultats du secteur. En réalité, la croissance lente du secteur, la rapide transformation des portefeuilles de produits en bien de commodités et l’excès de capacités étaient les principales causes de l’incapacité du secteur à faire sien le paradigme de la « création de valeur pour l’actionnaire ».
Mais, comme pour la plupart des autres secteurs industriels, le mot d’ordre du management de l’industrie papetière est bien devenu la création de valeur pour l’actionnaire. Les groupes papetiers ont freiné la course à la croissance de leurs capacités de production et donc de leurs investissements qui entraînaient systématiquement une tendance à la baisse du cycle papetier.
Le management de l’industrie papetière s’est donc de plus en plus focalisé sur l’objectif d’avoir des indicateurs de rentabilité des capitaux investis par les actionnaires, sur les besoins des clients et non plus seulement des tonnages vendus et des parts de marché. Pour améliorer leurs résultats, les entreprises du secteur essayent maintenant de différencier leurs produits grâce à des nouvelles technologies tout en continuant à élargir leur offre. Elles recherchent aussi les traditionnelles opportunités de baisses de coûts, particulièrement au niveau des coûts fixes, en rationalisant leurs capacités de production, c’est-à-dire en arrêtant des machines à papier voire en fermant des sites entiers.
Les entreprises de l’industrie papetière privilégient donc aujourd’hui dans leurs investissements les segments avals de leurs activités, là où le capital immatériel (marketing, recherche, technico-commercial), est moins coûteux, là aussi où les bénéfices sont les moins cycliques.
L’exemple de la stratégie du groupe américain CHESAPEAKE CORPORATION est très probant pour illustrer ces évolutions. En 1996, le groupe CHESAPEAKE a engagé un repositionnement stratégique de ses activités. Le maître mot de sa stratégie était de créer de la valeur pour l’actionnaire.
La déclinaison en termes opérationnels a été de se désengager des marchés de commodités à caractère cyclique sur lesquels le groupe CHESAPEAKE est historiquement présent (production de papier kraft, papier de soie et activités forestières) pour aller sur des marchés de spécialités comme l’emballage, c’est-à-dire développer des activités moins capitalistes, moins consommatrices de capital, et présentant des potentiels de croissance et de rendement plus important.
Grâce à ces opérations, la direction du groupe CHESAPEAKE pouvait augmenter fortement son indicateur de rentabilité des capitaux sans pour autant présenter des résultats d’exploitation plus élevés. En trois ans, le groupe CHESAPEAKE a donc, en partie, réussi son repositionnement stratégique. La production de papier qui représentait plus des 2/3 du chiffre d’affaires en 1996 ne représentera quasiment plus rien en 2000 tandis que l’emballage pèsera plus des 2/3 du CA.
Par ailleurs, depuis quelques années, un mouvement de méga-fusions est en cours pour tenter de créer des économies d’échelles, pour augmenter le pouvoir de l’industrie papetière face à ces clients et pour rationaliser les capacités. Le mois de février 2000 a connu un mouvement de concentration sans précédent du secteur qui a quelque peu bouleversé la hiérarchie mondiale, dominée depuis de longues années par INTERNATIONAL PAPER.
Après le mariage des deux canadiens ABITIDI ET DONOHUE dans le papier journal, puis l’absorption de l’Américain CHAMPION PAPERS par UPM-KYMMENE dans les papiers fins couchés et non couchés, le Scandinave STORA-ENSO s’est emparé de l’américain CONSOLIDATED PAPERS et est devenu le nouveau numéro un mondial du secteur avec une capacité de production cumulée de 15 millions de tonnes et un chiffre d’affaires de 12, 4 milliards d’euros.
Au cours des cinq prochaines années, les principaux acteurs du secteur vont accroître leurs efforts pour disposer d’une présence mondiale. L’implantation en Asie, le marché bénéficiant des plus forts potentiels de croissance, sera l’un des facteurs de succès pour occuper une position de leadership, particulièrement pour les groupes européens.
De cette première analyse se dégage quelques éléments de synthèse :
– Les entreprises intégrées de l’amont à l’aval de la filière s’en sortent moins bien en terme de performances que les unités de plus petites tailles, positionnées, elles sur des niches du marché.
– Les activités plus légères valorisent mieux leurs productions.
– Les sociétés qui souffrent le plus de la conjoncture sont celles qui interviennent en amont de la filière.
– Le fonctionnement du marché induit des fluctuations des cours dus aux ajustements prix/qualité.
– Les aspects financiers se sont amplifiés, dus notamment aux spéculations sur les monnaies des nouveaux pays producteurs (Amérique latine et Asie).
De plus on peut identifier certaines contraintes qui pèsent sur l’industrie papetière :
– Le taux de croissance du marché est différent selon les segments de marché.
– La recherche de la taille critique nécessite des investissements colossaux.
– Le choix d’une stratégie d’intégration ou de diversification est rendue difficile par la fluctuation des marchés.
– La problématique de la création de valeur pour l’actionnaire conduit à la rationalisation des outils industriels.
1 – L’environnement :
Le secteur de la pâte et du papier est, par essence, un secteur à forte intensité capitalistique et de ressources. Il se distingue par son impact écologique, que ce soit par l’utilisation des ressources forestières dont il tire ses matières premières ou par ses besoins élevés en énergie et en eau.
1) La matière première
La pérennité des ressources forestières est depuis quelques années une préoccupation de l’industrie papetière. Les pressions des politiques et des citoyens dans ce domaine ont pesé sur cette prise de conscience. Le Forest Stewardship concil, organisation reconnue sur la scène internationale, contrôle les forêts appartenant aux groupes industriels et décerne des brevets d’exploitation à ceux qui répondent à des critères de développement durable.
Par ailleurs, la norme ISO 14001 exerce aussi des pressions qualitatives dans le sens de la pérennité écologique. Des plantations spécifiques pour l’industrie sont renouvelées régulièrement afin de ne pas détruire les forêts existantes.
2) La santé publique :
L’industrie de la pâte et du papier étant grande consommatrice de ressources naturelles (bois, eau, énergie), elle a une grande part de responsabilité dans les problèmes de pollution de l’eau, l’air et les sols.
Depuis quelques années, elle est sous les feux de l’actualité.
Une solution pour atténuer les problèmes d’épuisement des ressources et de consommation d’énergie consiste à recycler le produit utilisé.
De gros efforts sont à faire dans ce domaine par les industriels mais aussi par les citoyens qui doivent intégrer culturellement le tri des déchets.
L’utilisation du chlore pour le blanchiment du papier est aussi un procédé qui est facteur de pollution aquatique. Une nouvelle technique à base d’enzymes pourrait remplacer ce procédé.
Le rejet de gaz sulfureux dans l’atmosphère est aussi une problématique qui doit être examinée afin de remédier à cette situation.
La consommation d’énergie peut représenter jusqu’à 30% des coûts de fabrication de l’industrie. Ceci a amené les industriels à investir dans des installations de cogénération et à une utilisation plus accrue de biocarburant.
Les impacts négatifs principaux de l’industrie papetière sur l’environnement :
> Perte de biodiversité des forêts.
> Erosion du sol et baisse de fertilité.
> Consommation d’eau importante.
> Rejets dans l’atmosphère.
> Consommation importante d’énergie.
> Pollution aquatique.
2 – L’emploi
Pour les salariés de cette industrie mondialisée, les synergies vécues à coup de fusion, acquisition, restructurations, sont synonymes de licenciements. C’est environ 3 500 000 personnes qui travaillent dans l’industrie mondiale du papier-carton.
Au cours de ces trois dernières années, on observe 3,5% de baisse constante du volume de main d’œuvre employé, malgré une demande de papier en hausse. Les grands problèmes rencontrés au niveau mondial sont ainsi consécutifs à ces compressions d’effectifs et cela entraîne des perturbations fortes de la négociation collective. Un climat d’antisyndicalisme se développe, le stress s’accroît et la précarité de l’emploi s’installe.
LES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES ET SYNDICALES FRANÇAISES1 – La conjoncture française en 1999 (voir annexe)
2 – Présentation de branche :
En France, l’industrie du papier carton compte environ 1500 entreprises dont plus de la moitié (55%) occupent moins de 20 salariés. Employant un peu moins de 100 000 salariés, elle réalise un chiffre d’affaires estimé globalement à 117 milliards de francs en 1997.
Capitalistique, elle fait coexister un tissu PME avec des groupes de taille mondiale et se caractérise par l’importance de la pénétration des capitaux étrangers.
La branche papetière se caractérise par une diversité industrielle, tant au niveau des outils de production que par les produits réalisés.
Diversités que l’on retrouve au travers des différentes conventions collectives du secteur qui regroupent par fédération d’employeur les entreprises :
– De la production de pâte et papier avec 25 000 salariés
– De la transformation avec 35 000 salariés
– Du cartonnage avec 28 000 salariés
– Des articles de papeterie avec 10 000 salariés
– De la distribution avec 2 300 salariés.
A chacun de ces secteurs corresponds des conventions collectives différentes, excepté pour la production et la transformation qui on des CCN identiques. Pour la production, la transformation et la distribution, les cadres disposent de l’application de conventions collectives spécifiques.
Ce sont huit CCN qui existent dans cette branche. Au niveau des effectifs, ces dix dernières années, la baisse est régulière et continue avec cependant une stabilisation dans la partie cartonnage. A noter que l’industrie du cartonnage se caractérise par un grand nombre d’entreprise dont 70% d’entre elles comptent moins de 50 salariés.
3 – Caractéristiques industrielles et emploi dans l’industrie du papier carton
L’industrie est marquée par quelques grandes tendances d’évolution de l’organisation du travail. Nous pouvons citer :
> Le développement de la polyvalence et la formation par rotation de postes. Ainsi, la formation est moins axée autour de la maîtrise complète d’un outil de travail (opération maintenance), que sur une maîtrise d’une compétence technique peut-être plus limitée mais permettant à l’ouvrier de tenir différents postes en aval de la machine à papier (c’est-à-dire en transformation) en fonction des impératifs du plan de charge.
> Cette évolution est rendue possible par une accélération de la division du travail, et le développement de la sous-traitance (en particulier de la maintenance) ainsi que l’automatisation poussée des machines et des procédures de monitoring.
> L’automatisation entraîne comme dans le reste de l’industrie une réduction du nombre de manœuvres et d’emploi à faible qualification.
> La sous-traitance entraîne une baisse du nombre d’emplois dans les services d’entretien.
> L’automatisation modifie radicalement le travail des opérateurs. Elle exige des compétences poussées de conceptualisation et d’analyse et offre peu de possibilités d’apprentissage par la pratique.
L’industrie étant dominée par de grands groupes anglo-saxons, l’organisation du travail et les pratiques managériales en sont très influencées.
Les qualifications recherchées sont moins des qualités techniques que des qualités d’intégration, de capacité à travailler en équipe et d’aptitude au management à tous les niveaux.
L’objectif de polyvalence correspond à une attente forte des directions d’entreprises comme moyen de mise en œuvre de la flexibilité et de recherche d’un rendement maximal des ateliers de transformation.
La formation vise moins à assurer l’élévation de la compétence technique qu’à maximiser la substituabilité des opérateurs à tous les niveaux de la chaîne de production.
Les critères de promotion ne sont techniques qu’au regard de la polyvalence, mais la véritable promotion des personnels ouvriers (être chef d’équipe ou agent de maîtrise) se fait en réalité sur des critères d’aptitude au management qui sont généralement formalisés avec l’aide de consultants (Hay Management par exemple).
Le traditionnel passage « agent de maîtrise » à l’ancienneté est de moins en moins assuré, puisque l’accession à cette catégorie se fait principalement sur la base des diplômes obtenus en formation initiale, généralement bac + 2.
La promotion de l’ouvrier est alors limitée au passage à « chef d’équipe » qui est un ouvrier apte à conduire tous les postes en rapport avec sa qualification, mais surtout qui a démontré son adhésion aux objectifs fixés par l’encadrement intermédiaire. Cette méthode de gestion n’est pas propre à l’industrie du papier-carton, elle est également à la base du management dans la restauration rapide ou encore dans l’industrie automobile (Smart par exemple et équipementiers).
Il est évident que l’introduction d’une forte dimension managériale dans la formation des ouvriers change la stratégie de progression de carrière en langage manager, la promotion est directement liée à l’adhésion du salarié au « projet de l’entreprise » et non plus seulement à une simple compétence technique. Cette critériologie aboutit à une formalisation ou à « objectiver » le degré de docilité du salarié selon une technique éprouvée outre-Atlantique.
Les problématiques posées à la branche
1 – Les effets de la mondialisation :
– restructurations
– fusions
– acquisitions
– délocalisations
2 – Les conséquences sociales de ces mouvements industriels (réduction d’effectifs, mobilité, fermeture de sites,..)
3 – Les conditions de travail dégradées
4 – La difficulté de faire vivre le dialogue social
5 – La difficulté d’identifier les décideurs
6 – Les risques environnementaux et la santé publique
4 – Une réalité syndicale :
a) La CFDT
La FCE compte aujourd’hui 170 sections dans ce secteur industriel avec 2 547 adhérents. Les équipes syndicales sont surtout présentes dans les sites de production et de transformation du papier. Au niveau géographique, ce sont les syndicats d’Alsace, Bretagne, Centre Val de Loire, Dauphiné Vivarais, Littoral Nord et Lorraine qui comptent le plus d’adhérents et le plus de sections.
b) Les autres organisations syndicales
Il n’existe pas de mesure véritable de représentativité des organisations syndicales dans les différents secteurs de la branche.
Pour autant, on peut estimer que la répartition peut se décompter ainsi : CGT 40%, CFDT 30%, FO 20%, CFTC 5% et CGC 5%.
Les relations intersyndicales existantes s’améliorent depuis la mise en place de l’OPCA en 1994. Cependant, cette coopération intersyndicale au niveau national est loin d’être une réalité dans les entreprises.
c) Les revendications fédérales :
Compte tenu des problématiques auxquelles est confrontée l’industrie papetière, la FCE-CFDT fait essentiellement porter ses efforts sur l’emploi, l’organisation et les conditions de travail.
En ce sens, la FCE-CFDT, non-signataire de l’accord sur le temps de travail dans la production-transformation, agit dans les entreprises pour obtenir des négociations sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du travail.
Un accord a été conclu sur les départs anticipés des salariés les plus âgés, permettant ainsi à ceux dont souvent les conditions de travail ont été les plus dures pendant de nombreuses années de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé.
La santé au travail est également un thème sur lequel la branche va se pencher plus sérieusement en ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques dont sont victimes les travailleurs de l’industrie papetière.
Au travers de l’OPCA, la formation professionnelle continue est aussi un enjeu majeur pour l’avenir des classifications de la branche. Compte tenu des évolutions technologiques observées dans le secteur, la FCE-CFDT, à partir d’une analyse des systèmes de certification professionnelle dans l’industrie papetière menée par le ministère de l’emploi, va s’efforcer de dégager des prospectives sur les emplois du futur et de dégager des propositions favorisant l’émergence de nouvelles garanties sociales pour les salariés.
Les conséquences sociales des mouvements engendrés par les multiples évolutions du secteur nécessitent un regard spécifique de la branche pour permettre aux équipes de mieux appréhender les leviers de l’action syndicale à mettre en œuvre.
D’autre part, l’industrie papetière étant une des plus polluantes, les questions environnementales prennent dans la branche de plus en plus d’importance. C’est pourquoi l’élaboration de propositions et d’actions pour la production de la pâte et du papier est un objectif que poursuivent les militants de la branche dans le but d’inscrire durablement le développement de ce secteur d’activité.
Au niveau international, par son investissement au niveau de l’EMCEF et de l’ICEM, la FCE milite pour une riposte syndicale efficace à la mondialisation et à ses effets néfastes sur l’emploi en revendiquant la promotion de politique d’action pour un développement durable de l’industrie papetière.
La conjoncture française en 1999
1. L’activité des producteurs français dynamisée par l’exportation
L’industrie du papier carton a fortement profité de la bonne orientation de la conjoncture française en 1998 et en 1997. Le PIB a en effet enregistré une croissance de 3,2% en 1998 contre 2,8% dans le reste de l’Europe. En 1997, la consommation en volume de papier-carton avait enregistré une croissance de plus de 10%, ramenée à 3,4% en 1998 en raison notamment de la crise asiatique.
En 1999, la croissance de la consommation en volume n’est que de 1,5%, en retrait par rapport aux prévisions qui tablaient sur un fort effet conjugué Euro et An 2000 (publication de documents) ces deux événements n’ont pas produit les effets attendus, la consommation est sur un rythme de croissance moyen annuel de long terme de 3%.
La croissance de la consommation a été très faible au premier semestre, mais une reprise a pu être observée dans la deuxième moitié de 1999 (+2,6% par rapport au 2nd semestre 1998).
Les papiers à usage graphique ont connu une bonne évolution (+3% en 1999 contre +3,2% en 1998), cette croissance est principalement portée par le papier journal.
En revanche, la consommation des papiers d’emballage s’est globalement réduite (-2%) cette réduction est liée à un mouvement de déstockage après une croissance de 5,8% en 1998. Or, avec ce mouvement de déstockage, la croissance aurait été de 2,5% en 1998.
En 1999, en volume, la production a progressé de 4,5% principalement en raison de la forte croissance des exportations (+11%), les marchés extérieurs représentent 50% des débouchés de l’industrie française. La France a bénéficié d’un effet de change favorable tant par rapport au dollar qu’à la livre sterling et la couronne suédoise.
Par zone, les exportations ont été fortes dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne (+8,2%), les Etats-Unis (+7%), l’Europe de l’Est (+12%) et l’Asie du Sud-Est (+70% après un recul de 40% en 1998).
Les exportations de papier journal se sont accrues de 25% après la mise en service d’une nouvelle unité de production destinée à alimenter le marché européen.
L’industrie papetière française a connu une croissance plus forte en 1999 que la plupart des autres pays producteurs à l’exception du Canada (+8%) en moyenne, la croissance au sein de l’Union Européenne a été de 2%.
2. Hausse des prix des papiers-cartons
La reprise de la demande tant au niveau français qu’international a entraîné une hausse des prix de ventes de + 6,6% au 2nd semestre 1999 ce qui aurait permis de restaurer les marges des entreprises selon la Copacel. Cette hausse des prix était attendue par les entreprises après une érosion de 5,5% des prix du papier carton en 1998. Ces baisses avaient particulièrement touché les prix des papiers d’impression et d’écriture et les papiers pour ondulé. Sur l’ensemble de l’année, la hausse des prix des papiers cartons en France est proche de 3,5%.
Le chiffre d’affaires de l’industrie papetière a progressé de près de 2% en 1999.
3. Hausse des prix des matières premières
La hausse des prix de ventes des produits a cependant été compensée pour les entreprises non intégrées par les hausses de cours de matières premières. Après avoir stagné à un niveau relativement bas depuis le 2nd semestre 1996, avec un creux au début de l’année 1999 (480$/T), les prix de la pâte (résineux et feuillus) se sont très fortement redressés pour terminer à la fin de 1999 à près de 630$ (+40%). Les prix des pâtes d’Eucalyptus sont passés de 360 euros à 580 euros (+33%).
Cette évolution est liée à la reprise de l’activité, en particulier dans la zone Asie, mais aussi à la fermeture d’un certain nombre de centres de production qui ont contribué à réduire les stocks des principaux producteurs. Les stocks NORSCAN ont atteint leur plus bas niveau depuis 1995. Ce mouvement n’a pas été compensé par la hausse des stocks des distributeurs européens (UTIPULP).
La hausse du cours du dollar qui a gagné 13% par rapport à l’euro a contribué à amplifier le phénomène.
Les papiers et cartons récupérés ont également subi de fortes augmentations de cours. Les principales sortes de papiers et cartons récupérés (sortes basses et sortes à désencrer) ont vu leur prix au minimum multiplié par 2 ou 3. Les prix des sortes supérieures ont connu des évolutions similaires à celle des pâtes vierges.
4. Le marché mondial des pâtes à papier : retournement favorable du cycle
Si comme nous l’avons vu, la consommation et la production de papier-carton se sont fortement développées au cours des dernières années, il n’en va pas de même pour l’offre de pâtes. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance :
> Le secteur souffre d’une faible rentabilité liée au caractère cyclique des cours, ainsi le cours de la pâte NBSK qui s’élevait à 925$ la tonne en 1995 n’était plus qu’à 460$/T au début de 1999 ;
> Un nombre important d’unités de production ont été définitivement fermées ce qui s’est traduit notamment par le retrait d’une capacité d’1 million de tonnes aux États-Unis ainsi que par d’autres arrêts dans le monde.
Les capacités de production ont été fortement sollicitées par une industrie en forte activité ce qui a entraîné un relèvement des cours à plus de 600$/T qui reste cependant loin du niveau atteint en 1995 : près de 1000$/T. Les spécialistes s’attendent à une poursuite de la hausse des cours en 2000.
Des évolutions de structure importantes sont intervenues sur le marché des pâtes au cours des dernières années avec un rééquilibrage de la compétitivité monétaire des producteurs européens face aux producteurs américains (évolution favorable du cours de l’euro par rapport au dollar).
La mise en place de la zone euro évite les problèmes de distorsions de concurrence, même si la Suède, grand pays forestier et papetier ne fait pas partie de cette zone.
5. Baisse de 3% de la production française de pâte à papier
En 1999, la France a produit 2600 kT de pâtes à papier pour une consommation de 4214 kT. Les exportations de pâtes à papier s’élèvent à 400 kT et les exportations à 2000 kT.
La production a subi un recul de 3% cette baisse de production s’explique par la fermeture de l’usine de pâte de Stracel, et par le passage de l’usine de Grand Couronne (Chapelle Darblay) aux vieux papiers ainsi que par des arrêts momentanés pour travaux et améliorations (Smurfit-Cellulose du Pin).
Aucune capacité de production nouvelle n’est annoncée à court terme. Si l’augmentation de la demande mondiale se poursuit au même rythme qu’en 1999 (+5,5%) mondial, la production de pâtes pourrait retrouver un certain attrait en termes de rentabilité ce qui serait susceptible de susciter des investissements.
6. Papiers d’hygiène : un secteur marqué par la situation fortement concurrentielle qui prévaut dans la grande distribution
La production de papier à usage domestique et sanitaire a enregistré une croissance de 5% avec 540 kT produites pour une consommation de 615 kT (+5,5%).
La commercialisation des produits sur ce marché passe par la grande distribution qui pressure fortement les industriels sur leurs prix de vente et favorise une forte concurrence entre les marques des grands spécialistes (Fort James, Kimberly Clark, Procter, Molnylcke). Le marché est caractérisé par une forte présence des marques de distributeurs et des marques discount, en particulier sur les segments du papier toilette et de l’essuie tout.
La pression exercée par les distributeurs et la guerre des prix que se livrent les fabricants expliquent la stabilité du marché en valeur, marché qui peut être chiffré à 7,5 milliards de francs HT pour le segment des produits en feuille.
L’augmentation de la production provient principalement de la reprise de la production de certaines unités arrêtées en 1998, ce qui avait engendré au cours de cette année un recul de 3,8% de la production. On note en 1999 l’arrêt d’une unité de 30000 tonnes.
Le papier toilette représente près de la moitié du tonnage en volume (300 kT) et progresse relativement peu (1,5%).
Les autres segments sont :
– les articles d’essuyage (industriels et ménagers) : 200 kT (+5%) ;
– la gamme table : 60 kT (+7%) ;
– les mouchoirs et serviettes : 50 kT (+7%).
Les importations s’élèvent à 155 kT après une augmentation de 19% en 1998, elles enregistrent des baisses dans deux secteurs : le papier toilette et l’essuie-tout ménager en raison de l’ouverture de trois usines de transformation en France par des sociétés italiennes qui importent des bobines mères.
Les exportations représentent 108 kT et sont toujours bien orientées.
Les produits d’hygiène à matelas absorbant (couches, culottes, hygiène féminine, incontinence) représentent un marché de 6 milliards de francs. Le marché des produits d’hygiène à matelas absorbant stagne : +1,5% pour les couches en volume, – 1,5% pour les produits d’hygiène féminine. Seul le petit segment plus récent des produits liés à l’incontinence croît (+5%).
Sur ce marché, les principaux acteurs sont des sociétés internationales qui développent des stratégies européennes d’acquisition et de conquêtes de part de marché.
De nouvelles capacités vont être ouvertes en Italie en 2000 (200 kT), ainsi qu’en Espagne, en Allemagne et au Pays-Bas. Le marché étant structurellement en surcapacité, ces ouvertures seront sans nul doute compensées par des fermetures d’unités existantes dans les pays où le coût de la main d’œuvre est plus élevé.
7. Augmentation de la capacité du recyclage des papiers-cartons
En 1999, la consommation de papier-carton recyclés s’est élevée à 5,3 millions de tonnes (+7%). Depuis 1993, la consommation de matériaux recyclés a augmenté de 40%.
La France occupe la deuxième place en Europe pour la consommation de matières premières issues du recyclage.
Cette hausse résulte de l’augmentation des capacités installées en particulier les capacités de désencrage. Les sortes « à désencrer » ont progressé de 25% en 1999. Le taux d’utilisation de matières recyclées devrait atteindre 55% en 2000.
En Europe, les capacités de recyclage s’élèvent à 38 millions de tonnes dont 10 millions de tonnes pour les seules capacités de désencrage. Dans le monde, on peut estimer à 140 millions de tonnes la quantité de papier carton qui a été récupérée pour une production de 315 millions de tonnes.
L’utilisation de produits recyclés est particulière forte dans le domaine de l’emballage, mais aussi et de plus en plus dans le papier journal.
La part des fournitures françaises représente 80% du total, les importations sont en légère augmentation (+4%) et représentent 1,6 millions de tonnes.
Les exportations ont augmenté de 16%, elles s’élèvent à 1 million de tonnes.
La France demeure une zone déficitaire en papier carton à recycler pour la treizième année consécutive. Ce déficit représente de l’ordre de 5% de la consommation nationale en produits à recycler (230kT).
Les produits à recycler font l’objet d’échanges internationaux en croissance constante. Les États-Unis sont le principal pourvoyeur et l’Asie le principal demandeur.
L’Europe qui était traditionnellement une zone déficitaire est devenue légèrement excédentaire avec toutefois des disparités importantes : l’Allemagne est par exemple fortement excédentaire avec 2 millions de tonnes et la France reste nettement déficitaire.
Ces déséquilibres apparaissent comme un enjeu stratégique majeur pour la compétitivité des usines qui dépend fortement du coût de la matière de base.
La France est pénalisée par un taux de récupération très faible : 46% qui se situe au-dessous de la moyenne européenne (51%) et très en dessous du taux allemand (71%), de celui du Japon (50%) ou de celui des États-Unis (47%).
Ce handicap est important car la disponibilité des matières est un déterminant majeur de la décision d’investir dans de nouvelles capacités.
8. Les papiers de presse : investissements massifs
L’année 1999 a été marquée par d’importants investissements. MATUSSIERES & FOREST qui possède six usines a investi 430 MF pour la modernisation de ses sites sur trois ans.
La société UPM KYMMENE a investi 1 milliard de francs sur deux sites, d’une part pour que deux de ses machines à papier de la CHAPELLE DARBLAY puissent produire à partir de matière recyclée et d’autre part pour produire un nouveau type de papier offset sur le site de STRACEL à Strasbourg.
NORSKE SKOG a investi à Golbey 2,4 milliards de Francs pour la construction d’une nouvelle machine à papier portant la capacité de son usine de production de papier journal à 600 000 T/an . Cette usine devient la plus moderne au monde pour la production de papier journal à partir de matière première recyclée.
Ces investissements sont favorables pour le maintien d’une industrie papetière forte en France. Le syndicat patronal COPACEL qualifie ces usines « d’ultra modernes et d’ultra compétitives ».
Une machine à papier est construite pour durer vingt ans, gageons que ceci constitue une garantie de sécurisation de l’emploi au moins à moyen terme dans le secteur.
La France traditionnellement importatrice de papier journal (en 1990 la production domestique ne représentait que 60% de la consommation) devient un exportateur important (consommation 800 kT par an ; capacité de production 1 300 kT/an).
9. Papier d’impression et d’écriture
La production de papier d’impression et d’écriture s’élève en 1999 à 3249 kT, soit une progression relativement importante de 4,8% après un recul en 1998 lié à la fermeture d’une importante unité de production.
La consommation augmente de 2,8% (4434 kT) ce qui se traduit par un développement des importations (+5,1%), mais les fabricants français tirent leur épingle du jeu : les exportations progressent de 10%.
L’augmentation de la consommation est principalement le fait d’un segment du marché : le papier couché sans bois (+10,6%) qui profite de la forte activité du marché de la communication publicitaire médias et hors médias (brochures, rapports, dépliants, catalogues, mailings).
En revanche, sur les autres segments l’activité est relativement atone, à l’exception des papiers non couchés sans bois (+3,2%), segment porté par le développement des technologies informatiques.
10. Papiers et cartons d’emballage
La consommation de papier d’emballage est étroitement liée à la conjoncture économique française, tant de la demande intérieur que des exportations de produits.
Le secteur compte 42 entreprises représentant 56 usines et 5 280 salariés.
En Europe, la France occupe le 4ème rang avec une production de 4,4 millions de tonnes et le 7ème rang mondial. La place des producteurs français à l’international est importante et l’exportation constitue un débouché essentiel qui rend l’industrie moins dépendante de la conjoncture française.
Les investissements sont envisagés à l’échelle européenne dans une perspective d’accompagnement des grands clients, mais aussi en fonction des contraintes institutionnelles (juridiques, sociales, fiscales).
Le chiffre d’affaires global du secteur s’élève à 12,5 milliards de francs, il augmente de 1,5% soit un rythme comparable à l’augmentation de la production en volume (+1,3%).
Cette relative faiblesse de l’activité est liée à de nombreux arrêts techniques et incidents de production qui ont émaillé l’année 1999.
En outre, si l’on considère les mouvements de déstockage, on peut estimer la croissance réelle du secteur à 2,5%.
Globalement, le secteur a bénéficié au cours de l’année 1999 d’une augmentation des indices de prix qui a permis une restauration des marges, phénomène qui doit être relativisé par la hausse de matières premières.
En 2000, la croissance du marché français devrait se situer entre 2% et 3%.