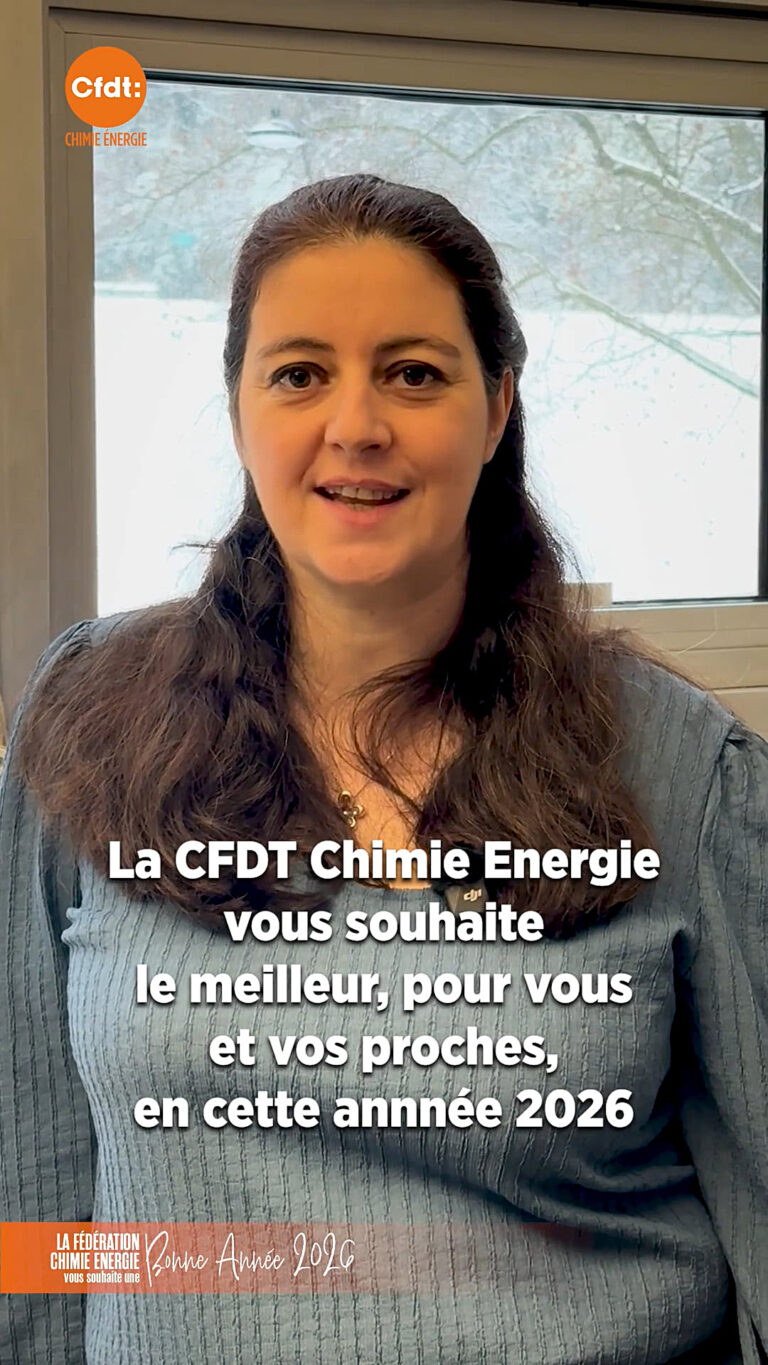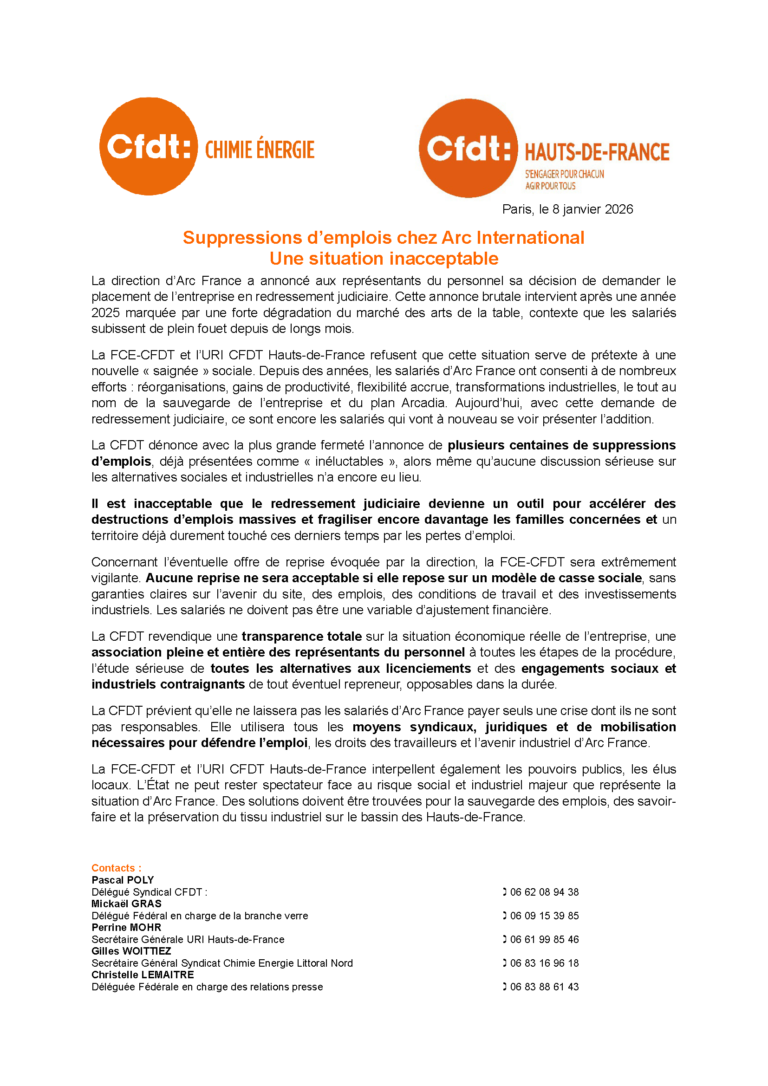« Le dialogue social », l’expression est sur toutes les lèvres, de l’établissement jusqu’au groupe et du local jusqu’à l’international. Réalité ou effet de mode ? Regard sur les industries chimiques.
Un peu d’histoire. Au cours de la première moitié du siècle dernier, en s’organisant au sein d’un syndicat, les salariés cherchaient à défendre leurs droits et à en conquérir de nouveaux pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. Il y avait alors d’un côté les patrons et de l’autre les salariés. On parlait de « lutte des classes ». Et déjà tout conflit, combat ou affrontement dans les entreprises se terminait par une sorte d’armistice, un compromis discuté et négocié entre les parties. Il signifiait le règlement du litige.
Aujourd’hui, si la référence à la lutte des classes est sortie des discours, les patrons sont toujours là et les salariés avec leurs organisations syndicales aussi. A noter toutefois que la section syndicale et le délégué syndical ont été reconnus par la loi et sont entrés dans les entreprises. C’était en 1968.
Quant à la notion de « dialogue social », si elle est évoquée dès 1963, c’est en 2004, dans le traité constitutionnel européen que le terme est consacré. La démarche de dialogue social s’affiche avec une connotation positive qui valorise la communication et, si le rapport de force est toujours au rendez-vous entre les employeurs et les syndicalistes, le dialogue est reconnu par tous comme une source de régulation.
L’obligation de la négociation dans l’entreprise. Dans le secteur des industries chimiques, comme dans les autres secteurs, la loi oblige les entreprises à la négociation annuelle obligatoire (NAO) notamment sur la question des salaires. Chacun peut alors apprécier dans son propre établissement de la qualité du dialogue et des capacités respectives des parties en présence à communiquer, à se comprendre, à entendre et confronter les points de vue. Il s’agit de parvenir à un diagnostic partagé pour ensuite identifier les décisions et meilleurs choix possibles. La négociation obligatoire, et toutes les autres négociations avec leurs échecs et leurs succès sont, avec les accords signés, l’illustration du dialogue social. Mais au-delà, le dialogue est aussi à l’œuvre au sein des comités d’entreprise, des comités de groupe et des comités européens.
Notons que la loi du 20 août 2008 sur la représentativité a validé la négociation et donc le dialogue social dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.
La branche et l’Europe. Le processus de négociation instauré en France, et donc du dialogue social est à l’origine des conventions collectives de branche. Celle de la Chimie date de 1953. Depuis cette date ses dispositions ont évolué, elle s’est améliorée et enrichie, mais aussi quelquefois complexifiée.
Soulignons que l’Etat peut aussi intervenir au niveau de la branche quand le dialogue se met à patiner entre employeurs et organisations syndicales. Le dialogue devient alors tripartite, même si les représentants de l’Etat agissent davantage en qualité de facilitateur voire de médiateur.
A l’échelle européenne, le dialogue social figure en bonne place dans la réglementation communautaire. Dans la chimie, ce sont l’Emcef (notre fédération syndicale européenne de la chimie de l’énergie et des mines) et l’Eceg (les employeurs de la chimie en Europe) qui se retrouvent régulièrement autour de la table. Mais là, point de négociation qui aurait vocation à se conclure par un accord et des mesures applicables à tous les salariés de la chimie. Pas encore… Mais le dialogue instauré à ce niveau en 2002 permet la discussion, les échanges et le partage de points de vue. Certes, les thèmes sont relativement consensuels, tels la formation professionnelle ou la sécurité. Pour autant ce dialogue social européen est ponctué de temps à autre par des textes écrits en commun. Il s’agit de « positions ou déclarations communes ».
Et moi, et moi et moi concrètement. Le dialogue social a aujourd’hui pignon sur rue et la parole est donnée à chacun. Mais gardons-nous de tout angélisme béat. Chacun a sa propre compréhension de l’équité et le rapport de force persiste. Aussi, toute rencontre et dialogue « d’égal à égal » avec son employeur, tel l’entretien annuel, doit être préparé. C’est bien là le premier service CFDT qui doit être garanti aux adhérents.