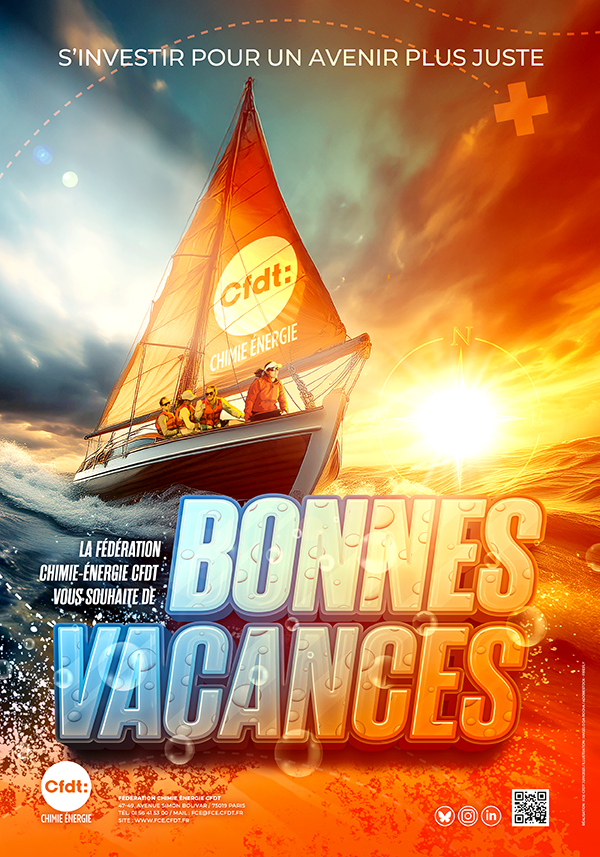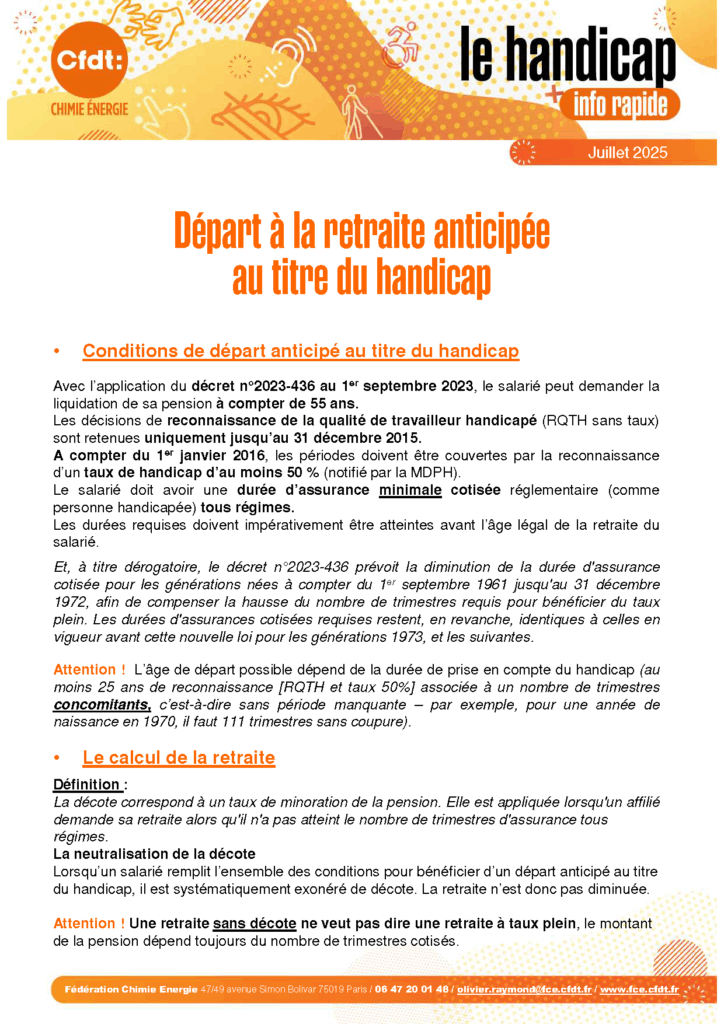Les militants syndicaux de plus de 150 pays se sont retrouvés à Trinité-et-Tobago pour échanger sur les secteurs de la chimie et de l’énergie. Deux temps forts auront rythmé la partie consacrée à la chimie de cette conférence organisée par l’Icem, fédération mondiale. Les militants ont d’abord abordé la thématique des femmes dans le secteur chimique. Comme en France, l’industrie chimique mondiale véhicule une image négative (dangerosité, métiers masculins, etc.). De fait, les étudiants ne s’orientent que très peu vers ce secteur. Si rien n’est fait, cette situation devrait conduire à des pénuries d’effectifs d’ici cinq ans. Les femmes sont encore plus touchées par cette situation, du fait d’une formation initiale axée davantage sur les métiers de la santé et des sciences sociales. Les affiliés à l’Icem ont souligné la nécessité de prendre en charge l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, y compris au sein des organisations syndicales. Les femmes doivent être à des postes de responsabilités, aussi bien professionnelles que syndicales.
Autre temps fort, la présentation du Plan d’Action de la Chimie par Manfred Varda, nouveau secrétaire général de l’Icem. Un plan d’action qui s’articule notamment autour du développement d’accords de responsabilité sociale d’entreprise, de la lutte contre la sous-traitance et le travail précaire, d’un dialogue avec l’Organisation internationale du Travail, d’une approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. Cette approche veut inciter tous les pays à mettre en place un processus visant à définir des méthodes de manipulation des produits chimiques, des interdictions ainsi que des règles de protection à mettre en œuvre. Cet outil vient compléter le dispositif Reach. La FCE-CFDT a alors rappelé qu’il fallait militer pour l’application mondiale de Reach afin de limiter les effets de la concurrence de l’industrie européenne par rapport à l’industrie des autres continents. Cette orientation a surtout le mérite de renforcer la protection des salariés.
Dans la partie de la conférence consacrée à l’énergie, les affiliés ont abordé les orientations énergétiques à prendre pour répondre aux besoins des populations. Après le rappel des données mondiales existantes dans le domaine de l’énergie, plusieurs intervenants ont fait part des choix faits par leur pays pour les décennies à venir. La première extraction de pétrole de la petite république qu’est Trinité-et-Tobago remonte à 1866. Depuis, le pays dispose d’une réserve de 766 millions de barils, et produit 4,2 millions tep par jour de gaz. Il est le premier fournisseur de gaz aux Etats-Unis. Des accords stratégiques avec le Brésil et le Venezuela participent d’une stratégie de sécurité d’approvisionnement énergétique du pays. D’autres pays, dont le Canada et le Japon, ont décidé de développer la technologie nucléaire afin de répondre aux enjeux du Protocole de Kyoto. Les Africains du Sud, quant à eux, se préoccupent de pérenniser leurs exploitations de charbon, qui sont une ressource économique essentielle du pays. Afin que les nouvelles technologies puissent conjuguer leur intérêt avec celui du climat et plus largement, de l’environnement, leurs recherches s’orientent vers le charbon propre et la captation du CO2. Les Allemands et les Européens de l’Est sont intervenus dans le même esprit. Quant aux Norvégiens et aux Américains, ils ont davantage mis l’accent sur le pétrole et les recherches à développer pour préparer l’après-pétrole. Les réserves prouvées dans ce domaine ne sont que de 40 ans (contre 70 pour le gaz, et 150 pour le charbon).
La FCE est intervenue sur la politique énergétique européenne. Elle a insisté sur le fait que pour vivre dans la dignité, les populations du monde entier ont besoin d’accéder à l’énergie. Pour répondre à cette demande, l’ensemble des sources énergétiques sera nécessaire. C’est donc bien en fonction des ressources existantes, des nouvelles technologies, des réalités nationales et continentales, et des contraintes environnementales que l’offre d’un panel énergétique doit être construite. C’est dans ces termes que la conférence s’est conclue.