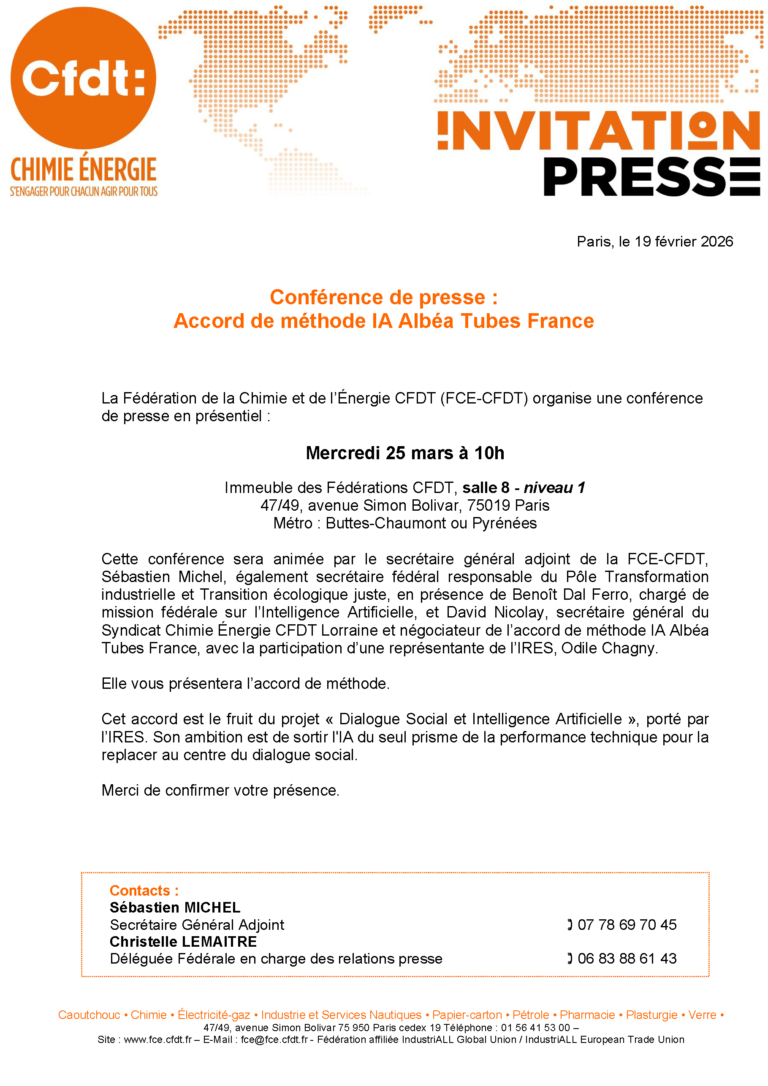Après avoir examiné l’événement et le site, le Tribunal s’est penché sur les conditions dans lesquelles ont été menées les différentes enquêtes au cours de l’instruction, notamment sur l’enquête initiale du SRPJ (police judiciaire).Elle a permis de qualifier les homicides, volontaires ou involontaires, afin de pouvoir instrumenter sur commissions rogatoires. L’orientation donnée par le procureur de la République, en affirmant le 24 septembre 2001 la thèse probable de l’accident à plus de 90 %, a été dénoncée par la défense. Malgré ce contexte, il ressort que l’instruction n’a écarté aucune piste. Avant d’examiner les différentes thèses, le Tribunal va entendre des témoignages sur la perception de l’événement. Plusieurs « situations » vont être analysées, la défaillance de micro-ordinateurs, le déclenchement de l’unité d’ammoniac, ou encore le passage d’hélicoptères, avec l’appui de témoins et d’experts.
Mais ce qui est attendu dans les prochaines semaines, c’est bien l’examen des différentes thèses, qui sera un moment important du procès.
Pour préparer au mieux cette phase du procès, le groupe de coordination (FCE, Union régionale interprofessionnelle (URI) Midi-Pyrénées et syndicat Chimie Energie Midi-Pyrénées) s’est réuni pendant deux jours avec ses avocats. Les huit thèses retenues ont été passées au crible.
Les thèses de l’événement antérieur (explosion d’une bombe de la seconde guerre mondiale), la cause naturelle (foudre, météorite), l’éventuel phénomène électromagnétique, l’accident industriel préalable et la piste intentionnelle n’ont pas été retenues. Les investigations et expertises menées permettent de les écarter.
Celle de l’explosion de poussières ou de l’UVCE peut être rejetée, elle aussi au regard des résultats de l’enquête (pas de fuite de gaz naturel dans aucune entreprise environnante). Mais l’hypothèse d’une fuite d’hydrazine qui n’a pas fait l’objet d’investigation ne peut être examinée par le Tribunal. La thèse électrique n’est a priori pas retenue par le groupe, mais nécessite des éclaircissements qui seront demandés par nos avocats. En effet, même si celle-ci ne semble pas être la cause de l’explosion, il est nécessaire de comprendre pourquoi ces phénomènes électriques se sont produits.
Le groupe de coordination s’est penché plus particulièrement sur la thèse de l’accusation : le mélange de produits chimiques. Plus d’un mois sera consacré à l’examen de cette thèse.
Quatre thèmes ont retenu l’attention du groupe :
– La gestion des hangars 335 et 221 (celui qui a explosé). C’est un point important puisqu’il permettrait de mettre en avant le passage de déchets de chlore du hangar 335 au 221. Le rôle des divers acteurs (Grande Paroisse et sous-traitance) devra aussi être éclairci.
– Le suivi des déchets et notamment des sacs de chlore. La séparation des activités de nitrate d’ammonium et de chlore est organisée pour les produits nobles. Mais la gestion des déchets pose, elle aussi, des questions notamment sur les consignes et la formation données au personnel sous-traitant.
– Le contrôle de la sous-traitance. L’instruction a notamment mis en avant la modification verbale d’un contrat de sous-traitance sur le suivi des sacs de chlore.
– Le dernier thème est celui des causes de l’explosion. Si le mélange de nitrate d’ammonium et de chlore est reconnu comme explosif, des conditions particulières doivent être rassemblées comme l’humidité, la quantité de chlore, la densité, la granulométrie.
Ces quatre thèmes sont les éléments essentiels qui permettront au Tribunal de retenir, ou pas, la thèse de l’accusation. Des débats tendus en perspective pour les semaines à venir.