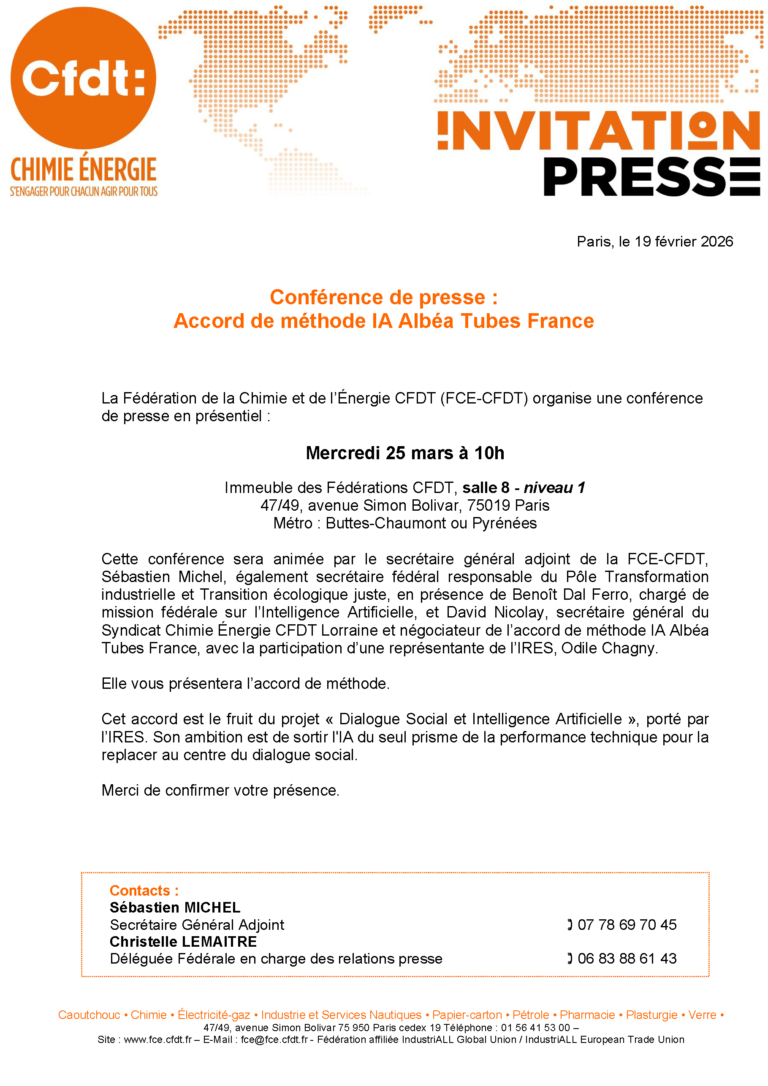Le 25 mars prochain sera célébré le cinquantième anniversaire du Traité de Rome. Cette date scelle l’acte de naissance officiel de ce qui deviendra la « Communauté européenne ». Il faut remonter le temps pour rechercher les racines et les pionniers de ce grand projet. Nul doute que la Première guerre mondiale, par les ravages qu’elle aura causés sur l’ensemble du continent européen, en fut le détonateur. Directement avec des millions de morts au combat, et indirectement par les bouleversements politiques et la montée des régimes totalitaires. Aujourd’hui, cette guerre peut être considérée comme une véritable « guerre civile » par la nature de ses principaux protagonistes, tous européens, mais aussi par ses conséquences désastreuses pour l’ensemble des peuples européens, tant aux plans économiques et sociaux qu’au niveau du recul des valeurs humanistes qui avaient permis l’essor des 18 et 19e siècles. La Seconde guerre mondiale poursuivra encore cette folie destructrice.
C’est pour ne plus vivre cela, et redonner un espoir et une vision de progrès aux peuples de notre continent, que les fondateurs de l’Europe ont construit et signé le Traité de Rome en 1957. Chacun peut aujourd’hui mesurer le travail accompli. Pour la première fois, depuis plus de soixante ans, les pays de l’Union européenne n’ont plus connu de guerre. Le niveau de vie s’est considérablement élevé. Les réalisations économiques, démocratiques et culturelles qui montrent l’exemplarité du chemin parcouru, sont nombreuses. L’afflux des pays qui ont rejoint l’Union européenne, et la volonté de le faire de ceux qui n’y sont pas encore, pose évidemment la question de la gouvernance de l’Union. A tel point que la construction européenne est victime, d’une certaine façon, de son succès.
Sans équivalent historique, cet ensemble de près de 500 millions d’habitants doit maintenant redonner toute leur place aux citoyens de manière beaucoup plus directe. Il doit aussi mieux tenir compte de la diversité des situations et de la capacité des différents acteurs à agir ensemble. La société civile, les organismes intermédiaires et singulièrement le syndicalisme, doivent trouver une plus grande place et une plus grande légitimité dans les procédures décisionnelles. Il est temps de renforcer la nécessaire construction économique par une ambition politique et sociale. Ne pas franchir cette nouvelle étape serait renier le message des pères fondateurs de l’Europe.
Aujourd’hui, la prospérité économique et les conséquences des choix importants s’imposent, de fait, à tous les citoyens européens. Et personne ne peut plus penser que cela puisse se faire sans une vision claire de l’intérêt général européen, défini démocratiquement. Le chemin sera long et difficile, mais il est incontournable. La résistante Lucie Aubrac qui vient de nous quitter, répétait inlassablement aux jeunes qui l’interrogeaient sur l’avenir : « Battez-vous d’abord pour que l’Europe existe ! ». C’est le choix que fait la CFDT avec, notamment, la Confédération européenne des syndicats. Se battre inlassablement pour l’Europe est sans doute la meilleure façon de fêter le cinquantième anniversaire du Traité de Rome.