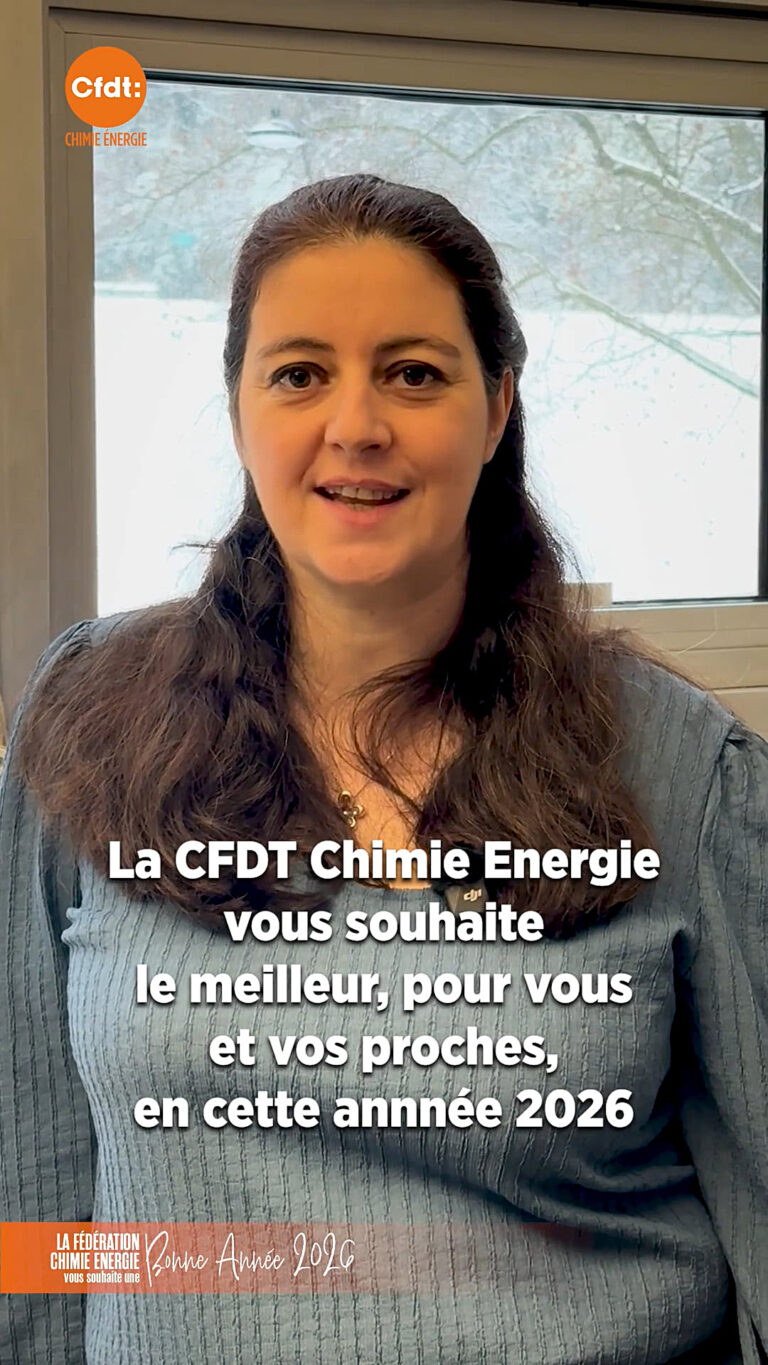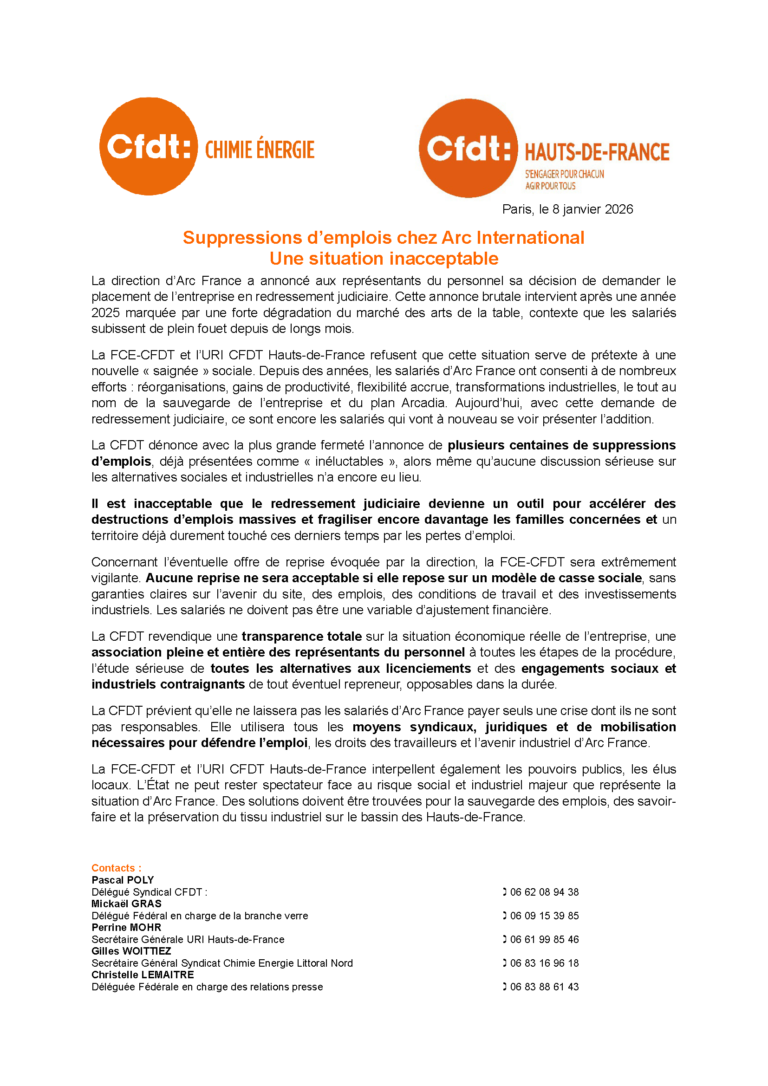Pour ce qui concerne les atteintes bénignes liées à l’amiante et pour un faible taux d’incapacité, les experts médicaux et juridiques considèrent qu’il existe trois types de préjudices. Explications.
Le préjudice physique. Médicalement, il est admis qu’il existe bien une relation entre l’exposition à l’amiante et les symptômes suivants :
– difficultés à la respiration (dyspnée) ;
– diminution de la capacité vitale jusqu’à 10 % ;
– diminution du volume maximal expiré en une seconde (VEMS) ;
– surinfections bronchiques accompagnées ou non de toux productives ;
– fatigue chronique ;
– sensation de gêne dans la poitrine (piqûres, brûlures, picotements internes). Elle est liée à la persistance de fibres d’amiante qui entraînent des micro-déchirures et une excitation des terminaisons nerveuses pulmonaires.
Le préjudice moral. Actuellement, au Fiva (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante), ce poste représente entre 85 et 90 % du montant de l’indemnisation.
La victime, même si le taux d’incapacité n’est que de 5 %, subit depuis la découverte de sa pathologie un préjudice moral très important car :
– L’amiante a été classé cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer dès 1977.
– En 1988, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) réaffirme l’effet cancérogène de l’amiante, précisant qu’il n’existe pas de seuil de concentration connu en dessous duquel les poussières d’amiante ne peuvent induire un risque de cancer.
– Le rapport parlementaire du 22 février 2006 souligne notamment : « Dans ce crime sociétal, la dimension psychologique n’a pas été suffisamment prise en compte. » A travers ses travaux, la mission parlementaire a pu mesurer la pression psychologique chez les salariés exposés qui vivent cette affection comme une épée de Damoclès. Même s’ils savent que les plaques pleurales ne conduisent pas obligatoirement à un cancer.
A deux ans et demi d’intervalle, les cours d’appel de Metz et de Reims ont respectivement parfaitement caractérisé les souffrances morales des victimes exposées aux poussières d’amiante :
– 6 septembre 2005 « (…) l’incertitude quant à l’avenir impose au malade un suivi médical générateur d’angoisse ; qu’il ne peut être fait abstraction des souffrances psychologiques réelles, résultant de la crainte subjective d’une apparition possible des autres pathologies liées à la présence irréversible d’amiante dans les poumons (…) ».
– 6 février 2008 « (…) si en l’état des connaissances médicales, il n’est pas démontré que l’exposition à l’amiante entraîne inéluctablement un cancer, il n’en est pas moins vrai qu’une incertitude quant à l’avenir impose au malade un suivi médical générateur d’angoisse. Il ne peut être fait abstraction des souffrances psychologiques réelles résultant de la crainte subjective d’une apparition possible des autres pathologies liées à la présence irréversible d’amiante dans les poumons ».
Le préjudice d’agrément. La littérature médicale montre que, si en l’absence de « Point Zéro » il n’est pas toujours possible de déterminer individuellement la restriction de la capacité respiratoire due aux plaques pleurales, il est par contre possible de le montrer statistiquement.
Ainsi, les experts chargés d’évaluer le dépistage des lésions pleurales dues à l’amiante (plaques et épaississements pleuraux), lors de la conférence de consensus de janvier 1999 notent qu’ « il existe maintenant un grand nombre d’études montrant que dans les populations de sujets exposés à l’amiante, la présence de plaques pleurales s’accompagne en moyenne d’une réduction des volumes pulmonaires, habituellement exprimé par la réduction de la Capacité vitale forcée (CVF). Les épaississements pleuraux diffus ont une influence nettement plus marquée ».
Le 19 décembre 2003, l’Assemblée plénière de la cour de cassation, s’est prononcée en ce sens dans un arrêt de principe, en rappelant que le préjudice d’agrément se définit comme : « La gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt d’activité avant la consolidation, et le préjudice fonctionnel d’agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs. »