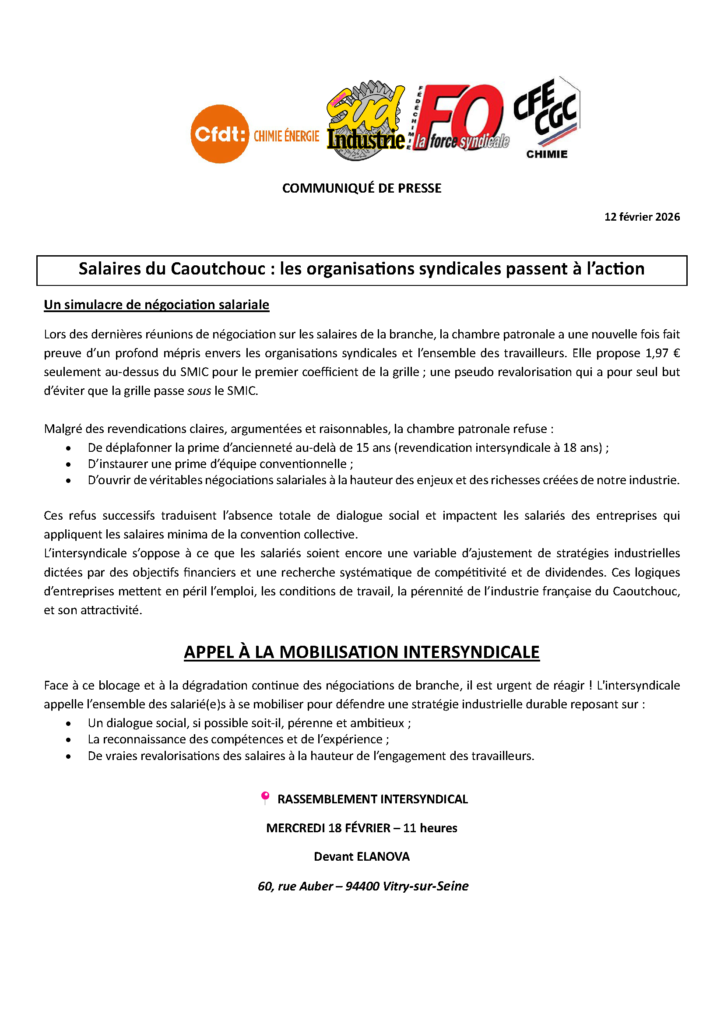Les compagnies pétrolières s’emploient à améliorer la rentabilité de leur activité sur les aéroports aux dépens de la qualité des conditions de travail. La CFDT tire la sonnette d’alarme !
Les avitailleurs sont les salariés que nous voyons sur les tarmacs des aéroports avec leurs camions citernes. Ils sont chargés de distribuer le kérosène aux avions. Ces salariés qui dépendent de la convention collective du pétrole travaillent pour des compagnies pétrolières ou des GIE (groupement d’intérêt économique) dépendants de ces mêmes compagnies.
Ils sont aujourd’hui en colère car leurs conditions de travail se dégradent régulièrement depuis plusieurs années.
En 2004, les GIE et les pétroliers ont mis en place un « service plus » qui impose aux avitailleurs de calculer les quantités à avitailler, contrôler et équilibrer les réservoirs des avions lors du remplissage. Cette responsabilité était auparavant à la charge des pilotes ou des mécaniciens au sol des compagnies aériennes.
Avec des objectifs de rentabilité toujours plus importants, les compagnies aériennes ont réduit chaque jour un peu plus les temps d’escale des avions. De fait, c’est en vingt-cinq minutes qu’il faut avitailler des avions encore chauds en kérosène, produit hautement inflammable et surveiller le bon déroulement des opérations. Tout cela en présence des bagagistes, des techniciens et autres personnels aéroportuaires qui s’activent autour de l’avion, mais aussi du personnel de bord et des passagers qui embarquent.
Début mai, la FCE-CFDT est intervenue auprès la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour dénoncer ces conditions de travail dangereuses et le manque de dispositions règlementaires pour sécuriser les périmètres à risques pendant les opérations de coulage. A Roissy, l’administration a déjà répondu et œuvré efficacement. Il reste à généraliser ces pratiques sur l’ensemble des aéroports nationaux.
Aux conditions de sécurité déjà dégradées, les directions souhaitent mettre en place des organisations du travail basées sur l’hyper-flexibilité des horaires des avitailleurs.
Aujourd’hui, la majorité des avitailleurs effectuent déjà des roulements entre 5 heures du matin et minuit, 365 jours par an. Cela se traduit par une organisation du travail en plusieurs équipes avec des durées quotidiennes de travail de 8, 9 ou 10 heures, selon les jours et les aéroports. Cette organisation permet au salarié, dans le meilleur des cas, de bénéficier d’un week-end par mois. Pour rentabiliser davantage l’opération d’avitaillement, les GIE et les pétroliers veulent généraliser des organisations qu’ils appellent « service T », « service MS » ou bien encore » horaires blancs ».
FLEXIBILITÉ ET PÉNIBILITÉ
Ces organisations, vantées par les directions, prévoient dans les plannings des périodes de travail sans horaires prédéterminés. Ainsi, le planning individuel est donné à la semaine et s’adapte à la fois aux absences planifiées et impromptues des collègues et aux variations d’activité. Ainsi il devient possible de travailler une journée de 15 heures à minuit et le jour suivant de 5 heures du matin à 10 heures.
Cela fait plusieurs mois que les représentants des salariés combattent ces principes, sans obtenir de résultats réels. Les directions s’obstinent à imposer le principe des périodes sans horaires. C’est la flexibilité absolue.
Ces organisations du travail, mais ne devrait-on pas parler plutôt de désorganisation, sont synonymes de fatigues accrues. Elles entrainent une baisse de vigilance ainsi qu’une détérioration rapide de la santé. Les rythmes biologiques totalement perturbés entrainent des troubles du sommeil et de l’appétit. Alors, comment peut-on rester serein et vigilant dans de telles conditions ?
Pour répondre, et désamorcer, les menaces de grèves envisagées pour le premier week-end de juillet, la chambre patronale (UFIP) a accepté de recevoir les organisations syndicales en septembre afin de clarifier la situation et peut-être ouvrir une négociation qui permettrait de limiter cette frénésie de disponibilité et de flexibilité à outrance. Pour la CFDT, il s’agit de sortir d’une spirale qui conduit à confondre conditions de travail et pénibilité.