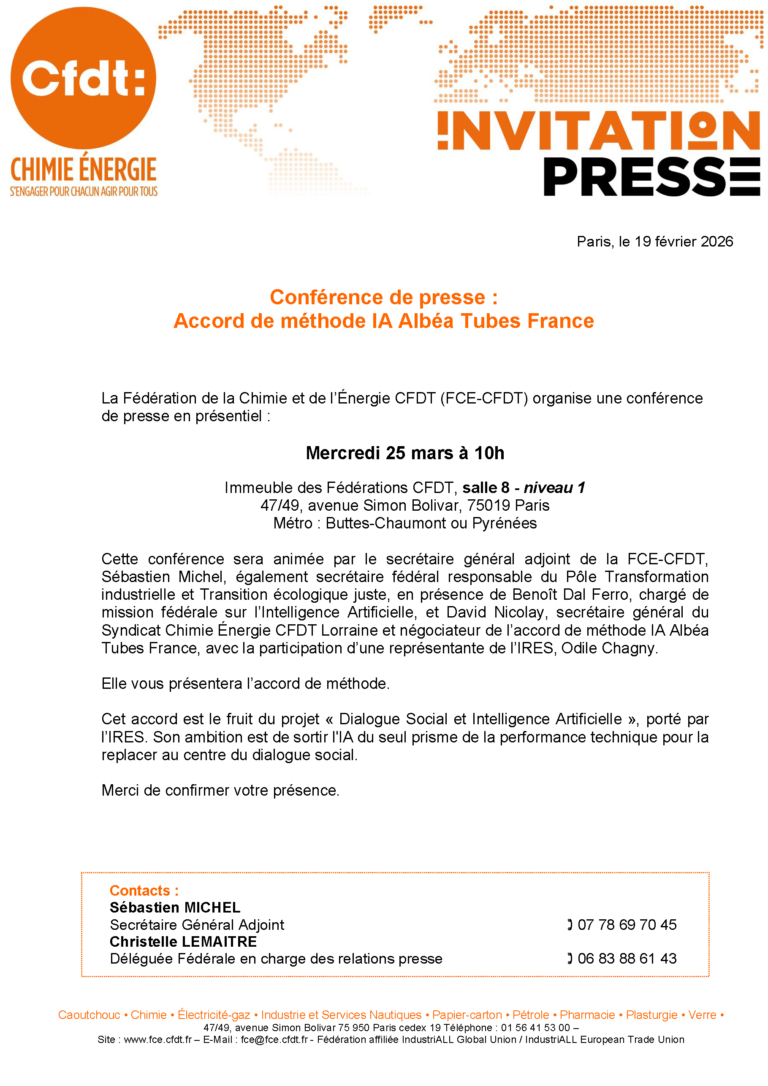La mémoire de chaque individu, par défaut d’exactitude ou nécessité, recompose elle-même la réalité, par intérêt ou conviction.
Chacun dispose d’une partie de réel, de fantasmé et d’imaginaire. Il ne s’agit pas là de mythomanie mais d’une nécessaire quête de sens pour le cerveau, quitte à transformer la vérité. C’est un puzzle qui se recompose en permanence pour notre confort et la survie de notre raison.
La mémoire collective est bien plus complexe, elle associe les souvenirs que l’on pense ou voudrait avoir vécus. Son exactitude est parfois incertaine et tend à faire des souvenirs une preuve de la bien-pensance du moment. Elle est parfois malheureusement sélective, voire orientée.
Elle est une compilation de souvenirs acquis au fil des générations, souvent reconstitués avec l’état d’esprit de celles-ci : nous avons tous appris, à l’école, que des hordes de citoyens avaient pris, sans culotte, la Bastille pour en délivrer les prisonniers injustement mis aux fers. La vérité est toute autre mais la nation aime à se rappeler ses expériences glorieuses qui ont forgé la mémoire collective : 1789, les barricades de la Commune de Paris, les taxis de la Marne, Le Front Populaire, l’entrée de la 2e DB dans Paris, les pavés de 1968… Ces symboles sont sacrés, ils forgent notre nation et l’esprit de la République Française.
Les intentions qui ont mené les hommes à l’action sont moins symboliques mais plus essentielles et ont permis de progresser vers plus de justice, d’égalité, de démocratie, de solidarité et de liberté.
Les générations se transmettent les souvenirs et l’histoire avec l’ambition que leurs enfants vivront encore des jours meilleurs. Nous sommes aujourd’hui confrontés à des défis que nos ancêtres n’ont jamais connus : défis climatiques, migratoires, démographiques. Nos aïeux ont-ils vécu plus sereinement les changements
auxquels ils ont dû faire face ?
Probablement non, car changer l’ordre politique établi depuis des siècles, affronter les guerres, mettre fin à l’hégémonie de l’Occident ou encore permettre l’abolition des classes et l’émergence d’une pensée populaire non dénuée d’esprit et de responsabilité, sont des combats gagnés par l’ambition d’une conscience collective empreinte d’humanité.
Pour la FCE-CFDT, cette mémoire doit aujourd’hui nous animer sans jamais oublier d’admettre nos erreurs. Nous devons invoquer la mémoire d’une résistance farouche pour défendre nos valeurs, une recherche permanente de progrès qui profite au peuple. Le progrès, aujourd’hui, c’est l’émancipation des hommes et des femmes. Le progrès, c’est une action déterminée dans un projet qui doit animer toutes et tous : une transition vers un nouveau mode de vivre ensemble, respectueux de notre environnement et attaché à la condition de chaque être humain.