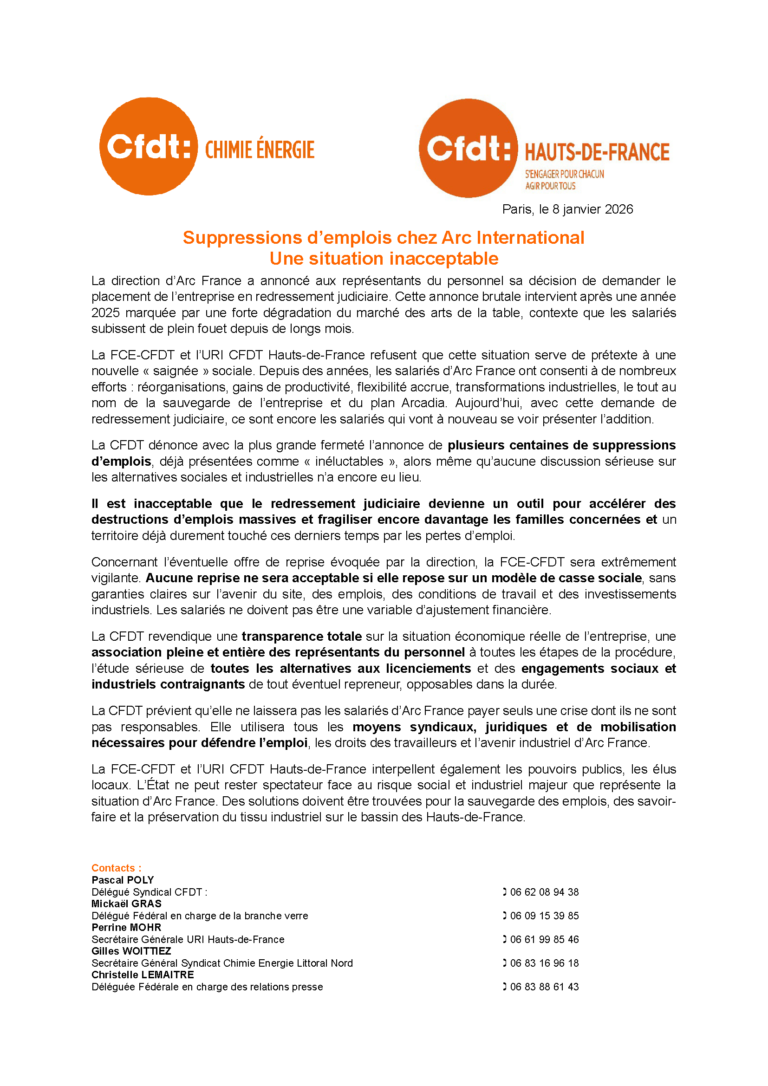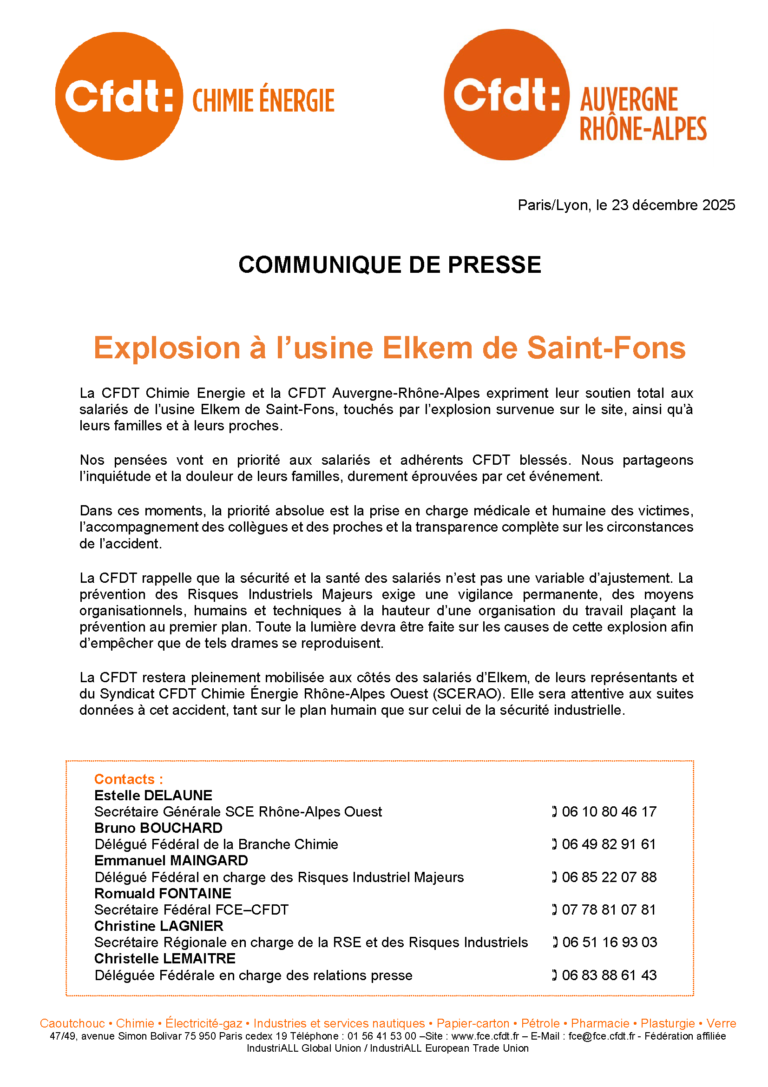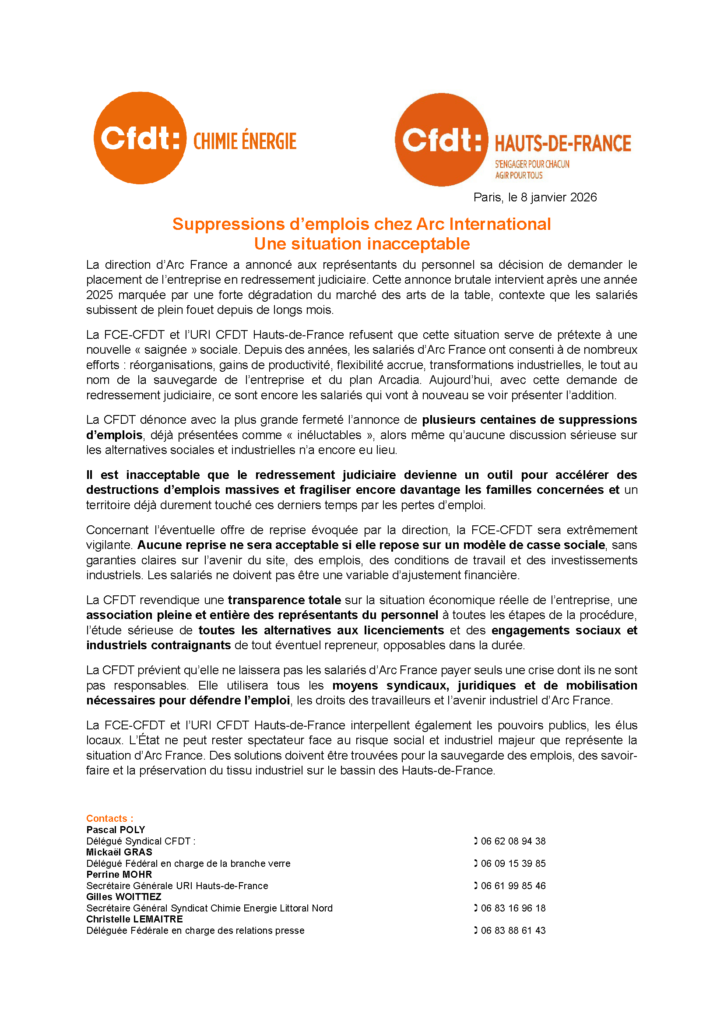Le monde de la Santé couvre un grand nombre d’activités. Parmi elles, le secteur des dispositifs médicaux (DM), assez mal connu, très diversifié, qui regroupe de nombreux produits de nature et de destination très variées, et qui a fait l’objet de scandales sanitaires internationaux, comme celui des implants frauduleux de PIP.
L’Organisation mondiale de la Santé estime à environ 10000 catégories de DM, soit entre 90000 et 1,5 million de produits différents. Selon l’étude « Panorama de la filière industrielle des DM en France en 2017 », du Syndicat national de l’Industrie des Technologies médicales (Snitem), le secteur regroupe 1343 entreprises (85000 emplois), dont 92% sont des PME. Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire français, avec une forte concentration en Île-de-France (+ de 30%) et en Auvergne- Rhône-Alpes (entre 10 et 30%). Les technologies associées aux DM sont issues de secteurs industriels tels que la mécanique, l’électronique, l’informatique, le textile, la métallurgie, la plasturgie… Les entreprises internationales représentent 1/3 des entreprises installées en France, 2/3 du chiffre d’affaires,
et emploient environ 41000 salariés. Cela correspond à près de 50% des emplois totaux du secteur. Le champ syndical de la FCE-CFDT est donc directement concerné, avec une partie des entreprises des branches Plasturgie et Pharmacie, en particulier celles de l’industrie pharmaceutique.
Définition
Un dispositif médical (DM) correspond à « tout instrument, appareil, équipement, matière ou encore produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue aussi un DM, le logiciel destiné par le fabriquant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Les DM qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d’une source d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs » (cf : code de la Santé publique, art. L.5211-1). Cette définition est commune à l’ensemble des états membres de l’Union européenne (UE).
Différentes classes de DM
Il existe quatre catégories selon le risque potentiel pour la santé :
Classe I (risque le plus faible)
Elle comporte :
• des dispositifs non invasifs
• des instruments chirurgicaux réutilisables
• des dispositifs en contact avec une peau lésée utilisés comme barrière mécanique pour la compression ou pour l’absorption des exsudats
Exemples de DM de classe I : les lunettes correctrices, les béquilles, les fauteuils roulants, les scalpels, les bandes de contention, etc…
Classe IIa (risque modéré/mesuré)
• instruments de diagnostic
• dispositifs destinés à conduire ou stocker du sang, des fluides ou des tissus
• dispositifs invasifs de type chirurgical
Exemples de DM de classe IIa : les appareils d’échographie, les appareils auditifs, les couronnes dentaires, les agrafes cutanées, etc.
Classe IIb (risque élevé/important)
• implants chirurgicaux long terme
• dispositifs contraceptifs et de protection contre les MST
• dispositifs médicaux actifs de contrôle ou de monitoring de l’administration dans le corps d’un liquide biologique ou d’une substance potentiellement dangereuse, etc.
Exemples de DM de classe IIb : les sutures internes, les préservatifs, les hémodialyseurs, les pompes à perfusion, etc.
Classe III (risque le plus élevé)
• dispositifs en contact avec le système nerveux central, le cœur, le système sanguin
• dispositifs incluant une substance qui utilisée séparément est considérée comme un médicament
• implants chirurgicaux long terme ou biodégradable
• dispositifs incorporant des produits d’origine animale
Exemples de DM de classe III : les stents coronaires, les implants mammaires, les prothèses de hanche, etc…
Il faut savoir que la classification d’un dispositif médical est de la responsabilité du fabriquant selon la finalité médicale revendiquée du DM. Pour cela, il doit s’appuyer sur les règles de classification établies par la directive DM.
Mise sur le marché d’un DM
Un DM doit respecter des critères de sécurité et de santé pour être mis sur le marché dans l’UE. Ce cadre européen impose aux fabricants, avant la commercialisation, de démontrer la conformité de leurs DM pour pouvoir obtenir, d’un organisme notifié, le marquage CE. L’utilisation des DM ne doit pas compromettre ni l’état clinique des patients, ni la sécurité et la santé des patients et des utilisateurs. Les DM doivent atteindre les performances revendiquées par le fabriquant, et les risques éventuels doivent être acceptables au regard des bénéfices apportés au patient.
Les principaux acteurs du secteur des DM sont :
• Le fabriquant, responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l’étiquetage d’un DM.
• L’organisme notifié (ON), c’est-à-dire un organisme tiers chargé d’évaluer la conformité du DM. Il est désigné par les autorités compétentes des différents pays de l’UE. En France, l’ON est le Laboratoire national de métrologie et d’essais/Groupement pour l’évaluation des DM..
• L’autorité compétente, chargée de surveiller le marché national des DM. Pour la France, il s’agit de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Elle intervient aussi dans la désignation et le contrôle de l’ON français.
• Les utilisateurs sont les professionnels de santé, les patients ou des tiers.
Mesures de suspension ou d’interdiction de mise sur le marché d’un DM
Si un DM ne respecte pas la réglementation en vigueur, ou s’il représente un risque pour la santé, sa mise sur le marché peut être suspendue pour une période donnée, ou interdite de façon définitive par une décision de police prise par l’ANSM.
Surveillance d’un DM
Une fois commercialisé et mis sur le marché, le DM reste sous la responsabilité du fabriquant. L’ON s’assure par des audits périodiques de la conformité du DM, ainsi que de la traçabilité de tous ses composants.
En France, l’ANSM assure la surveillance du marché à plusieurs
niveaux :
wla matériovigilance pour les incidents et risques d’incidents mettant en cause des DM et la réactovigilance pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV)
• le contrôle du marché
• l’inspection des sites de fabrication
• le contrôle du fonctionnement de l’ON français
• le contrôle en laboratoire de la qualité des DM
• le contrôle de la publicité afin d’encadrer la sécurité d’emploi des produits
Nouveau règlement européen pour le DM
La révision de la réglementation européenne sur les DM s’est achevée en 2017 et a abouti à un nouveau règlement spécifique aux DM [UE 2017/745]. Son objectif est de renforcer la coopération entre les autorités compétentes au sein de l’UE et de favoriser une meilleure mise en œuvre des règles adoptées pour ainsi répondre aux enjeux de santé publique. Elle doit permettre le déploiement du nouveau système d’information Eudamed.
Les points marquants du règlement 2017/745 sont :
• le champ d’application est étendu à des dispositifs sans finalité médicale
• des obligations nouvelles sont imposées aux acteurs économiques (fabricants/importateurs)
• les organismes notifiés sont placés sous contrôle européen pour une meilleure harmonisation des pratiques
• la mise en place d’un groupe de coordination des autorités nationales et de nouveaux mécanismes de coopération pour assurer une meilleure régulation du secteur à l’échelon européen
• l’amélioration du dispositif de vigilance avec la mise en place d’une base de données européenne des incidents
• l’encadrement des investigations cliniques converge avec l’encadrement applicable au médicament pour les essais cliniques
• l’évaluation avant mise sur le marché est renforcée
• l’encadrement de certaines pratiques comme la production de DM au sein des établissements de santé ou le retraitement de DM à usage unique
• l’amélioration de la transparence et de la traçabilité
L’action syndicale de la FCE-CFDT dans le secteur des dispositifs médicaux
Suite à l’enquête journalistique internationale « Implants Files », publiée en novembre 2018, l’Assemblée nationale a créé une mission d’information relative aux dispositifs médicaux en France. Cette dernière a notamment auditionné la FCE-CFDT sur l’emploi, la situation économique et sur les problématiques rencontrées par les salariés du secteur. Le rapport final de la mission d’information préconise 36 mesures à plus ou moins long terme.
Pour la FCE-CFDT, il faut engager une réflexion en profondeur sur la transparence, la traçabilité et l’encadrement de tous les dispositifs en tenant compte de la complexité du secteur, la diversité des entreprises, des DM et des utilisations. Il est nécessaire de continuer à répondre aux enjeux de santé publique dans un cadre européen pour garantir un haut niveau de protection de la santé pour les patients et les utilisateurs.
De plus, il ne s’agit pas non plus de jeter l’opprobre sur tous les acteurs du secteur pour quelques fabricants peu scrupuleux. Les salariés sont aussi les premières victimes des scandales que le secteur a pu connaître, et ne sont pas responsables des choix faits par des directions parfois mafieuses.
Pour la FCE-CFDT, ce secteur industriel est en pleine expansion compte tenu des récentes innovations, il est urgent de conserver les compétences et savoir-faire des salariés et d’assurer leur formation. Il faut aussi poursuivre et renforcer les efforts de Recherche et Développement, multiplier des collaborations dans le cadre de partenariats public/privé, et ainsi créer des pôles d’excellence de dimension internationale et des leaders industriels français.
Enfin, la transformation numérique du secteur, avec le déploiement progressif de l’e-santé, va modifier en profondeur la prise en charge de la santé ainsi que les orientations en matière de politique de santé dans les années futures. C’est déjà le cas avec la stratégie de transformation du système de santé (STSS) « Ma santé en 2022 », les programmes « e-Parcours » et « Territoire de soins numérique » et le règlement général sur la protection des données (RGDP).
Pour la FCE-CFDT, la meilleure façon de négocier ce virage technologique est et reste le dialogue social à tous les niveaux, entreprises, territoires et interprofessionnel. La fédération, en lien avec d’autres fédérations, avec l’appui de la Confédération, continuera à formuler des propositions innovantes, notamment dans les comités stratégiques de filière, afin de réfléchir avec les employeurs et les pouvoirs publics à la transformation du secteur, au développement des entreprises et à l’accompagnement indispensable des salariés. •
(Source Ministère des Solidarités et de la Santé)