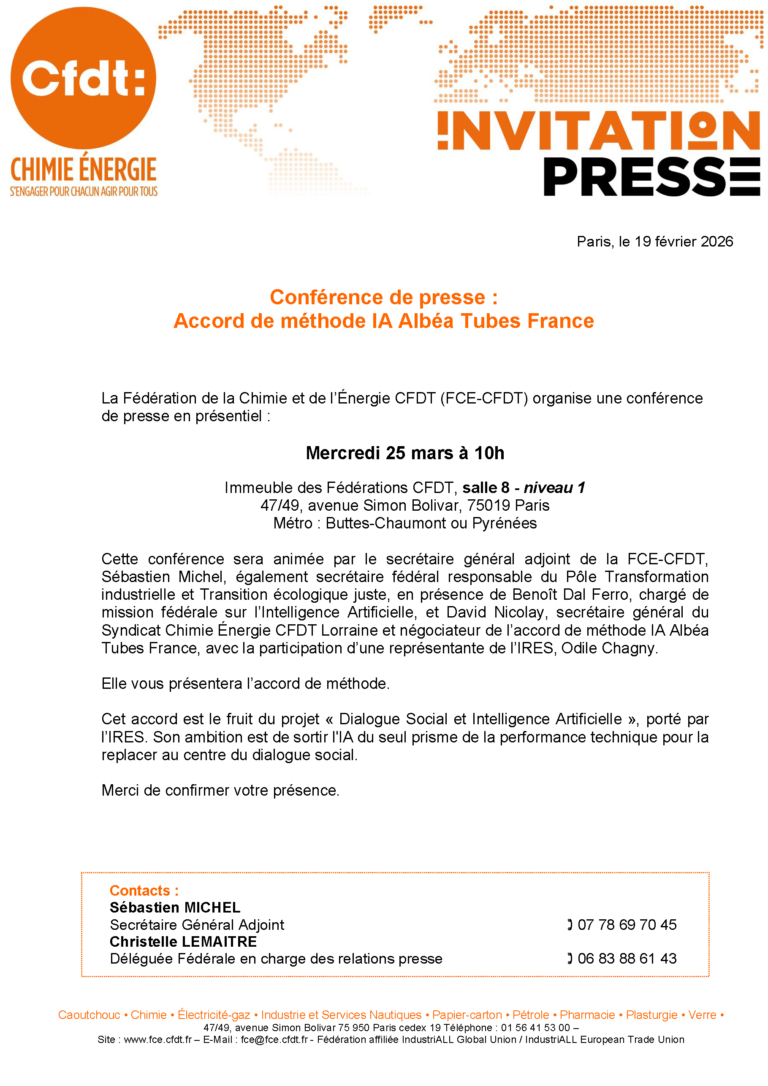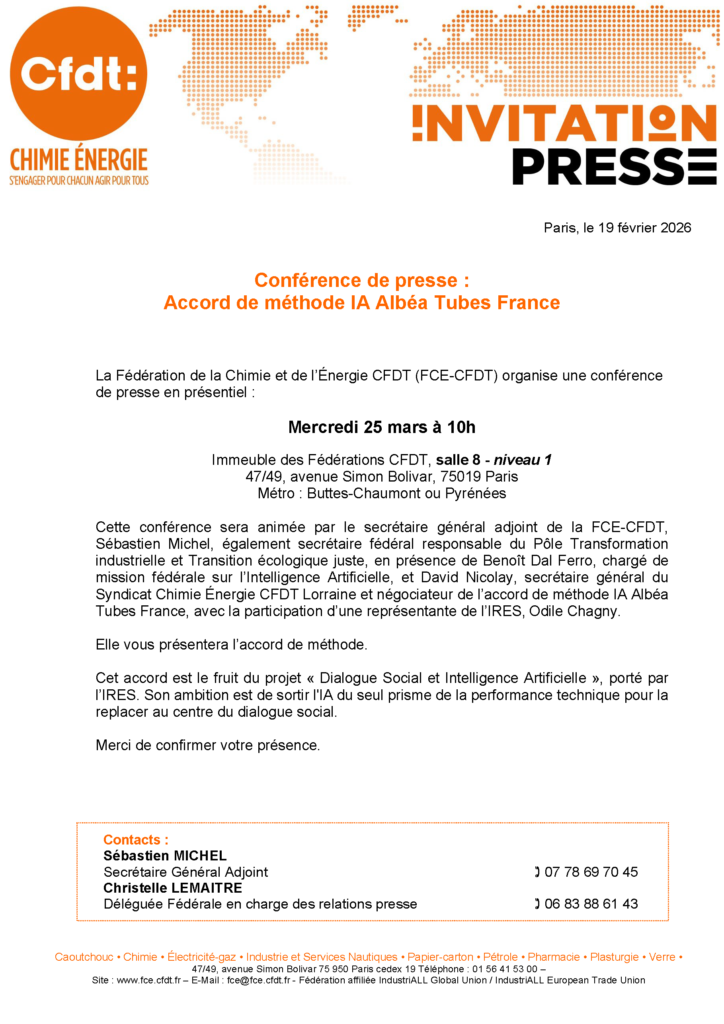1 PREAMBULE
La demande mondiale en énergie va croître de façon importante dans les 20 à 30 prochaines années (certains « experts » prévoient un doublement de la demande entre 1990 et 2020). Cette progression se fera exclusivement, hors zone OCDE, dans les pays en voie de développement et plus particulièrement en Asie.
Le gaz naturel et l’électricité seront les principaux bénéficiaires de cette évolution, la consommation de pétrole progresserait néanmoins de façon importante. Certains pays d’Asie actuellement exportateurs vont devenir importateurs nets de brut.
Trois activités principales constituent l’industrie pétrolière :
×L’exploration-production qui assure la découverte et l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz.
×Le raffinage qui produit les carburants et les bases de la pétrochimie à partir du pétrole brut.
×La distribution qui organise le commerce des différents produits pétroliers : Carburants, lubrifiants, fioul domestique, gaz de pétrole liquéfiés (butane, propane).
Le premier secteur d’activité concentre la richesse des compagnies à partir de la maîtrise de la rente pétrolière partagée avec les pays producteurs. Il est complètement soumis aux règles des marchés financiers internationaux. Les pays producteurs de l’OPEP veulent instituer une certaine stabilité des prix autour de 25 $/baril par un système de régulation de la production. Le résultat reste aléatoire à cause de la grande volatilité des cours du brut dû notamment au volume de Pétrole papier qui influence particulièrement le marché.
En 1998 (hors coûts industriels) au niveau de la planète plus de 2.000 milliards de $ issus du pétrole ont été partagés entre les états producteurs, les états consommateurs et les compagnies pétrolières. C’est en volume, 75 millions de barils par jour ou 3,75 milliards de tonnes par an.
Le partage de cette rente se fait de plus en plus au détriment du second secteur qui est dans une situation de concurrence très forte. Sa rentabilité ne dépend pas de ses coûts mais des marchés du pétrole brut et des produits finis. II peine à financer les investissements nécessaires à sa compétitivité.
Le dernier secteur subit en France et dans certains pays européens de fortes restructurations pour répondre à la concurrence de la grande distribution et aux exigences de la commission européenne en matière de détention de part de marché et déclinaisons des conditions d’environnement et de sécurité.
Quatre dimensions parallèles expliquent aujourd’hui les évolutions et les difficultés de cette industrie :
×La variation aléatoire des cours du brut a conduit la plupart des sociétés majors du secteur à réaliser des méga-fusions pour restaurer le niveau de rentabilité antérieur dans le secteur de l’exploration – production.
×Le désajustement des marchés en Europe par rapport à l’offre de produits, c’est à dire l’écart croissant entre la structure du raffinage et celle de la demande, conduit à « laminer » les marges des entreprises bien que les timides investissements réalisés dans les raffineries parviennent à en limiter les effets.
×L’évolution des normes en matière d’environnement se fait à partir de phases de sensibilisation soudaines à l’occasion desquelles les politiques et les directions d’entreprises prennent des décisions sans stratégie définie à long terme.
×Les différentiels de concurrence en matière de coûts, de fiscalité notamment, privent l’industrie pétrolière française d’une part trop importante de la rente freinant de ce fait le financement des investissements nécessaires, particulièrement dans le raffinage.
Ces quatre dimensions sont liées mais elles ne sont pas gérées de manière cohérente. Les multiples acteurs (compagnies pétrolières, pouvoirs publics, circuits de distribution) interviennent avec des logiques propres et sur des niveaux différents. Cette incohérence globale est, à moyen terme, une menace pour l’industrie du raffinage européenne.
La FCE-CFDT affirme que l’emploi et les coûts salariaux servent de boucs émissaires aux difficultés de l’industrie pétrolière. Les plans de suppression d’emploi n’agissent pas sur les vraies causes, démotivent les équipes et ne font que servir l’amélioration de la rémunération des actionnaires à cours terme.
Après le rappel de la place occupée par L’industrie Pétrolière sur la scène politique et diplomatique, cette note examine les quatre dimensions qui viennent d’être rappelées. Elle précise les évolutions sur lesquelles les différents acteurs doivent intervenir de manière plus concertée. A la logique du tout libéral, de la concurrence sans entrave, nous proposons d’engager des dynamiques de coopération entre les acteurs concernés afin de maintenir une industrie pétrolière compétitive dans les différents pays européens prenant en compte la dimension développement durable.
2 UNE INDUSTRIE AU COEUR DES CONFLITS
ET DU CAPITALISME INTERNATIONAL
L’importance du secteur énergétique dans un pays et la masse de capitaux que l’industrie pétrolière mobilise, placent cette activité industrielle au cœur des enjeux de pouvoir à l’échelle nationale et internationale.
Le pétrole est au cœur des conflits dans le monde et des circuits de financement liés aux politiques d’influence des états.
Qu’il s’agisse de conflits au Moyen Orient, des tensions entre les pays et nationalités de l’ancienne Union soviétique ou de la maîtrise du développement économique du continent asiatique, le pétrole est à l’origine de nombre de conflits qui se déroulent sur l’ensemble de la planète.
2.1 La maîtrise de la manne énergétique
La maîtrise de l’énergie est un enjeu majeur pour l’indépendance des nations, pour leur développement économique. Le pétrole reste une des énergies les plus consommées et les plus faciles à utiliser.
Les craintes vis-à-vis de son indépendance énergétique et la volonté d’hégémonie des Etats Unis sur la scène mondiale et leur volonté de jouer, pour leur propre compte, le rôle de gendarme du monde les conduit à rechercher la maîtrise politique et militaire des principales zones d’exploration et d’extraction pétrolière.
Ils sont omniprésents au Moyen Orient et ont mené la guerre du Golfe pour garder cette maîtrise. Ils continuent d’empêcher l’Irak de venir déséquilibrer le cartel des pays producteurs organisés par l’Arabie Saoudite pour le compte des Etats Unis.
Sur le continent africain, les Américains sont arrivés ces dernières années et commencent à réduire l’influence de la France. Exxon et Shell sont intervenus dans les pays délaissés par le groupe Elf et/ou déçus par la diplomatie française.
En Asie, des campagnes de boycott sont menées contre tous les investisseurs (notamment TotalFinaElf) qui ne font pas partie des entreprises maîtrisées par les Américains. Cette zone en fort développement économique a des besoins particuliers dans le domaine de l’énergie.
En plaçant les questions pétrolières sous leur domination, les Etats Unis se donnent les moyens d’étendre leur influence géopolitique aux cinq continents.
Ce faisant, ils préservent leurs propres réserves pétrolières, en utilisant celles des autres…
Enfin, ils se donnent les moyens de peser sur les prix du pétrole brut et donc sur le partage de la rente pétrolière entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Ils sont indirectement en mesure d’agir sur les rythmes de croissance économique dans les différentes zones du globe.
Les pays européens ont commencé à réagir en réinvestissant en Afrique ou au Moyen Orient comme TotalFinaElf en Iran récemment.Comme syndicalistes CFDT, nous avons à revendiquer un nouveau partage du pouvoir à l’échelle mondiale, de façon à ce que les États, dans le cadre éventuel d’organisations continentales, aient leur mot à dire et que leurs institutions démocratiques, quand elles existent, puissent associer réellement leurs citoyens aux décisions qui les concernent.
L’évolution de la scène pétrolière mondiale et la mainmise des États Unis sur ces questions concourent à l’affaiblissement des démocraties représentatives.
Des masses financières considérables
et des enjeux diplomatiques aux mains d’intérêts privés.
Les capitaux investis dans l’exploration pétrolière et dans le raffinage-distribution sont considérables. Cela a plusieurs conséquences.
La première est que pour répondre à leurs besoins de financement les compagnies pétrolières ont été privatisées à travers le monde entier. Elles sont les sociétés qui ont bénéficié de façon privilégiée des investissements des fonds de pension anglo-saxons.
En retour, ces fonds de pension font désormais peser sur ces mêmes compagnies pétrolières des logiques financières destinées à assurer aux actionnaires la meilleure rémunération possible.
Par conséquent, les compagnies pétrolières sont passées sous la coupe d’actionnaires qui n’ont pas de légitimité démocratique, ni d’orientation stratégique affirmée alors qu’elles interviennent dans une activité industrielle stratégique pour les différentes nations de la planète et qui touche à la diplomatie et aux zones d’influence des grandes puissances. (Elles développent leurs propre politique parfois au-delà du périmètre économique et industriel notamment les Groupes originaires des USA).
Il faut ajouter à cela la masse très importante de pétrole papier : pour un besoin physique de 130 milliards de $ on constate des transactions 10 fois supérieures. Cette spéculation contribue au manque de lisibilité, voire à l’opacité du marché !
Cette opacité et ce manque de transparence sert les intérêts des réseaux d’influence qui doivent se maintenir ou se construire en dehors de toute représentation nationale transparente.
Cet état de fait est encore aggravé par le fait que les zones de développement de l’industrie pétrolière sont situées dans les pays en voie de développement, pour lesquels la production de produits pétroliers est, soit une ressource vitale d’exportation et de financement, soit un point crucial dans leur politique de développement économique.
Ainsi, des compagnies pétrolières, en apparence détachées de toute attache nationale et de tout objectif diplomatique, interviennent dans des zones d’influence instables et entrent en concurrence avec les politiques des états.
A quel titre et avec quels objectifs TotalFina Elf opère-t-il en Birmanie ? A quel titre et avec quels objectifs débattus démocratiquement les profits réalisés et les réseaux de relations établis par Elf doivent-ils servir à faciliter la vente de frégates à Taiwan ou à payer les salaires de fonctionnaires africains ?
L’histoire du capitalisme est ainsi faite de la maîtrise de certains marchés et de certaines activités à travers les continents pour le pouvoir de quelques-uns.
La FCE CFDT s’interroge sur la légitimité des investissements faits par l’industrie pétrolière dans les différents continents et sur les objectifs poursuivis. La rentabilité des fonds propres ne peut servir de seule justification. La démocratie qui prévaut dans notre pays et les valeurs portées par notre syndicalisme exigent d’autres réponses.
Nous avons à mettre en débat ces objectifs afin d’assurer notre vocation à développer la démocratie et trouver une parade à la déconnexion qui s’est établie entre les états et les compagnies pétrolières. Cela se fera plus facilement à l’échelle européenne.
Dans ce domaine, les contacts directs avec les militants syndicaux des pays concernés peuvent permettre de développer le syndicalisme et la démocratie. C’est un objectif prioritaire pour nous si nous voulons peser sur les objectifs et les résultats concrets des compagnies pétrolières.
Obtenir des accords d’engagements éthiques entre les compagnies pétrolières et les fédérations syndicales ira dans le sens d’une clarification des investissements et un affichage d’une réelle volonté de transparence. Ce serait aussi un pas pour atteindre l’objectif de développement durable porté par la FCE CFDT.
3 EXPLORATION-PRODUCTION LE CONTEXTE
INTERNATIONAL : LA VARIABILITE DES COURS DU BRUT
Les progrès techniques ont réduit les coûts de l’exploration / production qui est passée de 20 $ en 1981 à 8 $ par baril en 1998. Ils permettent aux champs pétroliers offshore (en Mer du Nord, par exemple) d’être compétitifs par rapport aux zones d’extraction à faibles coûts du Moyen Orient, à la fois lors de la baisse des cours du brut (entre 8 et 15 $ /baril) et lors des fortes hausses (25 à 35 $ /baril en 2 000).
Réserves
Réserves prouvées :
×140 milliards de tonnes pour le pétrole brut, soit 42 ans de réserves au rythme de production actuel),
×158 000 milliards de m3 pour le gaz soit 60 ans de réserves de gaz au rythme de production actuel),
Depuis le choc pétrolier de 1973, les pays les plus riches et les compagnies pétrolières ont poursuivi une politique d’exploration, de développement de leurs réserves et de mise en service de gisements dans de nouvelles zones, notamment en Mer du Nord.
Les prix atteints par le brut ont permis de financer la mise en oeuvre de nouvelles technologies et l’exploitation de gisements dont le coût de production était plus élevé. Cette politique des sociétés pétrolières a permis de retrouver une diversité d’offre de brut plus importante.
La production des pays membres de l’OPEP est stable alors qu’ils détiennent les 3/4 des réserves prouvées du monde ( les 6 pays du golfe : Iran, Irak, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït et les Etats Arabes Unis en détiennent les 2/3).
La production actuelle de la Russie est faible par rapport à son potentiel. La progression de la demande mondiale est surtout couverte par les pays non-OPEP. Cette situation est susceptible de perdurer avant un retour des opérateurs vers l’OPEP (en contradiction avec les prévisions des experts qui estimaient que seul le Moyen Orient pouvait faire face à une forte progression de la demande en brut).
Les compagnies pétrolières ont utilisé cette diversité d’approvisionnement retrouvée pour établir, par une nouvelle politique de contrats, davantage à court terme, un partage de la rente plus favorable. L’analyse des contrats passés entre les compagnies et les états témoigne de cette recherche de rentabilité des investissements.
Aujourd’hui, le coût exploration / production s’élève à 8 dollars par baril en moyenne avec cependant des écarts importants entre le Moyen-Orient (1$-5$) et le reste du monde (5$-10$). On mesure ainsi la masse financière importante que se distribuent les compagnies, même dans un contexte fortement perturbé des prix du brut. II faut toutefois pondérer cela en fonction de la zone géographique et ne pas oublier que la marge dégagée par rapport au prix du brut est à partager à 80 % pour les états et à 20 % pour les sociétés pétrolières.
Cette politique conduite sur deux à trois décennies avait rendu l’offre plus abondante que la demande entraînant une chute des prix du brut à 10 $ le baril en 1998. La volonté des groupes pétroliers étant d’être de plus en plus indépendant possible des prix du brut ont restructuré la filière pour diminuer les coûts et accroître la rentabilité de la filière. La remontée des cours en 2000, a permis aux compagnies de bénéficier à plein de ces restructurations et leur apporte des capacités supplémentaires pour poursuivre leur adaptation à leur vision du futur.
D’autant qu’un mouvement international de privatisation s’est développé depuis quinze ans et a placé une grande partie des compagnies pétrolières sous la coupe des financiers et des actionnaires qui réclament une amélioration continue de la rentabilité des investissements.
Cette volonté d’améliorer la rentabilité explique le récent mouvement de fusion, absorption et restructuration du secteur pétrolier. Les fusions EXXON MOBIL, BP AMOCO TOTALFINAELF, cherchent toutes à abaisser les coûts fixes d’exploration – production et de recherche.
La réduction des coûts (démarré en 1986) fondée essentiellement sur des restructurations, sur les améliorations technologiques et sur le développement de la sous-traitance, atteint ses limites.
II faut désormais des ensembles plus grands pour pouvoir continuer de rationaliser mais aussi pour constituer de nouveaux pouvoirs financiers. Les petits sont condamnés à perdre leur indépendance ou à disparaître.
Cette vague de méga fusions s’auto alimente puisque les premières opérations en déclenchent de nouvelles, plus défensives dans leur conception pour éviter d’être mangé par plus gros que soi. C’est le cas de l’opération TOTAL avec PETROFINA puis Elf Aquitaine.
Ces méga fusions peuvent accélérer la restructuration du raffinage et des activités en aval (distribution, pétrochimie), par la revente immédiate de certains actifs. Ainsi, les alliances conçues pour rentabiliser l’exploration – production vont conduire à la mise en vente d’actifs sur l’aval, comme par exemple la mise en vente d’une partie des activités de raffinage-distribution de TotalFina Elf aux États-Unis.
La tendance actuelle aux Etats Unis de désengagement des compagnies pétrolières dans l’aval et notamment dans le raffinage a entraîné la naissance de sociétés spécialisées dans le raffinage. Pour beaucoup d’entre elles, leur taille est insuffisante pour assurer les investissements de modernisation liés aux contraintes environnementales ce qui ne manquera pas de poser problème à terme pour l’approvisionnement de produits raffinés aux normes.
Réduction des budgets à tout va
Dans ce contexte, la course à la réduction des coûts s’est accélérée dans le domaine de l’exploration production, qu’il s’agisse de financer des acquisitions ou qu’il s’agisse de se protéger d’une OPA hostile.
Les compagnies ont réduit leur budget de recherche de nouveaux gisements. Des plates-formes pétrolières sont fermées ou menacées de fermeture en Mer du Nord. Elf Aquitaine avait engagé un plan de réduction des coûts sur les établissements de Pau et Paris qui se poursuit après la fusion avec TotalFina.
Des questions analogues sont posées quant aux investissements dans certains pays : BP en Colombie, TOTALFINA ELF en Birmanie ou SHELL au Nigeria. A noter que toutes les compagnies ne sont pas logées à la même enseigne, les compagnies les plus importantes étant favorisées par rapport aux pétroliers indépendants.
De nouvelles relations entre pays producteurs
et compagnies pétrolières :
A moyen terme, les déterminants économiques et géopolitiques feront varier les prix du brut de façon aléatoire. Faute de régulation, les ajustements se feront de façon erratique et par à coups forts, l’exemple de fin 1999 et début 2000 est là pour le démontrer.
La stratégie des acteurs restera donc calée sur le court terme.
Dans cette hypothèse, il y aura certainement une diversification des acteurs qui va conduire :
×Une modification et une segmentation de la concurrence en trois catégories par taille (les grands majors, les compagnies régionales internationales et les petits indépendants).
×Un développement des coopérations entre les pays producteurs et les compagnies pétrolières les plus importantes.
Car la variabilité des cours du brut va accélérer l’ouverture des pays producteurs (Algérie ou Chine) au marché, en élargissant de fait les possibilités de développement pour les nouveaux groupes pétroliers qui viennent de se constituer. Cette évolution décidera des budgets d’investissements industriels.
Quelles que soient les évolutions, le paysage a changé. II nous appartient de considérer la situation dans son ensemble dans un cadre qui ne peut plus être hexagonal, ni même européen. Qu’on le veuille ou non, l’industrie pétrolière est complètement soumise aux règles des marchés financiers internationaux. Cela exige que le syndicalisme en maîtrise les règles pour adapter sa stratégie et ses revendications et éviter que les questions sociales soient exclues de toutes les réflexions.
Le gaz naturel : une énergie requalifiée
Le gaz naturel a longtemps été considéré comme une ressource fatale : pour le produire, il faut des débouchés commerciaux de proximité ou des investissements lourds de liquéfaction et de transport.
Les ressources colossales de gaz et les contraintes environnementales (normes et réchauffement planètes) amènent un changement net de politique et certaines fusions n’ont pas d’autres buts que d’augmenter sa part dans la production et les réserves des groupes pétroliers. Il en résulte une recherche de débouchés et de nombreux projets d’exploration et de mise en production de gisement (Nigéria, Iran, par exemple).
Par son abondance et ses avantages en terme de d’environnement, le gaz prendra une part grandissante dans une économie où le développement durable prendra une grande importance.
Par ailleurs, l’ouverture du marché de l’électricité en Europe et les progrès technologiques permettront le développement de la cogénération.
La CFDT se félicite de cette évolution vers un accroissement de l’utilisation du gaz naturel et accentuera son action en faveur d’un développement durable dans le domaine de l’énergie.
Dans cette activité exploration-production, la FCE CFDT revendique le maintien des efforts de recherche de nouveaux gisements, le réinvestissement des richesses produites dans le développement de nouvelles techniques d’exploitation et de forage et dans le développement de l’utilisation du gaz naturel.
Nous agissons en lien avec les organisations syndicales d’autres pays dans d’autres continents pour que les sociétés pétrolières françaises appliquent les mêmes droits sociaux à l’ensemble des pays où elles opèrent.
En ce sens, la FCE CFDT agira auprès du groupe TFE pour construire un accord éthique s’inscrivant dans le cadre des orientations de l’EMCEF décidées à son dernier congrès à Blankenberge et confirmer à l’assemblée générale des 3 et 4 mai 2001 à Berlin.
4 RAFFINAGE: DÉSAJUSTEMENT ENTRE LA DEMANDE
ET L’OUTIL INDUSTRIEL
La progression de la consommation en Asie a absorbé les surplus importants de la production des pays du Moyen Orient. Cette zone mobilise une part croissante des investissements des compagnies pétrolières. Les nombreux projets de construction de raffineries dans cette zone sont susceptibles de modifier à terme l’équilibre actuel en matière de produits finis, sauf si la progression de la consommation est supérieure à la mise en service des capacités de production.
Les capacités de raffinage des ex-Pays de l’Est représentent un risque de délocalisation important pour l’industrie ouest-européenne, sous réserve de financements internationaux pour leur remise en état.
Les USA ont profité de la mise en place d’essences reformulées, pour adopter des mesures imposant des spécifications très strictes pour les carburants importés, et prévu une obligation d’incorporation de composés oxygénés extraits de sources renouvelables ( produits agricoles ). Cependant, cette politique a rendu plus obsolète l’appareil de raffinage américain qui n’a pas évolué au rythme des normes. Sa remise aux normes ne pourra être immédiate, ce qui encourage un courant d’importation d’essences provenant du marché européen.
Situation européenne du raffinage
Les capacités de distillations ont été fortement réduites ces 20 dernières années (de -17 % pour l’Espagne à -50 % pour la France : 171 MT en 1977, 84,6 MT en 1989 et 99 MT en 2000). La capacité de craquage augmente. La performance des opérations s’est améliorée mais reste insuffisante en Italie, en Allemagne et en Espagne.
Le taux d’utilisation actuel des raffineries est proche de 90 % alors qu’il avoisinait les 60 % en 1983. Depuis 1986, il n’ya pas eu de fermeture de site, quelques groupes ont vendu des raffineries (en général à des pays producteurs : Libye, Koweït, etc.). Aujourd’hui elles fonctionnent quasiment à pleine capacité, sans avoir modifié le marché.
Ce n’est que récemment que l’apparition de surcapacités en essences a conduit certaines compagnies à fermer quelques raffineries en Europe. II faut toutefois noter qu’il y a eu beaucoup plus d’annonces que de fermetures effectives.
Car le concept de surcapacités européennes n’est pas véritablement avéré. Il relève davantage du discours que de la réalité économique. La profession ne parle d’ailleurs plus de ces sur capacités.
La surcapacité constatée n’est pas comparable à celle du début des années 1980 car elle ne correspond pas à une surcapacité globale mais à des surcapacités partielles par pays et par produits.
La situation entre les différents pays est contrastée, certains possèdent des surcapacités de raffinage notoires ( Royaume Unis ; Italie ) quand d’autres sont sous capacitaires pour certaines coupes, comme c’est le cas pour la France.
Par contre un risque de surcapacité en essences est réel en Europe, mais son évaluation est difficile ( elle varie de 30 à 60 millions de tonnes selon les experts ) et reste faible en regard du volume global. Cet excédent se justifie si l’on tient compte d’inévitables à-coups conjoncturels qui ne doivent pas mettre en cause notre sécurité d’approvisionnement.
Quatre raisons au moins expliquent l’apparition de cette surcapacité en essences :
×Le Gazole. Des investissements et constructions d’unités à contre temps pour fabriquer l’octane nécessaire au remplacement de l’essence sans plomb et la fabrication de carburants à 98 d’indice d’octane (Eurosuper ou Superplus). Ces investissements étaient nécessaires pour maintenir le volume de production d’essences alors que la consommation chutait régulièrement (En France : 18,8 MT en 1988 – 13,8 MT en 2000) au profit du gasoil.
×La forte augmentation de la production de brut en Mer du Nord accroît la tendance à la surproduction d’essences puisqu’elle est surtout constituée de bruts légers et qu’elle incite les compagnies pétrolières à maintenir le taux de raffinage et la production d’essences à un niveau élevé pour écouler cette production.
×Au-delà des problèmes de différentiel de taxation particulier à certains pays, le parc automobile Européen se diésélise.
×Enfin, les constructeurs automobiles (notamment allemands) sont offensifs en matière de recherche pour réduire la consommation des moteurs en carburants.
Face à ce risque d’excédents en essences, la FCE-CFDT souligne que la fermeture de raffineries ne résout en rien la question puisque la surcapacité n’est pas globale. Elle estime que sur ce point, les discours patronaux ne sont pas crédibles.
Certes, il est plus coûteux de fermer une raffinerie que de la faire travailler à l’équilibre. Cela peut en protéger certaines. Mais surtout, un pétrolier n’a pas intérêt à fermer seul, car il supporte entièrement le coût d’une fermeture, alors qu’il remet à ses concurrents les parts de marché qu’il possède.
Force est de constater que les sociétés pétrolières, tout en tenant le discours sur les surcapacités de l’appareil de raffinage, n’ont de cesse de rationaliser leur outil et d’augmenter leurs capacités de production.
En outre, le discours sur les surcapacités en Europe considère l’Europe comme une zone imperméable. Au contraire, au regard des exportations vers les USA et en tenant compte des importations possibles du Moyen Orient, il faut considérer l’Europe comme une zone perméable.
Selon la FCE-CFDT, il existe un excédent de 18 MT en Europe, qui en exporte près de 7 MT, notamment aux Etats Unis. La zone Est des Etats Unis est déficitaire et près de 40 % des produits sont importés. Près d’un tiers de la production anglaise est destinée aux Etats Unis. Cette situation va perdurer et même s’amplifier à l’avenir.
Car l’évolution des normes environnementales et des spécifications des produits suppose des moyens financiers trop importants, pour une mise aux normes du raffinage américain, aux normes de 2004. L’analyse est la même pour le Canada, le Venezuela et les Iles Vierges.
Ainsi, pour la zone Europe/OCDE, il n’y a pas de surcapacité globale de raffinage et la balance commerciale est équilibrée.
Le problème posé n’est donc pas celui de surcapacités en Europe, mais de compétitivité. Cela engendre nécessairement une logique de réduction des coûts qui doit être maîtrisée.
Par contre, l’offre n’est pas adaptée à la baisse tendancielle de la demande en essences. II faut donc investir dans des unités de conversion et d’hydrocraquage pour produire davantage de gazole. II s’agit à la fois, de renforcer la compétitivité de l’outil européen face aux importations futures du Moyen Orient et d’assurer une rentabilité suffisante.
Ce qui pose la question du financement des investissements dans une industrie dont les marges sont souvent faibles, voire insuffisantes. Nous sommes rentrés dans une période de meilleure rentabilité. Ce report des investissements n’est plus justifié à nos yeux (si tant est qu’il l’ait été par le passé). La récente décision de TotalFina Elf de construire une unité de cogénération sur son site de Gonfreville laisse le choix entier entre plusieurs solutions pour éliminer les coupes lourdes.
Toutefois, depuis toujours les compagnies pétrolières acceptent de limiter leur taux de profit dans le raffinage pour rester présentes dans la filière pétrolière. Dans cette industrie le montant des immobilisations est très important, mais les décisions sont stratégiques.
Mais il n’est pas sûr que cette position n’évolue pas rapidement. Déjà certains groupes se désengagent de la distribution notamment dans le chauffage comme BP qui vend sa filiale BP Fioul Services.
Sur ce sujet, nous devons nous battre pour faire valoir que le raffinage distribution n’est pas une activité industrielle comme un autre. C’est une industrie stratégique pour les différents pays de l’Union Européenne. Sa rentabilité ne doit pas être dissociée de celle de l’exploration-production qui reste fortement lucrative. Sinon, ce sont l’emploi et les salariés qui en pâtiront.
Ce qui pêche aujourd’hui, c’est le manque de visibilité stratégique nécessaire pour décider des investissements à long terme pour le raffinage, par exemple sur les choix des différents pays entre le gazole et l’essence et des politiques publiques qu’ils impulsent dans le secteur des transports ou des constructeurs automobiles.
Le manque de coopération entre les différents acteurs pétroliers qui développent des stratégies différentes en fonction de leur implantation géographique (régionale, nationale, continentale ou mondiale) pénalise aussi l’ensemble de la profession.
Cette bataille idéologique autour des prétendues surcapacités du raffinage européen est essentielle pour l’emploi dans le secteur pétrolier en Europe. Des investissements qui seront réalisés dans les années qui viennent dépendent le niveau de l’emploi dans la branche.
Situation française du raffinage
Les problèmes du raffinage européen exercent de fortes pressions sur le raffinage français depuis que les marchés ont été libéralisés à la demande des compagnies pétrolières ; mais le marché français est globalement en sous capacité.
Par contre, des aspects spécifiques à la situation française aggravent le décalage entre la structure de la demande et celle de l’outil de raffinage et favorise les excédents d’essences.
Le différentiel élevé de taxes entre les différents produits, favorise le gazole au détriment des essences et renforce une demande en carburants pour laquelle l’outil de raffinage français n’est pas adapté. La production d’essences est excédentaire (de 3 millions de tonnes ) alors que nous importons pour satisfaire la demande en gazole (environ 8 millions de tonnes). La construction d’unités de fabrication d’ETBE (aidée fiscalement) augmente le phénomène de surproduction d’essences.
La politique menée par ailleurs par les constructeurs automobiles en faveur des moteurs diesels a aggravé la situation.
Le manque de débouchés pour le fioul lourd (quasi-absence de système de cogénération) renforce l’attrait pour l’utilisation de bruts « légers » qui favorise la production d’essences déjà excédentaire.
Ces aspects sont aggravés par la concurrence de la grande distribution qui peut importer de Rotterdam les produits au meilleur prix et empêche toute régulation du marché au niveau national. Pour reconquérir des parts de marché, les pétroliers français se sont engagés dans une politique produits en matière d’essences (essences sans plomb, essences propres,…) mais cela n’a pas suffit à enrayer la progression des GMS qui représentent en 2000 plus de 55 % du marché des carburants.
En matière de raffinage, la FCE-CFDT récuse depuis longtemps avec raison le discours des sociétés pétrolières sur les surcapacités.
Elle réclame aux pouvoirs publics français et européens, la définition d’une politique industrielle cohérente en matière de carburants permettant aux industriels de décider des investissements adaptés.
Elle revendique dès maintenant des investissements de production de gazole de façon à réduire l’écart entre l’offre des produits et la demande des consommateurs, condition essentielle de la compétitivité de cette industrie et de la pérennité des emplois qu’elle représente.
Elle revendique les investissements nécessaires à la mise aux normes pour des carburants moins polluants, afin que l’outil de raffinage français, et au-delà européen entre dans l’ère du développement durable.
5 L’ENVIRONNEMENT
Situation internationale
Les problèmes d’environnement n’ont que peu de poids dans les décisions des gouvernements des pays en voie de développement.
L’innovation dans le secteur de l’énergie (implantation et diffusion de nouvelles technologies) ne peut pas reposer sur la seule logique du marché (orienté vers le cours terme), ni sur le tout état qui a d’abord un rôle de régulateur et d’arbitre dans l’élaboration des stratégies à long terme.
II est de la responsabilité de la profession pétrolière de se fixer des objectifs et des priorités en matière d’environnement afin d’assurer la compétitivité des énergies fossiles par rapport à d’autres sources d’énergie.
Trop souvent les décisions en matière d’environnement sont uniquement prises en fonction de stratégies de conquête ou de protection de certains marchés.
Cela a été récemment le cas pour les essences reformulées aux USA. Cependant, les essences reformulées aux Etats-Unis ont introduit de nouvelles normes qui sont destinées à se développer en Europe sous la pression de l’opinion publique, particulièrement éduquée dans les pays nordiques.
En europe
Les rejets nocifs des unités de raffinage ont beaucoup diminué depuis une dizaine d’années. Les carburants, la technologie des moteurs ont également fait des progrès considérables, mais la croissance des transports a atténué ces améliorations et des évolutions importantes restent à faire dans ce domaine. Les mesures à prendre ne doivent pas provoquer de délocalisations.
En Europe, la France est un des pays ou les efforts en matière d’environnement dans le secteur de l’énergie pétrolière sont les plus faibles, l’Allemagne et les Pays Nordiques notamment sont en avance sur nous dans ce domaine. La vente de fiouls haute teneur en souffre est pénalisée voir interdite dans certains d’entre eux.
A titre d’exemple
Avec un an d’avance les raffineurs distributeurs allemands ont mis sur le marché un gazole à 0.05 % de soufre (contre 0.2 % en France). Les 2 plus grands distributeurs ont lancé un super plus contenant moins de 1 % de benzène (pour une norme de 5 %).
L’incorporation de biocarburants (carburants « verts »), qui améliorerait la qualité des rejets (oxygénation) ne devrait se faire qu’après bilans, énergétiques, écologiques, économiques et industriels.
Le Gaz de Pétrole Liquéfié (G.P.L.) est actuellement le carburant issu du pétrole le moins néfaste pour l’environnement, sa consommation pourrait progresser dans les flottes captives mais il porte une image négative sur la sécurité liée au risque d’explosion, à l’interdiction d’accès des parkings et tunnels. Aujourd’hui, les pouvoirs publics et les compagnies n’affichent pas de réelles volonté de rectifier cette mauvaise image.
Dans ce cadre, la question de nouvelles normes environnementales est posée.
Les nouvelles normes environnementales européennes
La commission européenne a engagé conformément aux objectifs fixés des programmes visant à l’amélioration de l’environnement. Auto Oïl 1 et 2 ont pour but la définition de nouvelles spécifications des produits pour 2000 et 2005. En ce sens la commission a estimé le coût de la mise en oeuvre de ces directives pour les industriels. De plus la charte mondiale sur les carburants ( la teneur en soufre est en ligne de mire) et l’ACEA (automobile) ont pour objectif la mise en conformité et le respect des décisions mondiales.
Pour la FCE-CFDT, il est clair que l’approche coûts des investissements / avantages pour l’environnement doit guider les décisions prises par les Etats membres. II n’est pas possible de justifier des investissements très coûteux qui n’apportent qu’une faible réduction de la pollution. Cependant, les nouvelles normes sont susceptibles de renforcer la compétitivité de l’industrie du raffinage.
Les nouvelles normes en Europe ne seront pas aussi contraignantes que ce qui a été dit. Car le coût énoncé n’intègre pas les évolutions technologiques (par exemple sur les catalyseurs). Les adaptations nécessaires seront utilisées comme outil de rationalisation dont on ne connaît pas l’ampleur. Sans compter que se rajoute un effet de concurrence dans l’application des normes comme avantage concurrentiel.
Le débat sur les coûts est également faussé par l’attitude des groupes pétroliers qui les surestiment très fortement pour mener des actions de lobbying néfastes au débat. Il serait plus judicieux de négocier un calendrier d’application que de crier à l’effondrement de l’industrie du raffinage !
La CFDT propose donc d’adopter vis-à-vis des questions d’environnement une attitude plus positive et plus offensive. Plus positive en présidant aux évolutions souhaitables pour l’avenir de l’industrie pétrolière et en intégrant la donnée environnementale dans leurs décisions concernant la fiscalité. Plus offensive en en faisant un élément de politique industrielle et de régulation des marchés pétroliers.
6 FISCALITE, INVESTISSEMENTS, EMPLOI :
QUEL PARTAGE DE LA RENTE ?
L’industrie pétrolière est une industrie hautement spéculative et dont la rentabilité dépend essentiellement des marchés. Les marges sont aussi très différentes d’un secteur à l’autre au sein même de l’activité pétrolière, entre l’exploration-production très rentable, le raffinage qui l’est en moyenne beaucoup moins et la distribution dont la rentabilité varie suivant les produits.
La fiscalité et les coûts de production interviennent, mais à la marge, dans chacun des secteurs concernés.
Exploration / production
Comme tout pays producteur, l’état français et les collectivités locales prélèvent des taxes sur les bruts extraits.
En matière d’extraction de brut, le domaine minier français est secondaire.
Selon la Dhyca, les revenus des pays producteurs sont les suivants :
×zones prolifiques : 10 $ par Bep (pays de l’Opep).
×zones difficiles ou anciennes : 2$ par Bep (USA, Australie, Europe de l’Ouest).
×autres : 5 à 7 $ par Bep (Asie du Sud Est, Afrique Occidentale).
Dans les zones d’exploration comparables à la France, les prélèvements moyens correspondent à 67-72 % de la production, contre 52 % en France.
Raffinage : les marges ne dépendent pas de la productivité
Les prix (donc les marges) sont d’abord déterminés par les cours internationaux indépendamment des coûts de production. Les gains de productivité et la réduction des coûts sur les installations permettent d’améliorer les comptes des sociétés (l’excédent brut d’exploitation) et la performance des sites mais ils ne sont pas susceptibles d’influencer les marges.
Les marges de raffinage sont globalement faibles dans le monde et ne permettent pas de financer les investissements. Le raffinage est un secteur par nature déficitaire. Malgré les discours officiels, les compagnies pétrolières ne gèrent pas l’activité raffinage à court terme, car, au-delà de la rentabilité immédiate, se dessinent des raisons stratégiques et politiques.
L’argument suivant : « les prix français hors taxes des carburants sont parmi les plus bas d’Europe », développé par la chambre patronale et les compagnies pétrolières, est incompatible avec la mise en exergue des surcoûts supportés sur le territoire français (taxe professionnelle, taxes de port, contraintes environnementales, etc.). Ainsi les volumes importants de lubrifiants exportés montrent les performances du raffinage français et sa compétitivité en Europe.
Ce qui compte surtout, c’est l’adaptation de l’outil de raffinage à la demande, sa souplesse et les moyens de financement qui lui sont alloués pour se transformer en permanence.
Cette exigence suppose que les compagnies puissent travailler dans un environnement réglementaire stable sur le long terme et défini en concertation avec les pouvoir public. Elle suppose aussi que les compagnies pétrolières et leurs actionnaires ne considèrent pas le raffinage comme une activité essentiellement lucrative mais à forte dimension stratégique.
Les résultats financiers du raffinage dépendent d’abord du marché: ils sont indépendants de la productivité et ne reposent quasiment pas sur le coût du travail.
L’industrie du raffinage exige aujourd’hui davantage d’investissements industriels pour s’adapter à la demande (conversion profonde, hydrocraquage) et un environnement réglementaire stabilisé à moyen terme pour assurer le financement de ces investissements.
Distribution
Sous les assauts de la concurrence de la grande distribution, les marges des réseaux de marques sont, en France, les plus faibles d’Europe. Ce mal français se développe aujourd’hui au Royaume Unis. La volonté de rationalisation des groupes pétroliers et l’impact de la concurrence des grandes surfaces engendrent de lourdes conséquences sur le nombre de stations, sur le maillage du territoire et sur les emplois induits :
×en 1975 47.400 stations occupaient 120.000 salariés.
×en 1995 19.000 stations occupent 50.000 salariés.
×en 1997 17.500 stations occupent 47.500 salariés.
×en 2000 16 230 stations occupent 44 000 salariés.
Il est important et urgent d’arrêter cette hémorragie.
Par ailleurs, la concurrence de la grande distribution lamine les marges de distribution, privant les pétroliers d’une part importante du financement des investissements nécessaire au raffinage.
La grande distribution et les consommateurs captent une partie importante de la rente au détriment de l’avenir de la branche, de la prise en compte de l’environnement et de l’emploi.
Une réglementation rendant obligatoire la tenue d’une comptabilité propre aux stations services et imposant la liste des coûts imputables permettrait de clarifier et d’assainir les conditions de concurrence entre la distribution de carburant en grande surface et celle des réseaux de pétroliers.
Fiscalité des carburants
La taxation de l’essence en France et d’une grande partie de l’Europe est très élevée : Au 15/06/01, pour le super SP 95, la taxation est de 75,63 ¤/hl en France pour une moyenne européenne de 75,56 ¤. Les pays qui dépasse la taxation française sont le Danemark avec 75,66 ¤, les Pays-Bas avec 80 ¤, la Finlande avec 77,99 ¤, le Royaume-Uni avec 93,86 ¤ par hectolitre. Ce problème et le différentiel gazole / essence conduisent à une diésélisation accélérée du parc automobile (+de 50 % en 1995).
L’expérience montre que l’harmonisation européenne des taxes est en marche, elle s’effectuera par le haut. La France se situe maintenant dans la moyenne des pays européens pour les prix TTC des produits pétroliers. En janvier 1996, 10 pays européens sur 15 ont augmenté la fiscalité sur les carburants et les fiouls.
En 1999, le gouvernement avait décidé de réduire le différentiel en augmentant la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) de 7cts/l sur le gazole chaque année. La montée brutale des prix du brut en 2000 a entraîné la suspension de cette mesure.
Pour équilibrer la TVA sur les carburants qui est directement proportionnelle à l’augmentation des prix du carburant, le gouvernement a institué le 1er octobre 2000 la TIPP « flottante ». Sur la base d’un point d’équilibre à 25,44 $ par baril, la TIPP peut varier à la baisse ou à la hausse. Le but recherché étant d’équilibrer les ressources de l’Etat et de ne pas les augmenter lors que les prix du pétrole montent et inversement.
Chauffage ( fioul domestique et fioul lourd)
Hors investissements individuels et pratiques commerciales, le fioul domestique est compétitif par rapport aux autres combustibles.
En mars 2001, les coûts étaient les suivants (en équivalant kWh PCI et hors TTC) :
×26,30 ces pour le fioul domestique.
×26,00 ces pour le gaz naturel.
×70,09 ces pour l’électricité.
La technique utilisée lors de la construction des logements rend le choix économiquement irréversible pour longtemps et annule de fait la compétitivité des énergies. En effet le Fod nécessite un investissement lourd (chaudière, citerne et conduit de fumée).
En ce qui concerne le différentiel de taxation entre les combustibles, il appartient à la collectivité de favoriser des sources d’énergies par rapport à d’autres, en fonction de critères politiques, économiques, écologiques, de services, etc.
Entre 1991 et 1999, le nombre de maisons neuves ayant été équipées d’un chauffage central au fioul a été multiplié par 3.
Les maisons anciennes dotées de chauffage central au fioul a progressé de 4,5 % entre 1998 et 1999. En 1999, la part du fioul a atteint 34,6 % du marché des travaux de chauffage contre 32,3 % en 1998 soit une croissance de 8,8 % alors que le marché ne progressait que de 1,5 %. L’impact du climat est important sur les volumes vendus, la douceur des derniers hivers a provoqué une baisse de la demande, comme l’extension des réseaux de gaz naturel.
La faible part du fioul lourd dans la consommation de produits pétroliers en France (10 % contre 20 % en Europe) est liée au niveau de développement du nucléaire et à la taxation plus forte du fuel lourd que du gaz et du charbon.
Les investissements nécessaires à la transformation du fioul lourd sont coûteux et les marges actuelles sont insuffisantes pour les financer, les « astuces » pour alléger les charges de brut vont atteindre les limites de faisabilité, la construction de conversions profondes (ou équivalent) n’est que retardée.
Les nouvelles dispositions légales (réduction des taxes) concernant le Gaz de Pétrole Liquéfié posent le problème de l’intervention des pouvoirs publics sans concertation, ni réel examen industriel de la branche concernée, au risque de provoquer et d’aggraver le décalage entre l’offre et la demande.
Pour la FCE CFDT une modification de la taxation sur les carburants modifiant l’équilibre de la demande entre les différents carburants, doit s’appuyer sur une stratégie à long terme et se faire en concertation avec l’industrie pétrolière pour éviter un décalage entre l’offre et la demande et permettre les adaptations de l’outil de raffinage.
7 DEVELOPPEMENT DURABLE :
LES ENJEUX DE L’INDUSTRIE PETROLIERE
L’industrie pétrolière porte largement une image de pollueuse, aussi bien pour sa pratique industrielle que pour le produit lui-même et ses dérivés (carburants, plastiques, etc.) Elle porte également une image sociale contrastée qui place ses salariés des pays développés vers le haut de l’échelle du salariat mais laisse ceux de certains pays producteurs dans des conditions plus que douteuses.
Les hydrocarbures portent une bonne part de la responsabilité de l’effet de serre par le rejet de CO2 lors de la combustion des hydrocarbures.
L’accès aux réserves de pétrole est à l’origine de bien des conflits et l’exploitation des gisements n’a pas toujours les retombées positives pour les populations des pays producteurs. La manne financière étant bien souvent réservée à un nombre restreint de capitalistes et de gouvernants.
Pour faire évoluer son image, l’industrie pétrolière va organiser sa communication et tisser des relations avec les ONG pour anticiper les critiques sur les conséquences de son action. C’est par exemple le cas de Shell sur son projet de gazoduc reliant la Bolivie et le Brésil ou elle a consulté les ONG pour ses travaux au travers de la forêt.
C’est encore Total Fina Elf qui annonce son engagement pour le respect des droits de l’Homme qui se déclinera sur le refus du travail des enfants ou l’obligation du respect des règles de sécurité aux sous-traitants et co-investisseurs.
L’industrie pétrolière est aussi consciente que l’énergie pétrolière est amenée à être remplacée à terme par d’autres moins polluantes et durables. Des grandes compagnies comme BP ou Shell s’organisent déjà pour être présentes sur ses marchés émergeants. Aujourd’hui, la question est de modifier la nature de la production d’énergie mais absolument pas de la supprimer. Elles souhaitent donc être prêtes à se positionner sur tout marché énergétique quel qu’il soit.
L’avenir énergétique restera donc concentré dans les grands groupes énergétiques, l’évolution vers des énergies moins polluantes, qui n’auront de douces que le nom, si le débat sur leur contrôle n’est pas démocratiquement organisé. Ce sera un enjeu majeur de société pour le 21ème siècle et l’application d’un réel développement durable.
Le pétrole a toute sa place dans la recherche concernant les piles à combustibles notamment.
Pour la FCE CFDT le débat sur le développement durable ne peut être confisqué par les entreprises énergétiques. Les salariés de ses industries doivent s’en saisir et l’ouvrir aux autres acteurs de la société (politiques, ONG, associations environnementales, collectivités, populations).
Pour la FCE CFDT il est essentiel de construire des outils d’analyse des conséquences apportées par les choix de telle ou telle énergie. Pour ce faire, il faut missionner l’IFP, organisme para-public pour participer à l’élaboration d’indicateur.
Pour la FCE CFDT il reste évident que l’énergie pétrolière et gazière sera encore très importante pour les prochaines décennies. Il faut que l’orientation de la recherche permette de poursuivre l’usage des hydrocarbures en réduisant encore très fortement les rejets polluants.
Pour la FCE CFDT il faut améliorer la transparence des conséquences environnementales de l’exploration et de la production pétrolière. Il faut développer l’expertise et l’audit externe en terme d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
8 CONCLUSION
En 1985, les compagnies pétrolières ont obtenu une libéralisation du marché pétrolier français. Elles sont désormais prises en tenaille entre un marché dérégulé, sans pilote, et un outil industriel hexagonal peu flexible par nature. Elles sont au prise avec une concurrence qu’elles ont nourrie et qui les empêche aujourd’hui de financer les investissements nécessaires à l’adaptation de leur outil, régional, national ou européen.
L’industrie pétrolière française montre de manière frappante qu’un marché ne peut se réguler seul. La sous-capacité en gazole, par exemple, n’entraîne aucune pénurie, les prix restent bas et empêchent tout investissement visant à produire davantage en gazole.
Au lieu d’agir pour réguler le marché à l’échelle européenne,ces Diaforus du libéralisme réclament toujours plus de dérégulation.
Pire encore, avec l’enthousiasme des convertis de fraîche date, les responsables croient trouver leur salut en segmentant la filière industrielle et en faisant porter leurs efforts de productivité secteur par secteur, alors que la compétitivité résultera surtout d’une synergie globale à l’intérieur de la filière et avec les secteurs qui lui sont connexes.
Ces hommes de finances appliquent les critères de court terme du marché boursier à une industrie qui exige des choix de long terme.
Pour eux, ce qui fait avant tout problème, c’est l’outil industriel, avec les hommes qui le font marcher : pas assez souple et flexible, pas assez rentable et performant, financièrement parlant.
Ils n’ont de cesse de le réduire par plans sociaux successifs et menaces de fermetures, poursuivant le rêve libéral de profits financiers produits sans activité matérielle.
Pour la FCE CFDT, il est grand temps de rompre avec cette logique démente et de rentrer dans des processus de coopération entre les différents acteurs, afin de prendre en compte les intérêts des différentes parties et définir ce que pourrait être l’intérêt général dans l’industrie pétrolière :
×La prise en compte de l’environnement et de l’épuisement des ressources naturelles.
×L’emploi et la formation des jeunes.
×La maîtrise pacifique des sources d’énergie à l’échelle internationale.
Pour la FCE CFDT il est indispensable d’investir en Europe pour pérenniser à long terme l’industrie du raffinage distribution.
Investissement pour :
×Adapter le raffinage à l’évolution de la demande (augmenter la production de gazole).
×Transformer les fuels lourds (aller vers la conversion profonde ou des procédés équivalents).
×Créer et produire dans les raffineries européennes de nouveaux carburants plus propres écologiquement et anticiper ainsi la concurrence des énergies de substitution, tout en rendant plus difficile les importations de produits courants.
×Développer la recherche en l’orientant vers de nouvelles utilisations dans la filière chimie.
×Développer la cogénération et la production d’électricité, par des associations industrielles.
Maintenir un pourcentage de débouchés consolidés élevé pour sécuriser la production des raffineries et récupérer la marge sur l’ensemble de la chaîne pétrolière.