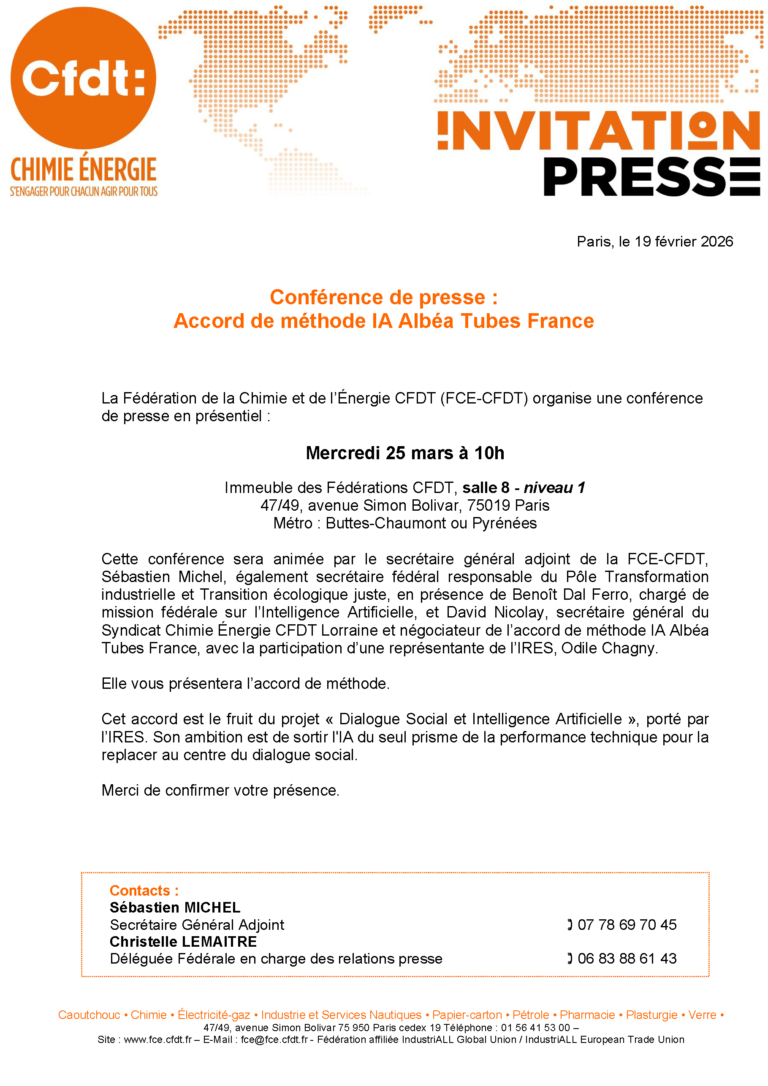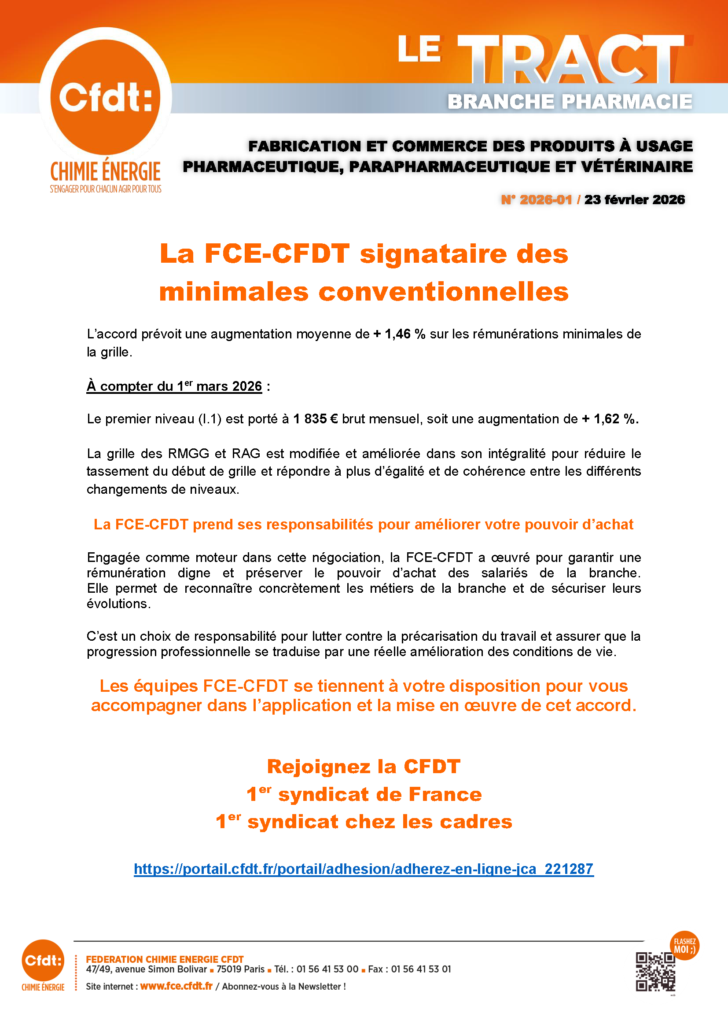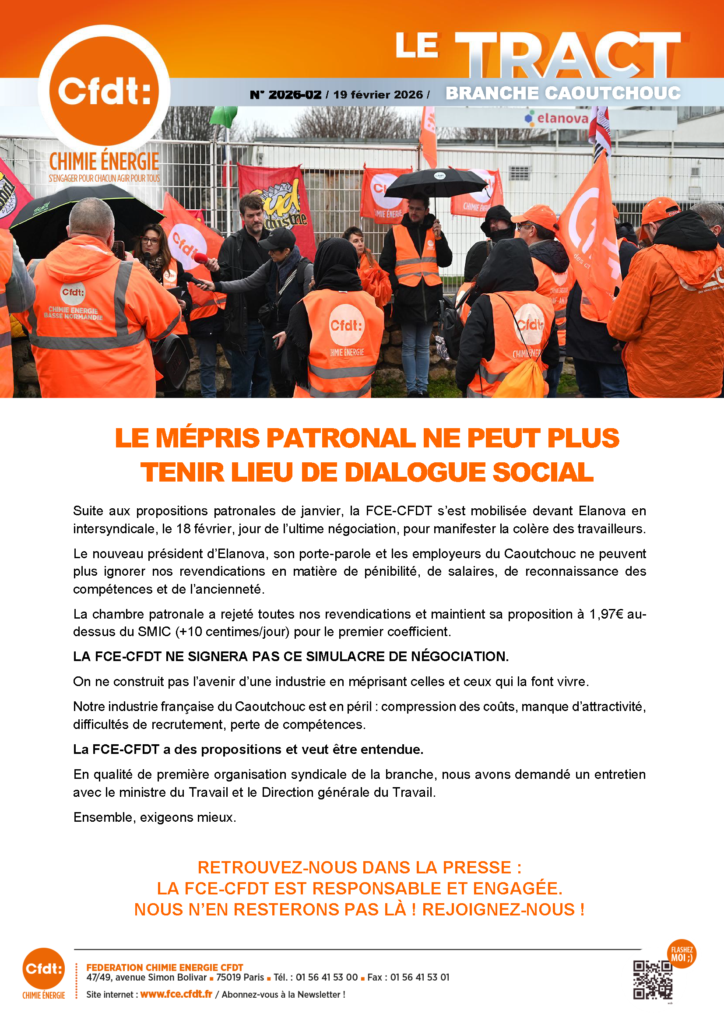« Diversifier les ressources énergétiques pour ne pas en rester au nucléaire et au pétrole ». La FCE pose la question du rééquilibrage des fournitures, mais aussi celle du développement durable. Regard sur le gaz naturel.
La politique énergétique française est aujourd’hui fortement marquée par le nucléaire et le pétrole qui représentent près de 70 % de l’énergie primaire consommée. C’est une situation qui devrait évoluer dans les prochaines années avec une progression de la part du gaz naturel dans tous les secteurs : industries, résidentiel, mais aussi pour la production d’électricité.
Part plus raisonnable du nucléaire
En 2020 on estime que la part du gaz naturel dans le marché de l’énergie sera en France de l’ordre de 14,5 % à 18 %. En Europe le gaz comptera pour le quart du marché avec 24 % à 28 %. Ce développement du gaz naturel permettra dans les années à venir de rééquilibrer la fourniture des énergies primaires en France et de ramener la part du nucléaire dans la production d’électricité à une proportion plus raisonnable et ainsi, de diminuer la vulnérabilité du pays en cas de gros problèmes avec le nucléaire.
Les réserves de gaz naturel sont plus abondantes que celles du pétrole, 70 années de consommation contre 40. Elles sont mieux réparties géographiquement : 1/3 Russie, 1/3 Golfe Persique et 1/3 reste du monde au regard des réserves du pétrole concentrées principalement dans le Golfe. Moins polluant que le pétrole tant en rejet de gaz carbonique qu’en oxydes d’azote, le gaz contribue ainsi plus faiblement au réchauffement de la planète.
Le gaz naturel ou méthane est appelé à être une énergie majeure pour les cinquante prochaines années. Son utilisation n’est pourtant pas une véritable une nouveauté. Les premiers chinois l’utilisaient déjà dans leurs forges en captant des puits naturels avec des canalisations en bambou. Mais son essor date des années 1920 aux Etats-Unis et des années 1950 en Europe avec le développement des gisements de Lacq, près de Pau et de Groningue aux Pays Bas. De 1950 à 1970 il a remplacé, petit à petit, dans les villes le « gaz de ville » issu de la gazéification du charbon dans les fameuses usines à gaz. Ce gaz de ville toxique et explosif a aujourd’hui totalement disparu.
Comme le pétrole, le gaz naturel est un hydrocarbure fossile issu de la décomposition en absence d’air des végétaux au fond des océans. Selon la pression, la température et la durée, cette décomposition donne du charbon, du pétrole ou du gaz. Les gisements de pétrole produisent d’ailleurs toujours du gaz et, jusqu’à un passé récent, le gaz naturel était considéré comme un sous-produit de la recherche pétrolière. Il est aujourd’hui encore brûlé, à l’extrémité de hautes torchères, sur certains puits de pétrole.
Une alternative à la pollution des transports
La relative propreté et les rejets limités liés à la combustion du gaz naturel constituent un atout et une alternative au développement de la pollution des transports. Il est possible dans de nombreux cas de remplacer le pétrole (essence ou diesel) par du gaz naturel limitant ainsi les rejets en ville. De nombreux pays ont développé des flottes de véhicules fonctionnant au gaz naturel (Italie, Argentine, Japon, Canada ).
Mais cette présentation optimiste, au travers de quelques exemples, masque une politique énergétique qui ne prend pas en compte l’avenir de la planète. Aussi le développement du gaz naturel doit s’accompagner d’une véritable politique d’économie d’énergie et de croissance des énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire. Se reposer seulement sur la relative sécurité que représente le gaz naturel, c’est hypothéquer le futur.
On assiste aujourd’hui à une course en avant des entreprises gazières pour une croissance tous azimuts par la prise agressive de parts de marché avec ses conséquences : une moindre considération de l’intérêt collectif et la mise en veille de la notion de service public. Dans ce marché essentiel de l’énergie, les entreprises ont un rôle à jouer dans l’aménagement du territoire, le développement local et la défense de l’environnement. La notion de développement durable, mise en exergue par les entreprises ne doit pas être une coquille vide.
Enfin, l’accès de tous à l’énergie passe aussi par un usage rationnel de chacun. Et là, du chemin reste à faire !
Un voyage sous surveillance
Le principal inconvénient du méthane réside dans l’éloignement des sites de production des lieux de consommation et dans sa nature gazeuse qui rend son transport délicat et coûteux. Gazeux, il est comprimé et envoyé dans des canalisations qui sillonnent en toute discrétion l’Europe. Ou bien liquide et refroidi à -160 °C, il est transporté dans des méthaniers. Réchauffé, il est ensuite distribué jusqu’aux agglomérations et vers des stockages souterrains. En ville, il arrive dans nos logements à une pression légèrement supérieure à celle de l’air (1,021 fois) et se transforme, selon notre volonté, en calorie (eau chaude et chauffage) ou pour mijoter d’excellents petits plats.