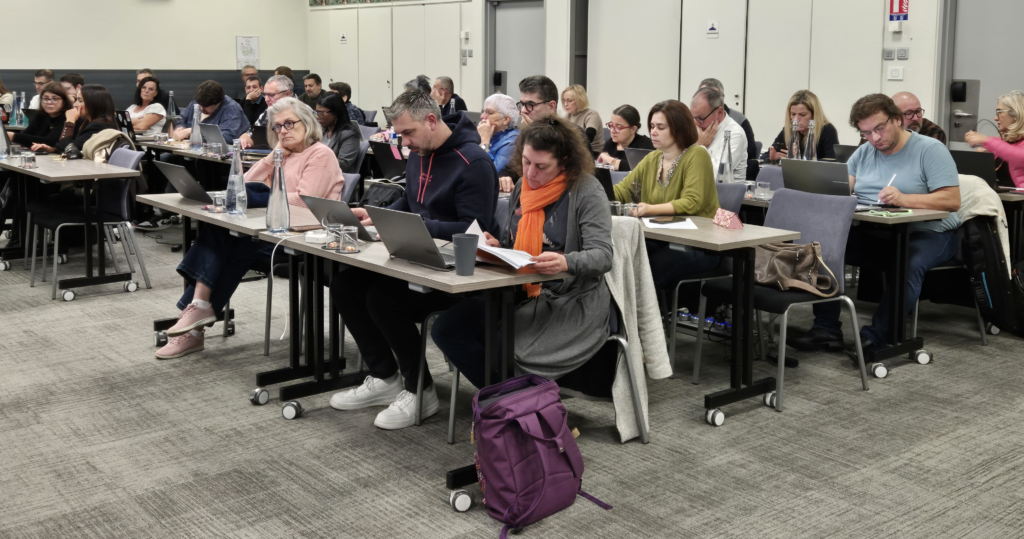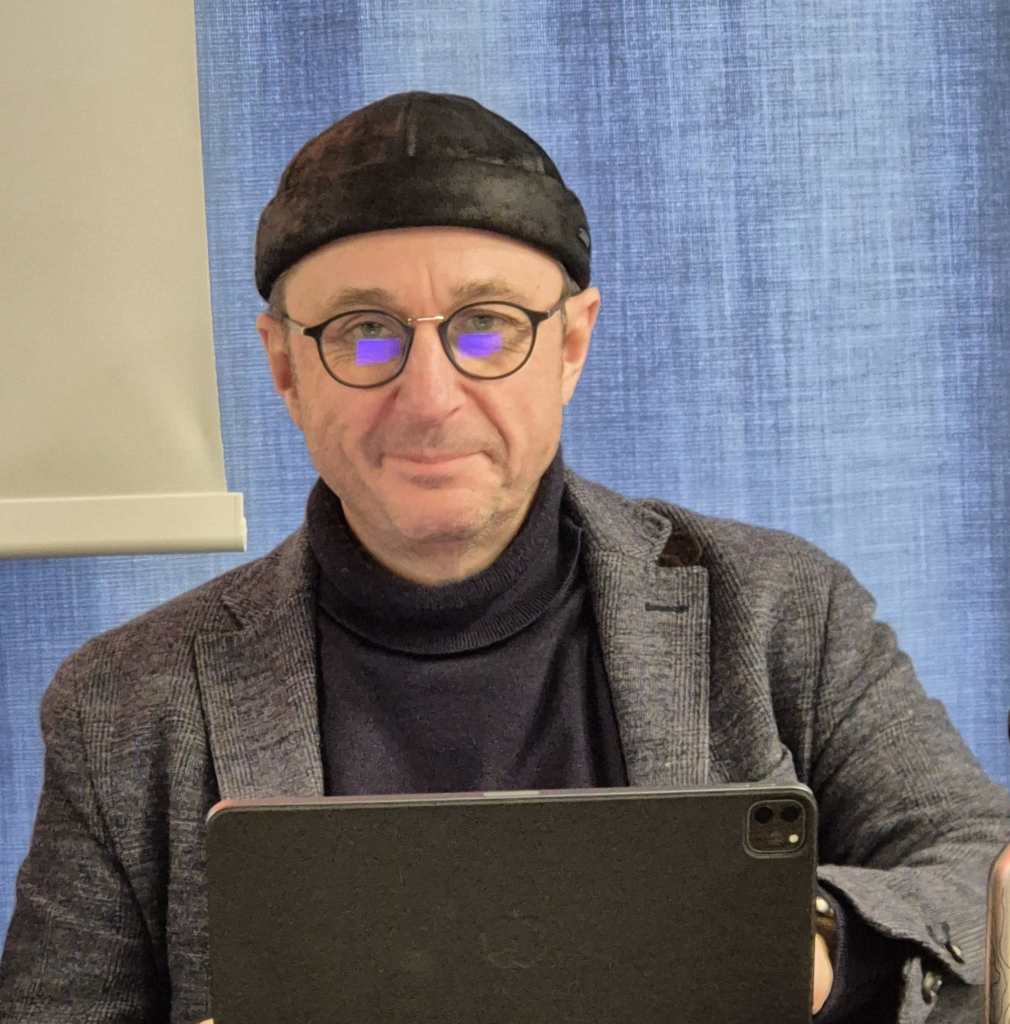Le 14 mars dernier, l’association Europe et Société organisait à Paris un colloque sur le thème « Négociations collectives transnationales : un outil au service de la Stratégie de Lisbonne ? ». Jean-François Renucci, secrétaire fédéral de la FCE-CFDT en charge des questions européennes, y représentait la fédération.
Extraits de son intervention.
(…) La globalisation de l’économie, la mondialisation des marchés, l’internationalisation croissante des entreprises et la dépendance de plus en plus vive des entreprises sous-traitantes de ces grands groupes ont modifié en profondeur l’économie mondiale. Le capitalisme financier a pris le pas sur les logiques industrielles, environnementales et sociales, et les logiques de court terme deviennent le plus souvent la règle. (…).
Comment agir syndicalement pour préserver l’emploi et l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés de plus en plus nombreux à l’échelle mondiale avec l’émergence des pays en plein essor comme la Chine et l’Inde ?
L’articulation des questions économiques, industrielles, sociales, environnementales s’impose aujourd’hui de fait dans nos sociétés.
Le développement durable est le fil conducteur de bon nombre de rapports d’entreprise, d’expressions de tels ou tels responsables,
à juste titre.
Mais concrètement, en quoi en parler modifie-t-il les pratiques au sein des entreprises ? En quoi souvent les actions unilatérales décidées par les groupes constituent-elles autre chose que des actions visant à améliorer l’image du groupe en question ? Codes de conduite, chartes éthiques, accords avec des ONG, c’est sous plusieurs formes que se développe aujourd’hui l’engagement de ces multinationales pour une responsabilité sociale d’entreprise. Cependant, peu se fait avec les représentants des salariés.
L’action syndicale en réponse
C’est donc justement sur ce point que notre fédération travaille, avec d’autres évidemment, tant sur le territoire national, qu’européen ou mondial. C’est le sens de nos engagements internationaux que d’essayer par le dialogue et la contractualisation d’accords de faire progresser la solidarité internationale. Cela nous a donc conduits à développer quatre types d’actions que nous voulons complémentaires et au service du dialogue social comme facteur d’amélioration des garanties d’emploi pour les salariés.
Les comités d’entreprise européens
La première a été de pousser, depuis plus de dix ans maintenant, à la mise en place d’un comité d’entreprise européen (CoEE) dans tous les groupes qui répondent aux critères de la législation. A ce jour, nous suivons dans notre champ fédéral plus d’une soixantaine de CoEE, mais nous sommes également en conflit avec des entreprises qui refusent toujours d’en discuter malgré la législation et nos relances. C’est le cas du groupe pharmaceutique Servier. Ce n’est donc pas gagné d’avance, mais nous poursuivrons notre engagement syndical jusqu’à ce que nous y arrivions partout.
Le dialogue social sectoriel
La deuxième démarche est de favoriser la mise en place d’un comité de dialogue sectoriel entre les partenaires sociaux au niveau européen. Contrairement à ce que nous avons souvent comme idée reçue, ce sont souvent les employeurs qui refusent ce dialogue. Soit parce qu’ils ont peur d’être contraints, soit parce qu’ils ne veulent pas s’organiser entre eux autrement que pour constituer uniquement des lobbies auprès de la Commission européenne.
Dans notre champ fédéral, nous avons aujourd’hui deux comités qui fonctionnent, un dans l’électricité, un dans la chimie. Je ne désespère pas de voir arriver un nouveau comité dans le verre, après la très prochaine signature d’un accord européen dans le domaine de la silice cristalline, et aussi un dans le domaine du gaz.
L’analyse européenne des évolutions à attendre dans beaucoup de secteurs d’activité constitue, pour nous syndicalistes, une opportunité pour développer de nouvelles avancées sociales pour les travailleurs et anticiper les mutations probables de nos secteurs industriels particulièrement touchés ces dernières années.
C’est dans ces débats européens que nous entendons pouvoir nous exprimer auprès de la Commission, par exemple sur la politique énergétique, sujet sur le devant de la scène et priorité de la présidence autrichienne de l’Union européenne, ou encore sur l’évolution à attendre dans le domaine des industries chimiques avec notamment la mise en œuvre progressive de la nouvelle réglementation européenne sur les substances chimiques.
C’est pour notre fédération un domaine essentiel de l’action syndicale que nous devons conduire et renforcer dans l’avenir, afin de réfléchir à la fabrication de normes européennes sectorielles à mettre en œuvre dans les Etats de l’Union. La formation tout au long de la vie, la sécurité ou encore la santé au travail sont autant de thématiques sur lesquelles beaucoup reste à faire.
La négociation d’accords transnationaux
La troisième démarche est d’engager avec les multinationales de notre champ fédéral des discussions afin de déboucher sur la négociation d’accords transnationaux de dimension mondiale. Nous en avons conclu deux à ce jour. Un dans le secteur de la chimie avec le groupe Rhodia, et un dans le secteur de l’énergie avec EDF.
Deux négociations de nature différente, au regard de la diversité de la représentation syndicale et des difficultés à gérer pour aboutir au résultat. Car obtenir un engagement de négociation est une chose, négocier en est une autre, conclure une troisième, enfin évaluer la mise en œuvre une quatrième.
Nous avons de multiples contacts avec les plus grandes multinationales françaises ou européennes sur ces sujets. Si la réflexion progresse, nous sommes encore malheureusement assez loin de conclure des accords pour beaucoup d’entre elles et ce, pour diverses raisons. Soit à cause de la géopolitique mondiale qui freine tantôt les syndicalistes, tantôt les employeurs. C’est souvent le cas avec les entreprises pétrolières ou pharmaceutiques. Ou bien, c’est le champ de l’entreprise qui rend tout simplement difficile, voire impossible, la négociation lorsque cela couvre plusieurs champs d’intervention syndicale d’organisations différentes, ou encore parce que le management n’y est pas disposé.
L’accord Rhodia a été conclu avec l’Icem qui compte deux affiliés français, la CFDT et FO. Les autres organisations françaises ne sont donc pas parties prenantes d’un tel accord, et ne peuvent s’y référer puisqu’il est mondial et que ces organisations dans la chimie ne sont pas adhérentes à une fédération mondiale reconnue.
Pour l’accord EDF, toutes les organisations syndicales présentes dans les principales implantations du groupe dans le monde et leurs organisations mondiales étaient parties prenantes de la négociation. Deux types de négociation, deux méthodologies, des résultats difficiles à apprécier dans les deux cas.
La négociation collective européenne
Dernière démarche, celle d’engager au niveau européen des discussions qui nous permettent parfois de conclure des accords, parfois d’obtenir une expertise européenne sur des thématiques choisies, ou encore de rechercher les voies d’une dynamisation du fonctionnement des CoEE, afin d’en faire de véritables vecteurs de dialogue social au service de l’amélioration des conditions d’emploi au sein même de ces multinationales, quel que soit le pays où le travailleur est salarié dans le périmètre européen des groupes concernés. Cela va dans le sens de la Stratégie de Lisbonne.
Nous avons dans ce domaine plusieurs expériences. Chez Total, deux accords conclus, chez Michelin, deux expertises européennes. On discute chez Gaz de France, Saint-Gobain, L’Oréal, Clariant, Solvay et bien d’autres encore, de ce qui pourrait être envisageable. Pour ce qui est des accords négociés, le groupe Total est pour notre champ fédéral en pointe, le groupe Michelin étant encore pour l’instant tourné vers le développement d’expertises, dirigées par les membres du CoEE avec l’appui d’experts, mais dont les résultats ont vocation à conduire à des décisions managériales.
Ces démarches sont pour notre fédération de toute importance, car elles contribuent à la construction d’un modèle européen de régulation sociale. Elles démontrent la pertinence de considérer le social comme un atout de la performance des entreprises, et non un handicap au développement de la compétitivité.
Les questions sociales sont essentielles et leur traitement avec les représentants des salariés nécessaires, tant à l’échelle européenne que nationale ou territoriale, surtout lorsque l’on parle de domaine industriel où les emplois directs et induits constituent souvent le tissu social des bassins d’emplois.
Nous considérons cependant qu’en l’absence de cadre juridique défini pour la négociation collective transnationale, la négociation doit relever de la responsabilité des fédérations mondiales lorsqu’il s’agit d’accords mondiaux, et exclusivement des fédérations européennes lorsqu’il s’agit d’accords européens.
Essentiellement pour deux raisons. La première, c’est que la composition des CoEE est variable suivant les groupes, et nous avons plusieurs membres qui ne sont pas des représentants des salariés. La deuxième repose sur le fait qu’un accord négocié au périmètre européen d’un groupe devrait s’appliquer à l’ensemble des sociétés qui le composent et donc aux salariés concernés, dont la représentation n’est pas forcément assurée au sein du CoEE. De plus, en l’absence de législation en la matière, les accords conclus sont donc de gré à gré, et leur mise en œuvre relève uniquement de la bonne volonté des parties signataires.
En conséquence, pour ce qui relève de la négociation et de la conclusion de tels accords de solidarité internationale, nous devons nous ranger derrière les acteurs syndicaux dont la surface de légitimité est la plus large. Pour notre fédération, il s’agit de l’Icem pour des accords mondiaux, et de l’Emcef pour ce qui relève du niveau européen.
Pour autant, les fédérations mondiales ou européennes ne peuvent être partout et souvent elles confient des mandats de délégation aux responsables de leurs affiliés pour négocier à leur place et assurer le suivi de mise en œuvre. Cela a été le cas dans le cadre
des accords auxquels nous avons participé, tant au plan mondial
qu’européen.
(…) Je voudrais souligner l’importance de la poursuite de la construction européenne pour l’emploi et l’amélioration des conditions de vie et de travail de tous les salariés. Je suis convaincu que par le développement de l’ensemble de ces initiatives, nous serons plus à même de définir de nouvelles régulations économiques et sociales au profit du plus grand nombre en diminuant ainsi la précarité, l’exclusion et les inégalités sociales.
Encore faut-il que les employeurs reconnaissent aux syndicalistes une capacité d’intervention dans les domaines économiques, industriels, environnementaux sans les cantonner aux questions sociales. Cela suppose que les syndicalistes fassent aussi la démonstration de leur responsabilité à tenir compte de l’environnement économique et industriel dans lequel ils se trouvent. C’est en tous cas, le sens de l’engagement de la CFDT et de notre fédération sur l’ensemble de ces questions de solidarité internationale. »