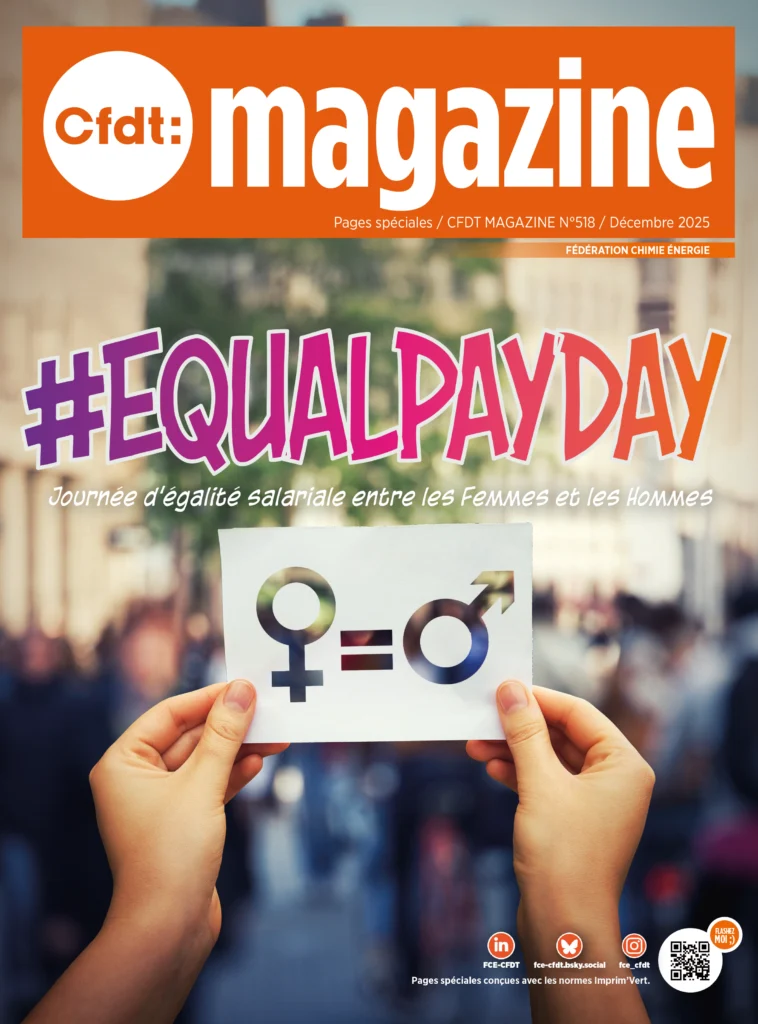Du 7 au 10 décembre 2004, s’est tenue la session de recherche des membres du comité directeur fédéral sur le dialogue social européen. À cette occasion, ils ont eu le plaisir de recevoir leurs partenaires syndicaux de cinq pays européens.
Du 7 au 10 décembre 2004, s’est tenue la session de recherche des membres du comité directeur fédéral (CDF) sur les différents modèles de régulation sociale en Europe. Son objectif était de s’enrichir de l’existant, appréhender les points communs des diverses réalités nationales, envisager enfin les améliorations et les convergences possibles. Et pour alimenter plus largement le débat de la CFDT sur l’Europe, des responsables syndicaux de cinq pays européens étaient présents.
Les organisations syndicales invitées se voulaient représentatives des différents systèmes existants en Europe. Le syndicat danois CID représentait les syndicats nordiques. Les fédérations chimie énergie espagnole et italienne (FIA-UGT et FEMCA-CISL) représentaient, elles, les régulations latines. Nos collègues allemands de l’IG BCE nous ont donné l’occasion quant à eux de débattre de la co-détermination. Enfin, la participation du syndicat polonais Solidarnosc a permis que les nouveaux entrants ne soient pas oubliés dans les débats.
Chaque syndicat européen a présenté son mode d’organisation, les régulations sociales qui existent dans son pays, ainsi que le rapport qu’il entretient avec la société civile comme les partis politiques, les associations et les organisations non gouvernementales.
Pendant les travaux de la session de recherche, construite et animée en coopération par le secteur formation de la fédération et l’Institut des sciences sociales du travail (ISST) de Sceaux, ont alterné apports théoriques des universitaires et pratiques des syndicalistes, travaux de groupes et débats interactifs entre participants et intervenants.
Après l’introduction de Michel Offerlé, universitaire à l’ISST de Sceaux, sur les syndicalismes en Europe, la première table ronde a porté sur les politiques d’adhésion syndicales. Elle a permis l’examen des convergences et des divergences des différents types de syndicalisme et de leur rapport aux adhérents et aux salariés.
Lors de la seconde table ronde, les membres du CDF ont débattu de la problématique du contrat dans l’Union européenne et des différentes manières d’envisager et de pratiquer la négociation.
Les troisième et quatrième tables rondes ont successivement traité des dialogues sociaux et sectoriels dans l’Union, des fonctions du syndicalisme dans la société, des liens avec les gouvernements et les mouvements sociaux ou politiques, de la place de l’Europe dans les politiques et les stratégies syndicales.
Tous les intervenants européens ont souligné les difficultés actuelles du dialogue social et ce, quel que soit le type de régulation sociale du pays. Les attaques de tous les patronats, alimentées par la montée des idées libérales, poussent vers un syndicalisme sur la défensive pour préserver les acquis des salariés. S’il est indéniable que le dialogue social européen progresse, son rythme reste encore pour chacun insuffisant.
La mise en place progressive d’un syndicalisme européen ouvre indéniablement un nouveau champ de négociation à investir. Des avancées significatives émergent (comité d’entreprise européen, dialogue sectoriel, accords européens repris dans la législation européenne ) comme de nouveaux thèmes sociaux (le télétravail, par exemple).
La différence majeure entre pays relève du poids de la législation ou de la prédominance des accords de branche. Dans les pays latins, et plus particulièrement en France, la loi prédomine, les accords de branche et d’entreprise viennent ensuite la compléter. L’extension de la plupart des accords de branche conduit à ce que chaque salarié bénéficie de ces accords. Dans les pays nordiques et anglo-saxons, les accords de branche prédominent. Ils ne s’appliquent qu’aux entreprises adhérentes à la branche concernée, ce qui conduit à des écarts entre salariés de la même branche. Pire, en Allemagne, des entreprises ne souhaitent plus adhérer à la branche pour ne pas avoir à appliquer le contenu d’une convention collective.
Si chaque organisation syndicale se veut indépendante, son lien avec les partis politiques sociaux-démocrates existe bel et bien. L’enjeu : que les syndicats pèsent dans les choix de ces partis politiques lorsqu’ils sont au pouvoir.
Le taux de syndicalisation lui s’étale d’environ 9 % en France à 80 % au Danemark. Le fait qu’au Danemark les accords ne bénéficient qu’aux salariés des entreprises adhérentes à une branche, sans substitution de la loi, explique en partie ce taux élevé de syndicalisation. Mais le facteur déterminant est que les syndicalistes danois gèrent l’assurance-chômage et jouent un grand rôle dans l’embauche. Enfin, partout, le service rendu à l’adhérent s’avère un élément essentiel du développement syndical.
Jacky Morin, chef d’unité à la Direction générale Emploi et Affaires sociales de la Commission européenne, a exposé les mécanismes du dialogue social européen.
De façon tripartite, la Commission, les partenaires sociaux et une délégation des gouvernements se réunissent régulièrement. Une rencontre avec la Banque européenne est aussi organisée chaque trimestre. Avant de valider un texte, la Commission est tenue de respecter un délai de 9 mois. Depuis 1993, 17 dossiers ont fait l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux. Si les négociations aboutissent, la Commission transforme l’accord en textes légaux et étendus (pour exemples, ceux relatifs aux comités d’entreprise européens, aux troubles musculo-squelettiques, au congé parental, au contrat à durée déterminée, etc.). Dans le cas où elles n’aboutissent pas (celles relatives au stress, au télétravail, au travail intérimaire, etc.), la Commission reprend la main pour élaborer une directive européenne qui devra être transposée en droit national.
De façon cette fois bipartite, les syndicats et les employeurs se réunissent avec le soutien technique de la Commission. Dans le cadre interprofessionnel, la Confédération européenne des syndicats rencontre régulièrement l’Unice (Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe) et l’UAPME (Union de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises).
Sous l’impulsion des partenaires sociaux, des tables de dialogue se créent. Une trentaine existe déjà. Celle de la chimie vient d’être mise en place le 14 décembre dernier. Patrick Itschert, secrétaire général de la Fédération syndicale européenne du textile, de l’habillement et du cuir, a fait part de l’expérience de la table de dialogue européenne à laquelle sa fédération participe.
Compte tenu des enjeux du secteur et des mutations en cours, le bilan est aujourd’hui mitigé. Il aura fallu dix ans pour que 15 organisations syndicales et autant d’organisations patronales apprennent à se connaître. Même si des acquis ne sont pas à négliger en matière environnementale. En matière sociale aussi, où de meilleures pratiques d’égalité des chances ont été gagnées. Des accords-cadres ont été signés (adoption des normes fondamentales du travail, code de conduite sur la sous-traitance, etc.). La formation des acteurs syndicaux et patronaux a permis en Bulgarie, par exemple, l’application d’un code de bonne conduite.
Mais il reste beaucoup à faire sur l’articulation entre niveau européen et niveau national, et sur la visibilité des enjeux auprès des travailleurs.