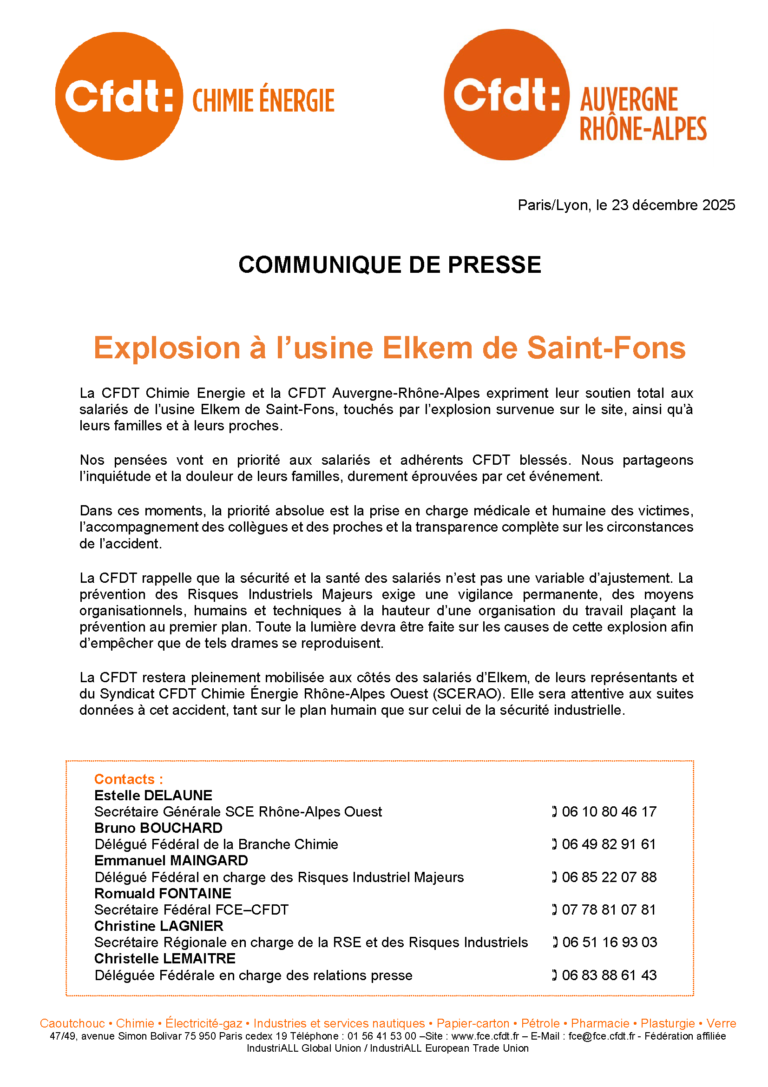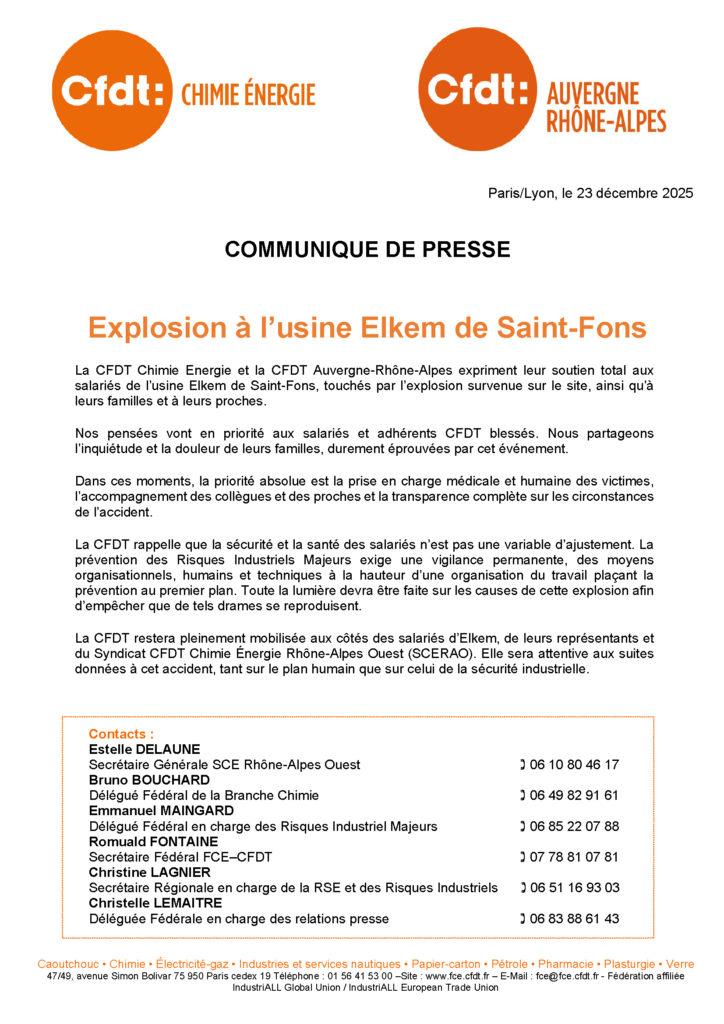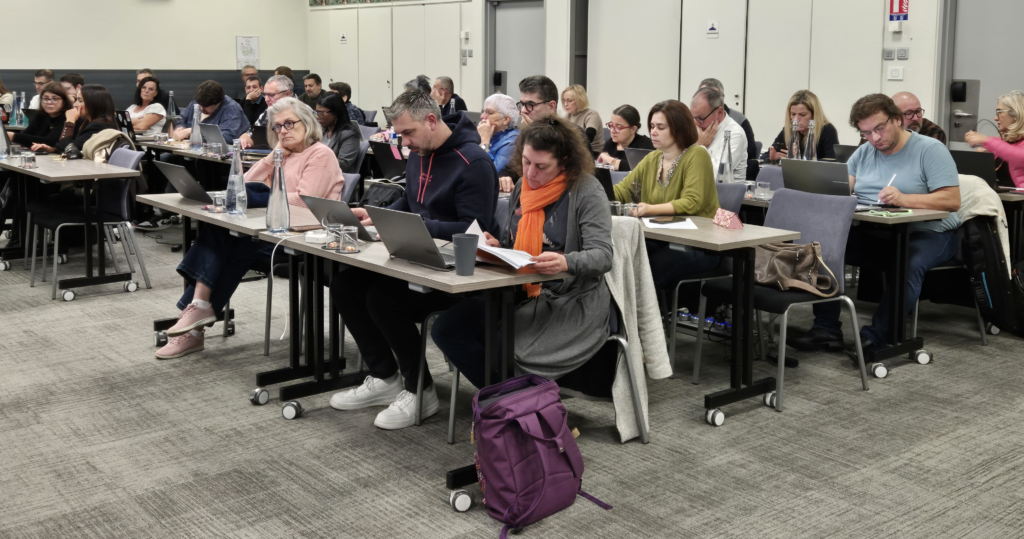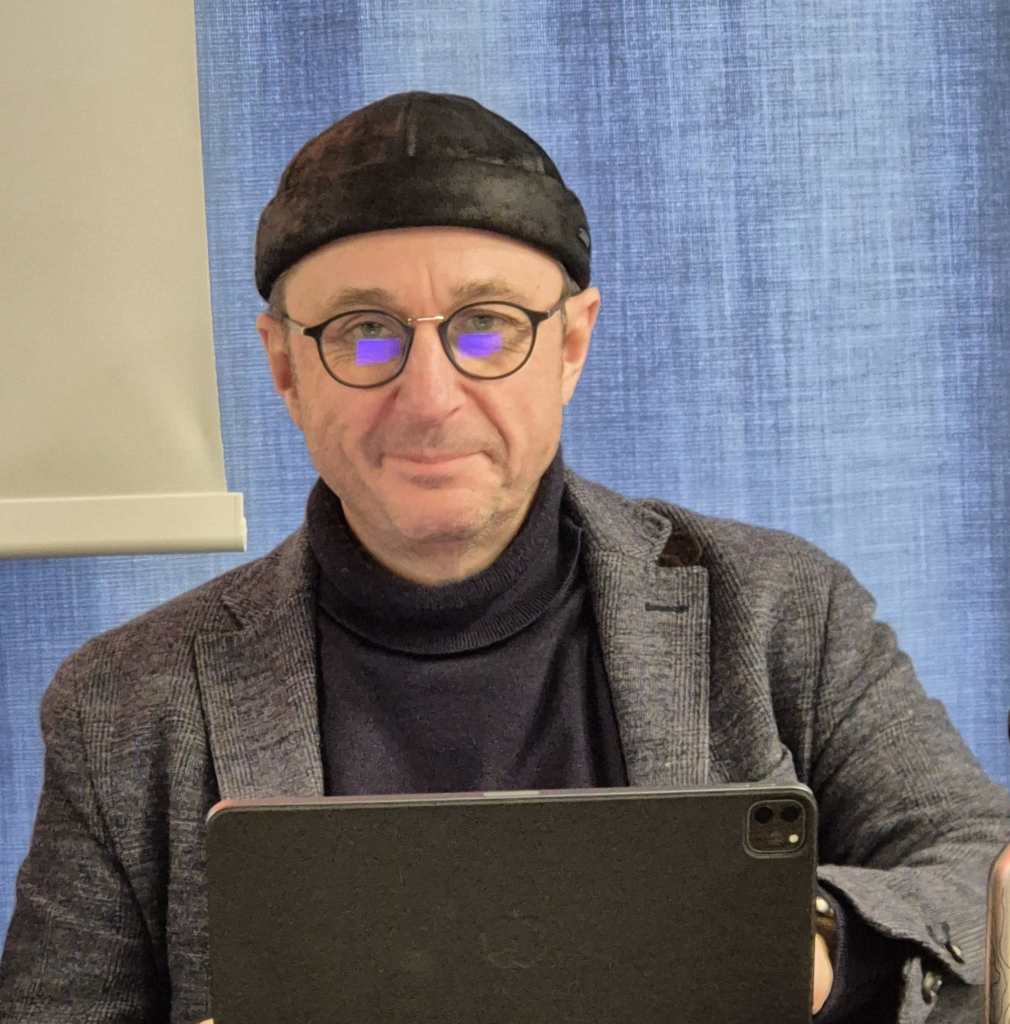Le principe de la création d’un axe énergie figurait en 1974, dans les conclusions du grand débat d’alors sur l’organisation des fédérations. Cet axe énergie impliquait le regroupement de la Fédération unifiée de la chimie (FUC) et de la Fédération du gaz et de l’électricité (FGE) (voir encadré) avec la Fédération des mineurs, et l’intégration dans cette nouvelle fédération du Syndicat national du personnel de l’énergie atomique. Mais les fédérations concernées se déclarèrent alors non intéressées. Dans les années 1980, la volonté des mineurs de rejoindre la FGM plutôt que la FGE a ouvert alors une autre perspective.
Engagement du processus
S’il est difficile de dater exactement l’origine du projet de construction de la FCE, c’est bien la convergence de plusieurs décisions qui marque l’engagement du processus et son entrée dans une phase de concrétisation.
Les chimistes, lors du congrès de Vichy en novembre 1981, engageaient leur bureau national à réfléchir à la révision des frontières fédérales dans la confédération et confirmaient à cette occasion l’intérêt que la FUC portait à un projet incluant particulièrement le nucléaire et les énergies nouvelles. Ils décident aussi de construire une fédération européenne qui sorte de ce que Jacques Khéliff, secrétaire général à l’époque, appelait la « logique de club » pour entrer dans une logique d’action syndicale concertée. Cette fédération est créée en 1988, c’est la FESCID.
La FGE, quant à elle, décide en 1989 d’adhérer à la Fédération internationale de l’énergie et des industries diverses. Elle rejoindra naturellement la FESCID en 1992. Ce choix, voulu par Bruno Léchevin, secrétaire général à l’époque, de privilégier la logique industrielle par rapport à la logique « statutaire » qui l’aurait guidée vers une affiliation à l’internationale des services publics, a été le catalyseur essentiel d’un rapprochement avec la FUC.
Dès lors, au-delà des rapprochements sur les questions européennes et internationales, les contacts se multiplient entre la FUC et la FGE pour aboutir à des coopérations dans le domaine de la formation syndicale, du développement et de la syndicalisation, ou encore d’initiatives revendicatives communes.
C’est à partir de 1993 que les débats sont engagés dans les instances des deux fédérations pour savoir comment aller plus loin. Successivement, les congrès de la FGE, puis de la FUC définissent un cadre de travail. C’est ainsi que naît et prend forme le projet « Emergence », auquel sont assignés trois objectifs : bâtir un projet, rendre acteurs le maximum de militants et réussir la construction d’une fédération CFDT commune.
Définir l’identité
Une fois la décision de principe prise, un travail a été engagé pour définir l’identité, les missions, les axes revendicatifs, le fonctionnement, la structuration et les moyens nécessaires à la future fédération. La transformation sociale, la construction de l’Europe sociale, la syndicalisation et le renouvellement de notre syndicalisme apparaissent au cœur de l’ambition politique du projet. Pour réussir celui-ci, il est décidé d’impliquer fortement les militants locaux.
Dans le même temps que s’élaborent les structures nationales, les militants au niveau de chaque région, ont pu ainsi fonder les bases de leurs futurs syndicats, déterminer leur découpage et leurs schémas organisationnels en harmonie avec ce qui se construit au niveau national. Cette démarche, dite de « coopération », a nécessité un effort important dans une période sociale très chargée (1995-1997). Elle a permis d’être à l’écoute des attentes, des espoirs et des doutes des 2 000 militants qui y ont participé. Elle a contribué à ce que la construction de la FCE soit l’affaire du plus grand nombre, en mettant en avant les faiblesses organisationnelles et politiques des structures existantes et ce qu’il convenait de changer. Enfin, et cela est important à souligner, dans beaucoup d’endroits une libre expression, une forte écoute mutuelle, sans enjeu de prise de décision et de pouvoir, a permis aux militants de la FUC et de la FGE de se connaître à partir de leurs réalités quotidiennes dans les entreprises, les sections syndicales d’entreprise, les syndicats et les liaisons d’entreprise. Au total, quatre années de travail auront permis d’avancer sur un projet sans équivalent dans notre histoire par son ampleur et l’originalité de sa conception.
Construite sur un socle solide
C’est ainsi qu’en mai 1997, le congrès de constitution à Lyon, adopte par 84 % des voix (83,53 % côté FGE et 84,54 % côté FUC) la création de la Fédération chimie énergie CFDT. Elle organise 27 syndicats territoriaux contre 220 précédemment, une structuration politique à trois niveaux contre cinq auparavant et 8 branches que sont la chimie, le pétrole, la pharmacie, le verre, le caoutchouc, la plasturgie, le papier-carton, les industries électrique et gazière, ainsi que les retraités de ces professions.
La FCE s’est construite sur un socle solide, fruit de l’histoire des deux fédérations d’origine. C’est un atout considérable. Cette construction n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il n’est pas surprenant que toutes les pièces du puzzle n’aient pas été mises tout de suite et exactement à la bonne place. Les crises et les embûches auront eu le mérite de pousser les responsables à des débats de fonds et des clarifications sans cesse renouvelées.
S’engager dans l’aventure de la construction de la FCE supposait une conception bien campée du fédéralisme à bâtir, une bonne dose de courage et une lucidité bien réelle. Ces ingrédients réunis, la FCE peut continuer sa route, en poursuivant la réflexion sur un futur toujours à imaginer et à construire au service de la CFDT et de nos valeurs.
La FUC, Fédération unifiée de la chimie, est née en décembre 1972 après l’unification de la FIC, Fédération des industries chimiques CFDT et de la Fédéchimie Force Ouvrière qui avait décidé de quitter FO avec qui elle ne partageait plus les conceptions politiques.
La FGE, Fédération Gaz Electricité, est exclusivement constituée des syndicats des industries électrique et gazière d’EDF-GDF et des entreprises non nationalisées.