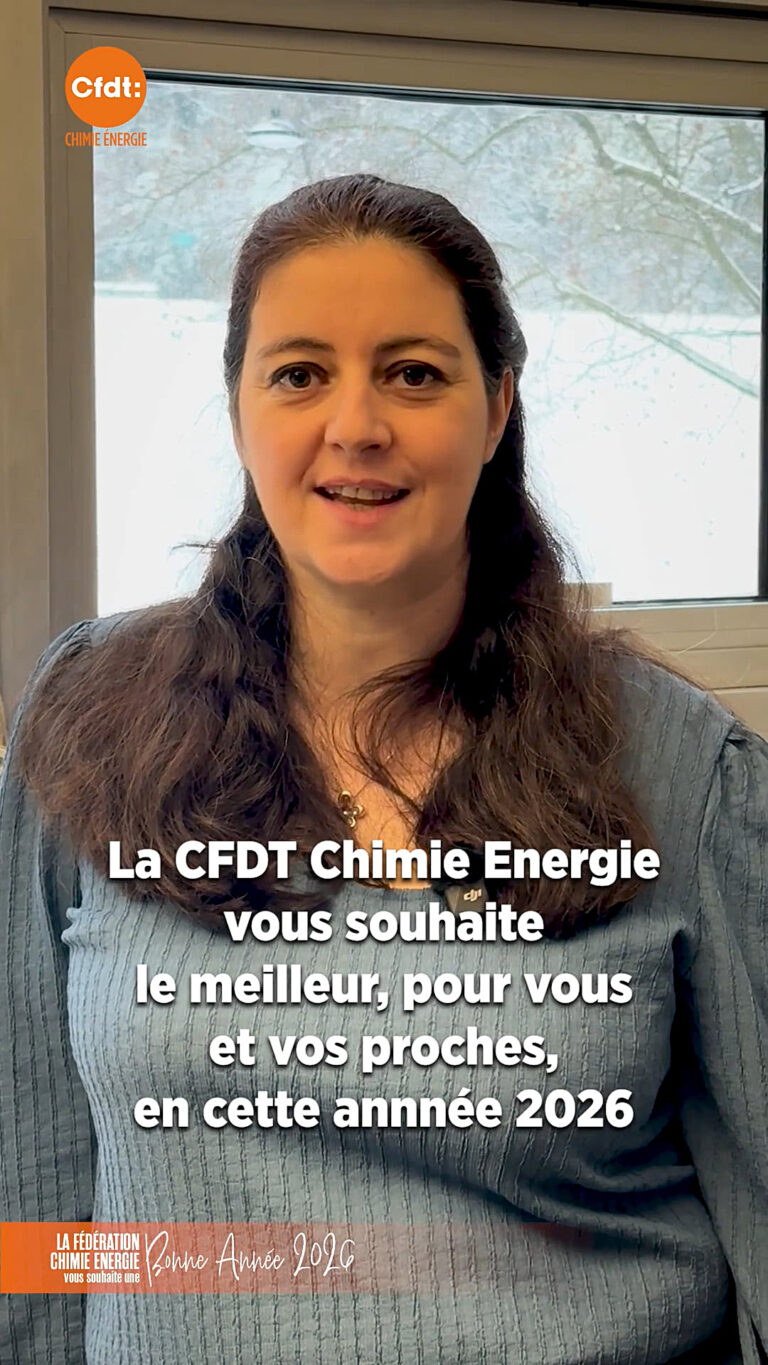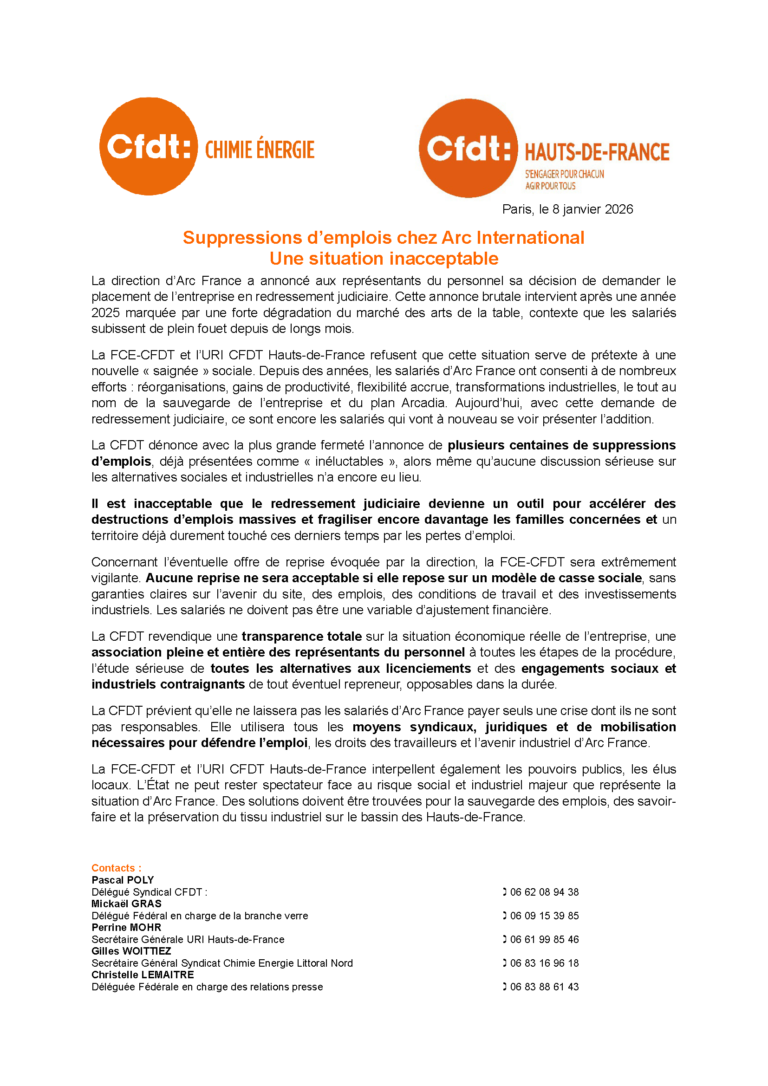L’année 2005 est celle du centenaire de la loi de séparation complète de l’Église et de l’État assurant la totale liberté de conscience et d’expression. Une loi qui a permis d’instaurer cent ans de paix civile en France. Promulguée le 11 décembre 1905, elle proclame dans son article 1 que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées [ ] dans l’intérêt de l’ordre public » et dans son article 2 que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » La République est le garant de la liberté d’opinion, fondement de la démocratie et combat historique du mouvement ouvrier. Elle n’est pas opposée aux religions et leur permet de s’organiser. La laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une pour chaque citoyen dans la limite de la liberté d’autrui. L’État laïque définit un cadre dans lequel chaque personne est libre d’avoir ou non une religion. Chacun est pleinement responsable de ses choix dans tous les domaines.
La République, de ce fait, a une responsabilité : celle d’offrir à chaque citoyen, de façon équitable, la possibilité de pratiquer son culte en toute liberté dans la sphère privée. Cela pose des questions lourdes comme l’organisation de la société, l’enseignement public, le service public, etc. Cela dépasse largement le seul problème du financement des lieux de culte, même s’il est à prendre en compte.
Un siècle après cette loi, le débat demeure et revient sur le devant de la scène en Europe, comme nous le démontre celui sur le préambule du Traité constitutionnel européen. Dans le monde, nous assistons à une montée des intégrismes religieux. Aux États-Unis, les chrétiens traditionalistes ont contribué fortement à la réélection de Georges Bush. Ils continuent ainsi à menacer les droits des femmes, comme celui à l’avortement. Souvent, ils profitent de la corruption des régimes, de l’absence de démocratie, etc.
La récente proposition de Nicolas Sarkozy de modifier la loi de 1905 pour permettre notamment le financement de mosquées dans les grandes villes, ne peut que susciter des interrogations. Les fondements et l’équilibre de cette loi, consolidée par cent ans de pratiques, doivent donc être conservés sans bouleversement. Seuls quelques ajustements pourraient être envisagés dans le contexte actuel. La lutte contre le racisme, pour l’intégration et l’égalité, nécessite de se battre contre toutes les formes de communautarisme qui enferment la personne dans un cadre purement religieux ou ethnique.
A l’opposé, la laïcité c’est la tolérance, le respect de l’autre, le dialogue, la démocratie. Défendre la laïcité est primordial pour le syndicalisme que nous portons. Plus que jamais le combat pour la laïcité est d’actualité et la CFDT le fait sien.